Théorie du droit des auteurs
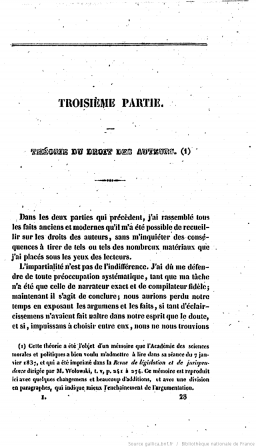 Augustin-Charles RENOUARD in Traité des droits d'auteur dans la littérature, les sciences et les beaux-arts, 2 vol., Paris, J. Renouard, 1838-1839, tome I, p. 433-475
Augustin-Charles RENOUARD in Traité des droits d'auteur dans la littérature, les sciences et les beaux-arts, 2 vol., Paris, J. Renouard, 1838-1839, tome I, p. 433-475
Cette théorie a été l'objet d'un mémoire que l'Académie des sciences morales et politiques a bien voulu m'admettre à lire dans sa séance du 7 janvier 1837, et qui a été imprimé dans la Revue de législation et de jurisprudence dirigée par M. Wolovrski, t. v, p. 241 à 274. Ce mémoire est reproduit ici avec quelques changements et beaucoup d'additions, et avec une division en paragraphes, qui indique mieux l'enchaînement de l'argumentation.
Dans les deux parties qui précèdent, j'ai rassemblé tous les faits anciens et modernes qu'il m'a été possible de recueillir sur les droits des auteurs, sans m'inquiéter des conséquences à tirer de tels ou tels des nombreux matériaux que j'ai placés sous les yeux des lecteurs.
L'impartialité n'est pas de l'indifférence. J'ai dû me défendre de toute préoccupation systématique, tant que ma tâche n'a été que celle de narrateur exact et de compilateur fidèle ; maintenant il s'agit de conclure ; nous aurions perdu notre temps en exposant les arguments et les faits, si tant d'éclaircissements n'avaient fait naître dans notre esprit que le doute, et si, impuissants à choisir entre eux, nous ne nous trouvions pas conduits à la franche adoption d'un système. Pour plus de clarté, je diviserai cette dissertation en autant de paragraphes qu'elle contient de propositions principales.
§ Ier. Les auteurs ont droit à profiter du produit de leurs ouvrages.
L'équité naturelle et l'histoire s'accordent à mettre cette proposition hors de contestation.
À toute époque, on a pensé que l'auteur d'un ouvrage a droit à être récompensé de ses travaux. Dans les temps antérieurs à l'invention de l'imprimerie, ce droit, trop manifeste par lui-même pour n'avoir pas été, dès lors, explicitement reconnu, ne s'est pas produit sous la forme d'un droit privatif : de même que l'on ne contestait à aucun détenteur d'un manuscrit ou de ses copies la faculté de les lire, de les apprendre par cœur, de les réciter, de même on ne songeait point à interdire d'en prendre des copies qui, ensuite, entraient dans le commerce comme tous les autres objets mobiliers. Dès cette époque les auteurs vendaient, mais non pas seuls, des copies de leurs ouvrages ; et il fallait chercher ailleurs que dans ce chétif produit, la rémunération qu'ils avaient méritée. Ce n'est qu'après la découverte du moyen prompt et facile de reproduire, par l'impression, un grand nombre de copies, que la pensée d'un droit privatif a pu naître, et que l'on a pu commencer à croire qu'un auteur trouverait une indemnité de ses veilles et un paiement de ses services dans la vente de ses ouvrages. Ce droit a pris d'abord la forme de privilège qui s'étendait alors sur toutes les fabrications industrielles, ainsi que sur l'exercice de toutes les professions, et qui, protectrice à son origine, se fit sentir de plus en plus oppressive, à mesure que l'amélioration de l'état social la rendit plus inutile. Mais le régime des privilèges était complexe : ceux des auteurs se trouvaient mêlés inextricablement avec les privilèges des libraires, des imprimeurs, des comédiens. On a vu, dans la première partie de ce traité, quels progrès les réclamations des auteurs ont suivis ; comment, d'abord méconnus et ignorés, ils se sont fait jour quand la littérature a pris quelque puissance ; comment ils se sont agrandis avec l'influence de la presse ; comment enfin ils ont conquis une place dans les législations modernes, qui toutes, maintenant, s'en occupent, et sont tenues de compter avec eux.
On peut, et l'on doit, discuter beaucoup sur la nature et sur l'étendue du droit des auteurs. Mais nier qu'ils aient un droit à tirer profit de leurs travaux, ce serait nier la lumière. Nous ne nous arrêterons pas à démontrer une vérité si manifeste.
§ II. La société acquiert, par la publication des ouvrages, un droit à en conserver l'usage.
Un ouvrage non publié n'appartient qu'à l'auteur ; c'est sa méditation parlée ou écrite, sa pensée, son être intellectuel ; c'est lui-même ; l'auteur n'en doit compte à personne, et est maître absolu de le modifier, ou de le détruire. Le fruit qu'il en retire alors, c'est le bien-être de l'étude, la jouissance du travail et de l'exercice de ses facultés, c'est cette volupté dé création qui s'échauffe par l'enfantement des idées.
Par la publication, l'auteur ne demeure plus seul avec sa pensée ; et son œuvre est entrée dans toutes les intelligences auxquelles il en a communiqué l'expression. C'est là un fait incontestable. Naît-il, de ce fait, un droit en faveur de la société ?
On peut se demander si l'auteur qui, par la publication, est arrivé à communiquer ses idées, et qui, en échange, a recueilli l'influence, l'honneur, quelquefois le profit de cette communication, pourra, après en avoir obtenu les avantages, rompre à son gré l'association où il a fait entrer le public, et reprendre tout son apport. Méconnaîtra-t-il que si le public a gagné à connaître l'ouvrage, l'auteur, de son coté, a gagné à avoir un public ? niera-t-il que l'écrivain le plus original est l'œuvre, de son siècle et des siècles antérieurs autant, au moins, que de son propre génie ; que le domaine général lui a fourni les éléments des idées par lui élaborées ; qu'en les rendant à la civilisation à qui il les doit, il s'acquitte d'un devoir envers l'humanité, et paie à ses contemporains et à ses descendants une dette de reconnaissance dont il est chargé envers ses contemporains et ses ancêtres ?
Ces considérations, toutes graves qu'elles soient, peuvent ne pas suffire pour lier l'auteur lui-même autrement que par une obligation morale, et pour créer contre sa personne un droit formel qui lui interdise de ralentir ou de supprimer, tant qu'il vit, ses communications intellectuelles avec le public.
Mais, quand l'auteur n'existe plus, il n'appartient à qui que ce puisse être de vouloir que son œuvre périsse, et de faire obstacle à la propagation à laquelle il l'a livrée. Avoir communiqué ses conceptions au public, c'est avoir clairement manifesté l'intention de leur donner la durée et la vie ; or, la publicité seule assure la vie d'un ouvrage, revêt la pensée d'un corps qui peut rester immortel, et l'empêche de s'anéantir avec les organes corporels de celui qui l'a conçue. Les ayant-cause de l'auteur, qui ne peuvent tenir des droits que de lui, se mettraient en révolte contre sa volonté, s'ils nuisaient à la circulation de son œuvre. Vainement l'auteur lui-même aurait-il exprimé le désir qu'après lui le contrat consommé entre lui et le public demeurât sans exécution ; les idées que, de son vivant, il a introduites parmi celles du public, le public les détient par un fait indestructible, les possède par une donation irrévocable, disons mieux, par une aliénation, dont le prix où la peine, recueilli en partie du vivant des auteurs, s'identifiera à jamais avec leur mémoire ; le public a un droit formel à les conserver dans son domaine.
§ III. Une loi sur cette matière ne saurait être bonne qu'à la double condition de ne sacrifier ni le droit des auteurs à celui du public, ni le droit du public à celui des auteurs.
Cette proposition est une conséquence nécessaire des deux premières. Puisque les deux droits existent, détruire l'un pour donner force à l'autre, ce serait consacrer une usurpation, soit sur le domaine privé, soit sur le domaine public.
Cette conciliation des deux droits et des deux intérêts, loin d'avoir été négligée dans la pratique législative, apparaît au contraire comme la pensée principale qui a déterminé presque toutes les lois sur la matière.
Ce résultat, auquel on est arrivé par l'expérience et par la force du bon sens, ne suffit pas pour éclairer la théorie : aussi notre législation, toute prudente et toute juste qu'elle soit, a-t-elle été sans cesse attaquée jusque dans ses bases, et sans cesse remise en question. Il ne pourra manquer d'en être ainsi tant que la même obscurité en enveloppera les principes. Ce n'est que par l'adoption d'une théorie ferme et nette, ce n'est que par la destruction des préjugés qui règnent en cette matière, que les hésitations de l'opinion auront un terme. Pour en venir là, il ne suffit pas de dire qu'il y a deux droits à concilier ; il faut aller plus avant et pénétrer jusqu'à la connaissance intime de la nature de ces droits, dont la conciliation est le problème qu'une bonne loi doit résoudre.
IV. Les deux systèmes en présence sont celui d'une propriété perpétuelle et celui d'un droit temporaire.
J'ai, par la première proposition, écarté tout système qui tendrait à la négation du droit des auteurs. Je n'ai pas à examiner, quant à présent, comment ce droit s'exercera ; est-il perpétuel, est-il temporaire, telle est la question fondamentale sur laquelle il faut d'abord prendre parti ; il sera temps, après cette base posée, d'en venir aux questions variables et secondaires sur la forme à donner à ce droit, sur son mode, ses conditions, sa durée.
La perpétuité de ce droit compte de très nombreux partisans. Leur système est facile à formuler ; c'est celui de la propriété avec tous ses caractères juridiques, la transmissibilité, la perpétuité, l'inviolabilité. La grande majorité des écrivains a embrassé cette opinion ; nous l'avons vu explicitement professée par d'Héricourt[1], Diderot[2], Linguet[3], Voltaire[4], l'avocat-général Séguier[5]. Elle l'a été par cent autres avec eux. L'expression de propriété littéraire est entrée dans la langue, et l'adoption de ces mots, qui ont prévalu dans l'usage, indique la popularité de l'opinion qu'ils expriment. Cette opinion a fini par prévaloir à tel point que ceux-là même qui ont rédigé des lois pour borner à une période de temps limité l'exercice des droits des auteurs, se sont fait un devoir de commencer par déclarer que, de toutes les propriétés, c'est la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable[6].
La législation positive a appliqué cette théorie en France dans les règlements de 1777 et dans la loi du 18 mars 1806 sur les dessins de fabriques. En Angleterre, la jurisprudence a déclaré que la propriété perpétuelle existait en vertu de la loi commune, avant d'avoir été restreinte par des actes législatifs. La propriété perpétuelle a existé en Hollande de 1796 à 1811 et de 1814 à 1817.
Le système d'un droit temporaire a joui de très peu de faveur auprès des écrivains ; mais, en revanche, il a hautement prévalu dans la législation. C'est le droit général de tous les peuples ; c'est celui de la France dans toutes ses lois, anciennes et modernes, à l'exception des deux que je viens de citer. C'est également sur cette base que sont assises toutes les législations modernes relatives aux brevets d'invention.
S'il fallait se décider d'après l'autorité, je n'hésite pas à dire que la pratique universelle des nations éclairées devrait être d'un beaucoup plus grand poids que l'accord des théoriciens, fussent-ils tous unanimes.
C'est une singularité digne de remarque que le règne, sans partage, d'une pratique qui s'attaque aux idées reçues, qui contrarie les phrases faites, qui choque la thèse favorite adoptée et prônée par la presque universalité des écrivains. À coup sûr, il y a là, de part ou d'autre, un préjugé à déraciner, une erreur dominante à détruire.
La théorie d'un droit temporaire n'est pas, comme celle d'une propriété littéraire, facile à formuler d'un mot ; elle embrasse des idées complexes ; elle exige une exposition et des développements. Déjà, dans mon Traité des brevets d'invention, j'en ai essayé une démonstration que je vais reprendre et compléter, en cherchant à réfuter ou à prévenir les principales objections auxquelles elle m'a paru avoir donné lieu. Je ne connaissais point, à celle époque, la dissertation de Kant[7]. Je n'en adopte ni tous les développements, ni toutes les conséquences ; et je conviens que, se proposant surtout de fonder et de définir le droit des éditeurs, il n'a pas explicitement résolu la question qui nous occupe. Mais, du moins, il a posé en principe qu'un livre n'est qu'un usage des forces et des facultés de l'auteur, qu'un instrument à l'aide duquel il adresse la parole au public. J'espère démontrer plus tard que de cette proposition fondamentale découlent des conséquences inconciliables avec la thèse d'une propriété perpétuelle.
Il m'est souvent arrivé, lorsque j'ai discuté cette question, de rencontrer des partisans du droit de propriété disposés à en faire bon marché, et qui, pour peu que l'on consentit à ne pas le nier, étaient prêts à en abandonner toutes les conséquences et à en restreindre les effets à ceux d'une propriété purement temporaire. C'est même là ce qui parait s'être passé dans toutes les discussions législatives ouvertes sur ce sujet. Que, dans la pratique des affaires, on ait recours à de tels expédients pour couper court à une discussion, ou pour en sortir, je le conçois ; mais, lorsqu'il s'agit de prendre parti sur un problème philosophique, il faut l'aborder plus résolument. La prétendue solution qui consisterait à ne reconnaître la propriété que pour la convertir aussitôt en un droit purement temporaire, ne serait qu'un subterfuge. J'aurai à démontrer plus tard que les principes essentiels de la propriété résistent à de tels accommodements. C'est parce qu'on se laisse aller à éluder la discussion des principes fondamentaux que les questions restent confuses, que les lois, rédigées comme au hasard et sans une pensée d'ensemble, se prêtent à toutes les argumentations, que la jurisprudence flotte sans boussole. Non, de tels débats ne sont pas oiseux. L'étude de la législation resterait incomplète si l'on se contentait de copier les textes qu'elle entasse, ou même de déterminer les résultats qu'il lui est utile d'obtenir ; et quelque chose manque à la satisfaction de l'intelligence et à la sûreté logique des raisonnements, aussi bien qu'à la plénitude de la conviction, tant que l'on néglige de remonter jusqu'à la vue des principes, et de redescendre ensuite, la série de leurs conséquences.
§ V. La reproduction des ouvrages d'esprit n'est point un objet de propriété.
Pour reconnaître s'il existe une propriété littéraire, ou si, au contraire, les auteurs puisent dans un titre autre que celui de propriétaires leur droit à recevoir un prix de leurs travaux, on ne peut se dispenser d'arrêter d'abord ses idées sur ce qu'est la propriété en général.
C'est entreprendre une redoutable analyse, que d'essayer de montrer à découvert les fondements sur lesquels s'appuie ce grand droit de propriété, l'une des voûtes de l'édifice social. Il n'est aucune question plus ardue ni plus haute dans la philosophie du droit.
Que l'intelligence ait empire sur les choses ; que l'homme soit le maître légitime de la nature inintelligente livrée à lui pour le servir, c'est là une vérité trop évidente pour n'être pas incontestée.
Que le monde ait été donné, non à un ou plusieurs hommes, mais à l'espèce humaine ; que la sociabilité soit une loi de notre organisation physique, intellectuelle et morale ; que l'état de société, état nécessaire, ait créé pour les hommes un ordre de devoirs qu'il est dans leur essence de comprendre et dont la garde est confiée à chaque conscience individuelle avant même de l'être aux législations positives ; qu'au premier rang de ces devoirs se place celui de respecter dans nos semblables la personnalité, la raison, la liberté, saintes en eux comme en nous-mêmes ; que de là naisse une limite morale à notre empire sur la nature matérielle, limite qui consiste dans le respect des droits d'autrui, dans l'obligation de ne point tenter d'approprier à notre service les portions de matière déjà appropriées par un de nos semblables, ce sont là des propositions que la philosophie a trop bien démontrées pour qu'elle ait désormais besoin de s'arrêter à en établir la preuve ; elles sont acquises à la science, qui est en droit de les prendre pour point de départ, en les tenant pour avérées.
Ces principes fondamentaux sur lesquels la propriété repose ne suffisent pas à eux seuls pour établir et justifier l'origine et les conditions de ce droit.
La propriété, telle que l'usage et le consentement universel la définissent, est un droit entier et absolu sur les choses, qui s'acquiert par première occupation, par échange, contrat dans lequel la vente est comprise, par donation, par les successions naturelles que règle la volonté de la loi, par les successions testamentaires que règle la volonté de l'homme.
Toute puissance du propriétaire, inviolabilité de son droit exclusif, perpétuité de ce droit par complète transmission d'ayant-cause en ayant-cause, ce sont là les caractères que les habitudes du genre humain reconnaissent à la propriété et sur lesquels se fonde le respect qu'on lui porte.
Le droit de propriété a rencontré des adversaires ; car l'une des preuves de liberté que l'esprit humain a toujours faites a été de se révolter contre les vérités les mieux acceptées. Les uns ont réclamé une nouvelle organisation sociale fondée sur la coopération de tous les travaux et sur la communauté de tous les biens. D'autres, ne reconnaissant qu'une source légitime de possession, le travail, se sont attaqués aux transmissions héréditaires, aux loyers et fermages payés à des propriétaires qui ne se livrent à aucune exploitation : ce serait à un pouvoir suprême qu'il appartiendrait d'assigner à chacun sa part dans la distribution des choses matérielles d'après la capacité ou l'utilité des individus et pour le plus grand bien général.
Je demande la permission de ne pas m'appesantir sur la réfutation de ces paradoxes ; non sans doute qu'ils ne soulèvent des problèmes sociaux d'un haut intérêt, ni que leur discussion ne puisse conduire à rétablissement de vérités importantes ; mais il faut savoir se borner, et se défendre de la tentation de tout prouver et de tout dire. Je déclare donc que je prends pour point de départ la croyance commune du genre humain à un droit de propriété. Je vais d'ailleurs avoir à exposer comment et pourquoi j'accepte pleinement la sagesse et la vérité de cette croyance générale.
Non seulement, je crois au droit de propriété ; mais je suis de ceux qui pensent que son établissement repose sur un droit nécessaire et naturel. Je dirai pourquoi je n'accepte pas l'opinion qui réduirait la propriété à n'être qu'une simple création du droit civil, née de conventions variables, établies par des lois positives en vue de la plus grande utilité sociale.
Pour les partisans assez nombreux de cette dernière opinion, si la propriété est légitime, c'est parce qu'elle est utile ; car, suivant eux, l'utilité est la racine de tout droit : une loi positive a créé la propriété ; une autre convention pourrait la détruire et la remplacer par une combinaison nouvelle. Pour quiconque se range à ce système, le débat sur les droits des auteurs de productions intellectuelles peut se borner à reconnaître si, en cette matière, il serait utile ou nuisible de consacrer un droit destiné à s'exercer, dans toute sa plénitude, d'après les règles et avec les conséquences que la législation actuelle attribue à la propriété des objets matériels. Restreinte à ces termes, la question serait promptement résolue ; car nous verrons plus tard que de graves considérations d'intérêt général démontrent qu'il y aurait un grand danger social à asservir aux liens d'un monopole perpétuel les produits de la pensée.
Mais je ne veux ni ne puis borner ainsi la question, puisque je considère la propriété comme appartenant à ce droit nécessaire qui constitue ce qu'il faut appeler le droit naturel ; droit supérieur aux combinaisons arbitraires et accidentelles des lois positives auxquelles il n'est pas permis de le rejeter ou de le remplacer. Si je reconnaissais aux droits des auteurs les caractères de la propriété, mon esprit ne serait pas libre de leur en refuser une seule des conséquences.
Ce ne sera qu'après avoir constaté les titres et l'origine du droit de propriété, que, pénétrant dans l'essence du droit d'auteurs, j'examinerai si ces deux droits procèdent de la même source et existent aux mêmes conditions.
Quel est le sujet du droit de propriété ? quel en est l'objet ?
Le sujet de la propriété c'est l'homme. La nature inintelligente lui a été donnée pour qu'elle le serve, et pour qu'il l'exploite ; elle est mise en son pouvoir et subordonnée à son action. Les choses qu'un individu ou qu'une association n'a pas faites siennes, restent un bien vacant, un bien inutile à l'espèce humaine, ou plutôt elles ne sont pas encore un bien.
Le droit sur les choses serait illusoire s'il n'y avait, pour celui qui les exploite, fixité, sécurité, lendemain. Elles ne sont exploitables qu'à cette condition. Si, quand un homme tient un fruit, chacun pouvait le lui arracher de la main ou de la bouche, s'il s'abrite sous un toit et qu'on l'en chasse, s'il laboure un champ et le sème mais que le premier venu moissonne, qui serait assez fou pour cultiver, pour exploiter, pour compter sur l'instant qui suivra ? En livrant à l'espèce humaine la nature matérielle, la Providence, au lieu de lui fournir sa condition d'existence, aurait jeté au milieu d'elle une intarissable source de discordes et de guerres ; la vie serait impossible, la sociabilité une chimère ; il n'y aurait autour des hommes que violence, que chaos. Il est donc dans le droit des hommes que les choses soient privativement appropriées.
À qui le seront-elles ? Puisque tous ont originairement un droit sur toutes choses, celui qui le premier a marqué une chose du sceau de son droit n'en peut plus être désinvesti sans qu'il y ait contre lui lésion, injustice.
La nécessité de reconnaître la plénitude du droit dans la personne du propriétaire ne permet pas de lui refuser le droit d'échange, de vente, de donation. Il n'aurait pas toute puissance sur la chose dont il lui serait interdit d'user, et sur laquelle il ne lui serait pas loisible de transmettre à autrui tous ses droits.
Ce qui adviendrait si aucune possession n'était respectée, arriverait également si le respect pour la possession n'avait qu'un temps, et, par exemple, dans le cas où, le propriétaire mort, ses biens demeureraient sans maître. Alors l'objet abandonné périrait ou resterait inexploité, ou bien, livré à la chance de conquête du premier occupant, il ferait, à tout instant, naître et renaître la guerre.
S'il importe que ni le temps ni la mort n'ébranlent la fixité de la propriété, qui possédera à la mort du propriétaire ? qui deviendra propriétaire à sa place ?
Ce n'est ni un pur caprice des hasards de la naissance, ni un arbitraire irréfléchi de la loi, qui, en consacrant la légitimité des successions naturelles et testamentaires désignent le légataire ou l'héritier comme le juste successeur destiné à continuer la personne du défunt.
Aucun homme n'est isolé sur la terre ; la sociabilité tient à l'essence de l'espèce humaine ; la société est un état naturel. Or, la société n'existerait pas s'il n'y avait des agglomérations d'individus ; si, autour des chefs de famille et de maison, ne se groupait pas une agrégation dont ils sont le gouvernement et le centre. C'est par cette cohésion d'une multitude de sociétés partielles que le genre humain se tient et s'unit. Un propriétaire ne possède qu'à la charge de certains devoirs à remplir. Sa condition est d'élever, de nourrir ses enfants, de contribuer aux dépenses communes, aux charges de l'état. Sa femme, ses enfants, ses père et mère, ses frères et sœurs, ses domestiques, ont sur ses biens une part quelconque dont il est le dispensateur et dont il ne lui est pas permis de les priver ; en certains cas la loi l'y force ; en d'autres la morale. Après lui, ses biens restent affectés à ses dettes : d'abord sans doute à ses dettes civiles, mais aussi à ses dettes naturelles. Ils passeront aux personnes envers lesquelles le défunt était lié par les plus intimes devoirs, et formeront un ou plusieurs autres centres de maison ou de famille. Si le défunt désigne un de ses associés à qui ses biens passeront, c'est la succession testamentaire ; si la loi, c'est la succession légale.
À travers toutes les transmigrations de la propriété, le caractère de perpétuité domine, et la continue sans interruption depuis le premier occupant jusqu'à ceux qui, par contrat, donation, testament, succession, le représentent et le remplacent.
L'occupation est la première source de la propriété ; la prescription est la seconde. Ceux à qui des biens n'adviennent pas régulièrement par occupation d'objets vacants ou par les ayant-cause des premiers occupants, ceux que la conquête, la guerre ou tout autre mode de spoliation, toute autre action de la force en investissent, sont des usurpateurs, non des propriétaires. Mais, à défaut de la légitimité dérivant de la première occupation, les objets par eux possédés pourront, dans leurs mains ou dans celles de leurs successeurs, acquérir par la légitimation de la prescription le caractère de propriété. C'est là un hommage rendu au besoin de continuité de la propriété. Il y a un grand sens dans l'axiome par lequel la prescription, fille du temps et mère de la paix, est appelée la patronne du genre humain.
Quelle que soit la source de la propriété, la jouissance exclusive, la toute-puissance, la perpétuité par transmission, en sont les caractères essentiels, qui dérivent de la nature même de l'homme et qui sont nécessaires à la plénitude du droit dont il est investi comme maître et roi de la nature.
Nous avons étudié la propriété dans son sujet, qui est l'homme. Il faut maintenant la considérer dans son objet.
Tout objet de propriété doit être une chose appropriable.
C'est pour cela que l'esclavage est illégitime ; car il suppose l'appropriation d'une intelligence, tandis que toute intelligence doit demeurer libre et sienne.
Même dans la nature inintelligente, il est des choses dont l'exploitation n'exige point une appréhension privative perpétuellement transmissible.
La division des choses en appropriables et inappropriables n'est pas nouvelle. Les jurisconsultes romains l'ont reconnue et admirablement développée.
Attribuer à des propriétaires exclusifs les objets appropriables, il y a là nécessité, utilité, justice. Attribuer à des propriétaires exclusifs les objets inappropriables, c'est appauvrir l'humanité tout entière ; il n'y a pas nécessité, puisque l'intérêt privé n'a nul besoin de veiller à leur garde et à leur conservation ; il n'y pas utilité, puisque leur valeur ne dépérit en rien par cela que tous en profitent et les exploitent ; il y a injustice, car chaque homme a droit sur ce qu'il peut s'approprier sans nul préjudice pour un droit acquis à autrui ; et si un objet est tel que chaque sujet puisse en avoir la jouissance pleine et complète, sans empêcher tout autre sujet d'en jouir pleinement, complètement, l'approprier à un seul, c'est une usurpation intolérable.
Une portion de terre ne peut être cultivée ni possédée par tous. L'air, le feu sont des richesses universelles. Il est toute une vaste famille de ces biens, patrimoine commun du genre humain, et dont la libéralité de la Providence a fait largesse à chacun de ses membres.
Dans cette grande division d'objets appropriables et d'objets inappropriables, à laquelle des deux classes appartiendront les productions de l'intelligence, les travaux des sciences, de la littérature et des arts ?
Ces productions, ces travaux, que sont-ils ? Une nouveauté de combinaison dans les résultats de la pensée. Or, comment douter que par son essence la pensée n'échappe à toute appropriation exclusive ? Lorsqu'elle passe dans les esprits qui la reçoivent, elle ne cesse pas d'appartenir à l'esprit dont elle émane ; elle est comme le feu, qui se communique et s'étend sans s'affaiblir à son foyer.
De ce que la limitation de la pensée par appropriation exclusive n'est pas nécessaire, le genre humain est en droit de conclure qu'elle n'est pas permise. Qu'un champ, qu'un fruit, qu'un objet quelconque dont la nature est appropriable soit livré à tous, ou que tous veuillent à la fois en prendre possession, personne n'en jouira. Au contraire, la propagation de la pensée, loin de nuire à la pensée, la fortifie, l'augmente, l'agrandit ; heureux que tous puissent en jouir, le genre humain y puise sa dignité et sa vie. Propager, améliorer, compléter sa diffusion, c'est pour l'humanité le premier de tous les progrès.
La perpétuité de propriété plaît à nos habitudes sociales. Une terre, une maison, un meuble, sont possédés privativement et se transmettent par succession. Un auteur se dit : J'ai créé un ouvrage qui vaut bien autant qu'un meuble, qu'une terre ; pourquoi mes enfants n'en jouiraient-ils pas, comme tous les autres enfants de tous les autres biens que leurs pères leur laissent ? Ces considérations sont puissantes. Nul ne peut nier que si l'auteur avait appliqué les forces de son intelligence à spéculer, à labourer, à planter, à bâtir, il aurait pu ainsi accroître le patrimoine de ses enfants pendant cette période de la vie de famille où c'est au père et non aux enfants qu'est imposé le devoir du travail, et lorsque le bas âge de ceux-ci les laisse hors d'état de se suffire à eux-mêmes. Mais que l'on y fasse attention ! les meilleures vérités s'altèrent et se ruinent lorsqu'on les exagère. Il faut que le travail des pères profite aux enfants ; mais il ne faut pas, en accordant un droit de propriété indéfinie sur des objets dont l'essence n'exige pas qu'ils demeurent à jamais appropriés à des détenteurs exclusifs, faire dire que le travail des pères a pour résultat de favoriser, sans terme ni limites, l'oisiveté des enfants au détriment de la société tout entière. Étendre les transmissions par voie d'hérédité au-delà des cas où l'hérédité est indispensable, c'est aller plus loin que consolider là propriété, c'est fonder la noblesse, c'est élever, sur les ruines du droit commun, des exceptions et des faveurs que notre ordre social repousse.
Concluons de tout ce qui précède, que, dans la nature des créations dues aux travaux des auteurs, n'existe pas ce caractère appropriable qui a pour condition et pour conséquence la perpétuité de transmissions indéfinies.
Ici se place une objection trop fréquemment renouvelée pour qu'elle ne mérite pas une attention sérieuse. S'agit-il réellement de la pensée elle-même : on concède facilement qu'elle est inappropriable. Mais, ajoute-t-on, il existe, outre la pensée, dans les productions de l'intelligence, une autre création de l'auteur. Quand un manuscrit, un tableau, un livre ont, en prenant un corps, marqué du sceau de leur forme une certaine portion de la matière, ce papier, cette toile, ces couleurs sont devenues Athalie ou la Transfiguration. Ce livre matériel, ce corps du tableau sont susceptibles de propriété. Pourquoi cette propriété ne réunirait-elle pas les caractères de celle de tout autre objet appropriable ?
Cette objection repose sur une confusion entre le livre matériel et le contenu intellectuel du livre. Un poète crée des vers. Le papier qui en matérialisera l'émission, les cent mille exemplaires qui les reproduiront, seront susceptibles d'être la propriété d'un individu, ou de mille, ou de cent mille. Mais ce qui n'est pas appropriable, ce sont les vers eux-mêmes ; c'est la faculté, pour chacun, de les identifier à son intelligence ; c'est la possibilité de les reproduire, en les récitant, en les écrivant. La pensée, la faculté de l'émettre, la puissance de la reproduire ne doivent pas être confondues avec ces portions de matière qui sont devenues des livres et dont personne ne vous enlèvera la propriété, alors même que tout le monde reproduirait des livres semblables et reporterait sur d'autres objets matériels l'émanation de la même pensée. L'intelligence qui, la première, a combiné, a créé cette pensée, ne possède pas physiquement pour sa matérialisation une force plus énergique, une aptitude plus spéciale que toute autre intelligence, qui, après l'avoir appréhendée et comprise, sera aussi pleinement maîtresse de la reproduire matériellement que si elle en était la créatrice. Pour que j'imprime à telle ou telle portion de la matière la forme de cette pensée dont je ne suis pas l'auteur, mais, qui en tombant sous l'aperception de mon intelligence, a pénétré son essence intime, je n'ai désormais besoin ni de l'auteur, ni de personne. Une loi positive, une convention particulière peuvent, à cet égard, borner on supprimer mon droit ; mais, si une loi me lie, si une convention m'enchaîne, elles m'ôtent une faculté naturelle qui, sans la prohibition formelle d'une loi ou d'une convention, m'appartiendrait aussi pleinement qu'à vous.
La représentation matérielle de la pensée de l'auteur a donné naissance à une valeur vénale et exploitable : cela est vrai ; et ce n'est pas un des moindres titres des bons écrivains à la reconnaissance publique que cette création de nouvelles valeurs ajoutées, par la puissance de leur intelligence, à la masse générale des richesses. Mais est-ce à dire que l'élément spirituel qui entre dans la composition de ces valeurs soit appropriable ? Non sans doute. Il y a plus : à ne considérer les livres que dans leur existence matérielle, et sous des rapports purement industriels et économiques, on reconnaîtra que le rôle essentiel et nécessaire de l'élément spirituel dans la création de leur valeur, se borne à assurer le recouvrement des frais de fabrication et de vente ; frais perdus si le livre, rebuté du public, n'a occasionné qu'une déperdition d'industrie, et un avilissement de matières premières par la conversion de papier blanc en papier imprimé. Une analyse, tant soit peu sévère, de ce qu'est dans un livre la partie lucrative et vénale, en établissant cette proposition, démontrera qu'une part quelconque de bénéfice pour l'auteur ne peut entrer dans le prix d'un livre, qu'autant qu'elle y est volontairement introduite par un effet de la loi.
Pour publier un livre, il faut un matériel d'imprimerie, des caractères, des presses, de l'encre ; il faut du papier ; il faut des ouvriers pour mettre ce matériel en œuvre ; un entrepreneur pour surveiller, loger, payer ces ouvriers ; une direction pour soigner la correction du livre et la beauté typographique de son exécution ; il faut assembler, plier, coudre, brocher, relier l'édition ; l'emmagasiner, la faire connaître, la vendre. Chacune de ces opérations exige l'intelligence et l'habitude d'industries spéciales et des avances de fonds. La vente totale de l'édition doit donc faire rentrer les fonds employés, en rembourser les intérêts et payer aux entrepreneurs un profit, un prix pour l'emploi de leur intelligence et de leur temps, pour le service de leurs capitaux et pour les risques courus. Si un éditeur élevait au dessus de ces dépenses nécessaires le prix d'un livre que toute personne est maîtresse de réimprimer, la libre concurrence amènerait aussitôt un autre éditeur qui, en donnant le livre à un moindre prix, obtiendrait la préférence auprès des acheteurs.
Quant à la valeur intellectuelle du livre, son effet est d'assurer la rentrée des capitaux employés ; mais ce qui prouve qu'elle ne figure pour rien parmi les éléments du prix, c'est que, plus le livre méritera la faveur publique et sera d'un sûr débit, plus on pourra en baisser le prix. Imprimez un Campistron et un Racine ; à coup sûr, vous serez obligé de vendre Campistron plus cher ; non pas qu'il ait plus de valeur littéraire, mais tout au contraire, parce qu'il en a moins. Le débit étant moins sûr et devant être plus long, il faudra que le prix, pour procurer un bénéfice égal, soit chargé d'un risque de non-vente beaucoup plus fort, d'un plus long service de capitaux, d'un plus long retard d'intérêts. Ajoutez à cela que l'excellence même de Racine, en en multipliant les éditions, oblige de se restreindre à la plus faible part possible de bénéfice pour soutenir la concurrence.
Voilà ce qui se passe lorsqu'un livre est de domaine public, ou, en d'autres termes, lorsqu'il n'y a de prix à payer à personne pour acquérir le droit de l'imprimer et de le vendre ; la valeur spirituelle du livre est commercialement égale à zéro, et l'effet inévitable de la concurrence est d'effacer tous les éléments de prix autres que ceux de l'exploitation matérielle.
Pour qu'il en soit autrement, il faut qu'il s'agisse d'un livre réservé au domaine privé ; car alors les dépenses et bénéfices de l'exploitation matérielle ne sont plus les seuls éléments du prix. Un autre s'y ajoute : c'est le paiement à l'auteur pour chaque exemplaire livré au public. Il faut que le public paie ce supplément du prix, tant qu'existe un droit exclusif respecté dans la personne de l'auteur ou de ses ayant-cause.
C'est une lourde erreur de croire qu'il existe sur cette question conflit d'intérêts entre les auteurs et les libraires. Lorsqu'un livre est de domaine privé, le bénéfice du droit exclusif se partage entre l'auteur et le libraire, qui a, par conséquent, intérêt à l'existence de ce droit exclusif. La dévolution d'un livre au domaine public confère, il est vrai, à tous les libraires le droit de l'imprimer ; mais sous la condition de la libre concurrence, qui, de toutes les causes d'abaissement de prix, est incontestablement la plus efficace.
Si, dans l'état actuel de notre législation, on tombe dans un non-sens lorsque l'on se persuade que ne payer aucun prix ni à l'auteur ni à ses représentants c'est faire un cadeau aux libraires, il est juste de remarquer qu'il n'en a pas toujours été ainsi. C'était réellement d'un débat sérieux entre les auteurs et les libraires qu'il s'agissait, lorsque le droit d'imprimer et de vendre était, pour les commerçants qui se livraient à cette industrie, l'objet de privilèges exclusifs. Il fallait ajouter alors au prix d'exploitation matérielle, non seulement un prix pour l'auteur, mais aussi une sorte de redevance attribuée à une profession privilégiée et organisée en corporation. De là une charge exorbitante pour le public. Les auteurs avaient grandement raison, lorsqu'au privilège factice des libraires, fondé sur les limitations, toutes conventionnelles, qui entravaient le libre exercice des professions, ils opposaient les réclamations d'un droit sur leur œuvre, droit fondé sur la justice et le travail ; mais leur erreur commençait lorsque, afin de soutenir leur thèse, ils cherchaient à assimiler leur droit sur leurs œuvres à un droit véritable de propriété. L'erreur est devenue plus saillante et plus grave depuis qu'il n'y a plus de libraires privilégiés.
Ce qui existait alors, par suite de l'organisation de la librairie, peut se comprendre par la comparaison avec ce qui existe aujourd'hui relativement aux ouvrages dramatiques. Dans l'exploitation par représentation théâtrale, il ne faut pas seulement que le public, s'il veut jouir de la représentation, paie les frais, risques et bénéfices de l'entreprise théâtrale. Il ne suffit pas qu'il y ajoute le prix moyennant lequel l'auteur accorde le droit de représenter son ouvrage. Il faut encore que le public paie, au nombre des éléments du prix, une somme quelconque qui corresponde, dans une certaine proportion, à la valeur du privilège du théâtre. Si la liberté des théâtres existait, ce dernier élément cesserait d'entrer dans le prix des représentations dramatiques.
La conclusion des observations qui précèdent est que la faculté de copie des produits intellectuels, tant qu'elle demeure libre et universelle, ne comporte aucune valeur vénale. Elle n'acquiert cette sorte de valeur qu'en devenant un droit réserve. De sa nature et en l'absence de lois restrictives, elle est universelle, illimitée, inappropriable comme la pensée elle-même.
La pensée publiée n'est susceptible d'être copiée et reproduite que parce qu'elle a été émise. De là les partisans d'une propriété littéraire tirent cette conséquence que, parce que l'auteur, avant d'émettre sa pensée, en était le maître absolu et pouvait ne pas la livrer au public, il peut également, en la donnant au public, faire ses conditions, donner une partie de la jouissance et s'en réserver une autre, céder à tous la jouissance intellectuelle et garder pour lui seul le droit d'exploitation commerciale, le domaine utile. C'est ainsi, ajoute-t-on, que le propriétaire d'un immeuble peut aliéner en partie et en partie retenir les droits qui lui appartiennent. Il peut, par exemple, aliéner le droit d'habitation, celui de culture, et retenir le droit de chasse.
Cette argumentation repose sur l'erreur que nous avons déjà signalée et qui consiste à confondre deux objets de droit, objets dont la dissemblance modifie la nature du droit lui-même. L'émission de la pensée ne saurait avoir lieu que par sa réalisation sous une forme matérielle quelconque, la parole, la peinture, l'écriture. Si l'auteur veut faire connaître sa pensée, il faut absolument qu'il la livre ; cette pensée, une fois livrée, pénètre les intelligences auxquelles elle parvient, non parce que l'auteur y consent, mais par cela seul qu'il l'a émise. Il n'est pas possible que d'autres conditions soient faites. Donner et retenir la pensée est une impossibilité, un non-sens ; et nul n'est maître de diviser, par la puissance de sa volonté, ce qui, par nature, est indivisible. Il n'y a pas d'hypothèse de raisonnement qui puisse prévaloir contre une aussi évidente réalité.
En résumé, la pensée est, par son essence, inappropriable ; la faculté de copier et de reproduire la pensée ne l'est pas moins.
§ VI. L'expression de propriété littéraire doit être rejetée de la langue juridique.
Ce n'est pas une question de faible importance que celle du bon emploi des mots ; lorsqu'ils sont confus ou mal faits, l'obscurité ou le désordre s'introduisent dans les idées dont ils sont les signes. Je ne crains pas de dire que les préjugés qui obscurcissent la matière qui nous occupe trouvent leur principale force dans le droit de bourgeoisie que les écrivains, partie intéressée dans cette querelle, ont fait prendre à l'expression de propriété littéraire, à la faveur de laquelle ils ont habitué les esprits à leurs prétentions.
Dans son sens primitif, propriété veut dire ce qui est propre, particulier à telle personne, à telle chose ; ce qui tient à leur essence ; ce qui les distingue de toute autre chose, de toute autre personne. Ainsi, le propre de l'homme est d'être libre ; le propre de l'animal est de sentir, croître et se mouvoir ; le propre de la matière est d'être étendue, divisible : en d'autres termes, la liberté est une propriété de l'homme ; le sentiment et la locomotion sont des propriétés de l'animal ; l'étendue, la divisibilité sont des propriétés de la matière. Dans ce sens, il est très vrai de dire que la pensée est la propriété de l'homme, que les pensées de chaque homme sont sa propriété.
Mais ce n'est pas suivant cette acception rigoureuse et primitive, c'est en vertu d'une extension donnée au langage par l'analogie, que notre champ, notre maison, notre vêtement, notre livre, sont appelés notre propriété. Ces objets-là ne nous sont pas propres, ils nous sont appropriés. L'influence de la langue a modifié à tel point la signification originaire des mots, que les seuls objets dont on dise l'homme propriétaire sont les objets matériels extérieurs à lui, qui ne font pas une partie de sa personne, mais se trouvent accidentellement attachés à lui par pure appropriation. On ne dit pas qu'un homme est propriétaire de sa liberté, un animal de sa locomotion ; que le feu est propriétaire de la chaleur, la matière de la divisibilité. On n'est dit propriétaire que des objets sur lesquels c'est par appropriation que l'on a droit.
Si le mot de propriétaire n'a qu'un sens, celui de propriété en a retenu deux. Toutefois, quand on parle de la propriété comme d'un objet de droit, ce mot, dans le sens légal et juridique, ne désigne que le droit exclusif dérivant de l'appropriation : c'est de la propriété ainsi entendue que les lois s'occupent. L'expression propriété, prise comme désignation des qualités et de l'essence intime de l'être, n'a point place dans la langue du droit.
La pensée de tout homme lui est propre. Si nous sommes parvenus à démontrer que cette pensée, une fois émise au dehors, ne sera pas susceptible d'appropriation, il s'ensuit que le droit de propriété, dans l'acception légale de ce mot, pourra s'appliquer à la portion ou aux portions de la matière auxquelles la forme de la pensée aura été imprimée, et, par exemple, à tel volume, à tel tableau, mais ne s'entendra jamais de la pensée elle-même, non plus que de la faculté de la copier, de la reproduire, d'en imposer à une portion de matière le sceau et la forme.
L'expression droit de copie, employée par les Anglais et les Allemands, est beaucoup plus juste. Elle ne confond, ni l'émission première de la pensée avec sa reproduction, ni la propriété matérielle de chacun des exemplaires d'un ouvrage avec la possession intellectuelle de leur contenu. Elle ne fait nul obstacle à l'établissement plus ou moins étendu des droits que les lois peuvent garantir à l'auteur.
L'expression propriété littéraire confond toutes ces idées. Nous négligeons les justes critiques dont le mot littéraire serait susceptible. Nous ne nous sommes attachés qu'à démontrer le vicieux emploi du mot propriété, parce que c'est le mot important, et parce que la langue du droit ne saurait ici l'admettre, sans le fausser, et sans lui faire faire divorce avec les caractères essentiels de transmissibilité, de perpétuité, d'inviolabilité qui doivent toujours en demeurer inséparables.
§ VII. Un livre est la prestation d'un service envers la société.
Un livre est un écrit par lequel l'auteur adresse la parole au public ; un usage qu'il fait de ses facultés pour mettre en circulation les conceptions de son esprit ; c'est un service qu'il rend à la société en lui communiquant ses pensées.
Cette définition est de Kant, qui prend soin d'expliquer qu'en s'exprimant ainsi il parle, non de l'exemplaire matériel du livre, muet instrument de la communication avec le public, mais du livre lui-même, mais de son contenu, mais de sa parole.
Quant à la création de nouvelles richesses par la faculté de convertir en livres certaines portions de matière dont cette conversion pourra accroître l'utilité, c'est encore là un service dont la société est redevable à l'auteur.
§ VIII. L'auteur a droit à recevoir de la société un juste prix de son service.
Le respect pour la propriété est l'une des bases de l'ordre social ; mais ce n'est pas la base unique sur laquelle l'ordre social repose.
Une portion quelconque de propriété matérielle est indispensable à la vie de chaque homme. Tous ont besoin d'être propriétaires d'aliments pour se nourrir, de vêtements pour se couvrir, d'abris pour se loger.
Il est donné à quelques hommes de naître pourvus de biens ; d'autres, et c'est le plus grand nombre, ne gagnent qu'à grande peine, et à mesure de leurs besoins, ce qu'il faut de propriété aux nécessités de la vie.
Cette inégale distribution des biens est un résultat de la liberté ; mais la loi providentielle qui, par les conséquences médiates ou immédiates, et toujours nécessaires, de la liberté, conduit le monde à l'inégalité des biens, cette loi nous est cachée. Notre ignorance, qui la croit aveugle, l'appelle hasard. Ceux qui se confient à la bonté divine respectent la règle inconnue dont Dieu s'est réservé le secret, et en vertu de laquelle il choisit celui-ci pour naître riche, celui-là pour naître pauvre, de même qu'il fait arriver telle ou telle âme dans un corps valide ou dans un corps faible, à un pôle plutôt qu'à l'autre.
Entreprendre de créer l'égalité des biens, ce serait une témérité à laquelle la plus dure et la plus folle des tyrannies ne s'exposerait pas. Ni la terre ne peut advenir en lots parfaitement égaux à chacun des individus de l'espèce humaine ; ni les richesses mobilières ne peuvent, par un perpétuel équilibre, balancer également entre tous leurs distributions et leurs mesures ; l'essence finie et limitée des objets appropriables, ainsi que les accidents innombrables de leur transmission, tendent à les concentrer dans un nombre de mains infiniment petit eu égard à la population générale. Mais si les lois humaines n'ont pas la mission impossible de détruire celle inégalité, elles ont le devoir difficile et qui nulle part n'est strictement observé, de ne pas l'encourager et l'accroître. Elles auront assez à faire en s'imposant la règle de détruire les obstacles factices qui, arrêtant l'essor de l'activité individuelle, augmentent et aggravent les inégalités naturelles, ou leur substituent le joug plus pesant des inégalités conventionnelles.
Il est une force dont la puissance vient, sinon rétablir l'équilibre parfait, du moins répandre sur les hommes assez de propriété pour assurer la subsistance de tous. Cette force naît de la liberté et de l'activité humaine : c'est le travail.
Si la propriété n'était pas respectée, le plus horrible chaos succéderait à l'ordre social. Mais le monde ne serait pas moins impossible, si, à côté de ce respect, ne venait se placer un principe, non moins sérieux, non moins fondamental, celui en vertu duquel chacun doit au travail des autres un salaire proportionné à l'utilité que lui-même en retire.
La propriété toute seule ne suffirait à la vie d'aucun homme. Ce n'est pas tout que d'avoir un champ ; il faut encore que, par soi-même ou par d'autres, on laboure, on sème, on recueille, on s'approvisionne. La propriété sans travail serait la matière inerte, improductive, morte ; ce serait le repos absolu.
Le travail à son tour ne serait rien à lui seul. Ne faut-il pas que ce soit dans le service des choses matérielles que l'homme prenne ses aliments, ses vêtements, ses jouissances physiques ? Sans la possession de la matière, sans la propriété qui est le droit de perpétuité dans cette possession, le travail n'aurait ni objet ni ordre : ce serait un tumulte, un combat, un chaos.
La propriété qui est le repos, le travail qui est le mouvement, doivent donc coexister. Sans leur harmonie, point de vie humaine. Ce que réclame le travail, c'est liberté d'abord, puis paiement ; la propriété n'a droit ni à récompense ni à salaire, mais à inviolabilité.
La loi qui veut que tout travail reçoive son salaire est corrélative à celle qui veut l'inviolabilité de la propriété : chacune d'elles sert à l'autre de garantie et de sanction. L'échange entre la propriété et le travail, s'il ne va pas jusqu'à établir l'égalité entre les hommes, doit, du moins, créer pour tous la possibilité de vivre. Une société n'est bien organisée qu'à celle condition.
À quelle classe appartiennent les auteurs ? On connaît déjà notre réponse. Nous ne les comptons point parmi les privilégiés de la Providence auxquels il a été donné de détenir un peu de ces choses matérielles que quelques-uns possèdent exclusivement à tous. Leur place, et c'est là leur gloire, est à la tête de ceux qui vivent en échangeant leurs travaux et leurs services contre les objets matériels dont d'autres hommes avaient la propriété.
Il faut que ce travail, comme tout autre, reçoive son salaire, et qu'un prix matériel le récompense.
Ce sont les idées qui gouvernent le monde ; c'est par elles que l'humanité s'améliore, que le sort des individus s'agrandit, que l'empire de l'intelligence s'étend sur les forces de la nature.
Récompensez les auteurs ; payez-leur la dette sociale. Nous n'avons en rien infirmé la sainteté de cette dette lorsque nous avons démontré que la production des idées, que la faculté de les reproduire, n'est pas un objet de propriété. L'auteur, en émettant des pensées qui pourront marquer leur sceau sur la matière, a permis à l'industrie de fabriquer des livres et de créer ainsi des objets appropriables, destinés à accroître des richesses individuelles ; en dotant l'humanité d'une nouvelle combinaison de pensées, il a fait bien plus encore ; il a grossi le trésor commun des idées qui, sans être propre à tels individus déterminés, est le vaste réservoir dans lequel tous pourront puiser, et qui ne fera que s'accroître par cela même que l'on y puisera davantage. Priver un travailleur quelconque de son salaire, c'est toujours une injustice. En priver un auteur, le premier des travailleurs, l'artisan du premier des biens de l'humanité, d'une circulation des idées plus étendue, plus rapide, plus complète, ce serait une ingratitude ; ce serait, par le plus imprévoyant des calculs, frapper de stérilité la mine la plus abondante des richesses, la source de toutes les richesses ; ce serait un trouble social.
IX. La garantie d'un droit exclusif de copie sur la reproduction de l'ouvrage est le meilleur mode de salaire de la société envers l'auteur.
Longtemps on a cru que les écrivains et les artistes devaient être payés par des pensions et des faveurs. C'étaient en quelque façon l'État et les princes qui acquittaient ainsi la dette du public, et en même temps que l'on ne se faisait nul scrupule d'accepter ces faveurs, on était facilement disposé à rougir du paiement à tirer du public par la vente de son droit de copie sur ses propres ouvrages[8]. Une partie des idées a bien changé. Aucun préjugé défavorable ne s'attache à flétrir la vente qu'un auteur fait de ses œuvres. Tout au contraire, une réaction s'est opérée. L'industrie s'est mêlée à la littérature, et a trop souvent pris sa place. Les pensions et les faveurs n'ont pas cessé ; mais elles ont été reléguées à un rang accessoire et secondaire. Les littérateurs n'ont plus comme autrefois une existence à part, qu'ils tiennent des princes et des grands, dont la libéralité leur faisait de paisibles loisirs, et auxquels, en échange, ils donnaient des louanges et quelquefois de la gloire. Les lettres mènent à la fortune, jettent dans les affaires et les honneurs.
L'observateur moraliste aurait à dire sur cette révolution mêlée de biens et de maux. Dans l'ordre actuel, comme dans la vie littéraire ancienne, les passions grandes ou mesquines, les instincts généreux ou cupides, le calcul et le désintéressement ont leur action et leur rôle. Mais, somme toute, les idées sont mieux à leur place. Vivre du tribut volontaire que le public s'impose ne rabaisse aucune position, ne messied à aucun génie.
D'insurmontables difficultés s'élèvent contre tout mode de paiement qui procéderait par voie de pensions, de traitement fixe, ou même, sauf quelques exceptions très rares, par prix d'achat, une fois payé, achat qui prendrait la forme d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'auteur n'était pas laissé maître de s'y refuser. Avec de telles formes de salaire, la justice distributive serait impossible ; et il n'est pas de trésor qui pût suffire aux insatiables prétentions, aux faveurs capricieuses, aux concussions faciles auxquelles on ouvrirait une large porte. Qui donc si, par exemple, on adoptait le procédé d'expropriation pour cause d'utilité publique, déclarerait cette utilité et apprécierait les travaux ? qui calmerait les rivalités ? qui ferait justice de la médiocrité ? qui inventerait des récompenses dignes du génie, sans soulever l'envie ? qui irait au devant du mérite fier ou modeste ? Attribueriez-vous au gouvernement l'estimation des ouvrages à acheter dans l'intérêt public ? et ne voyez-vous pas à quels périlleux soupçons, à quelles intrigues subalternes, à quelles corruptions habiles, à quels profits honteux vous exposez l'administration, sans parler de toutes les erreurs auxquelles elle ne saurait échapper ? Ferez-vous évaluer les ouvrages des écrivains par leurs pairs ; et, si désintéressée, si modeste, si impartiale que soit toute la littérature, oserez-vous ne vous en rapporter qu'à elle seule dans sa propre cause ? Trouverez-vous dans des magistrats, dans des jurés, les habitudes d'esprit et la spécialité de lumières indispensables pour une si hasardeuse décision ? Pour moi, je n'aperçois de toutes parts qu'inconvénients, qu'impossibilité. Il n'est qu'un seul juste appréciateur du salaire dû aux écrivains et aux artistes : le public. Il n'est qu'une seule appréciation juste : celle que le public, sans la formuler, mesure sur l'utilité et le plaisir qu'il tire d'un ouvrage. Un seul mode de paiement me paraît juste et possible : c'est celui qui attribue à l'auteur, sur chaque édition ou sur chaque exemplaire de son ouvrage, un droit de copie.
Ce moyen est celui que l'expérience a fait reconnaître comme le plus simple ; c'est aussi le plus équitable ; car, en général, l'évaluation la plus judicieusement approximative de l'utilité d'un livre consiste dans le succès qu'il obtient.
Il résulte de l'adoption de ce moyen que le salaire de l'auteur se trouve très subdivisé, et que le prix de chaque exemplaire s'augmente de la part qu'il supporte dans la valeur générale assignée à l'objet de la copie.
Sans doute, ce renchérissement est un inconvénient ; car les livres à bon marché sont des propagateurs d'idées plus rapides, plus puissants, plus actifs que ceux dont le prix est élevé. Mais il n'y a pas de paiement pour les auteurs, si l'on n'a, par une voie quelconque, recours au public pour le fournir. Renchérir un livre, parce qu'il faut acquitter le droit de copie, c'est établir une sorte d'impôt. Or, un impôt, quoique offrant toujours en lui-même des inconvénients pour le public, se légitime par sa destination, lorsqu'il rend, en dépenses générales, en sécurité individuelle, en garanties efficaces, plus que ce qu'il ôte à chaque contribuable. C'est acheter trop cher l'abaissement du prix d'un livre que de ne pas payer l'auteur, que de le sacrifier à ses travaux, que de le décourager et de le jeter dans l'avilissement par la misère. Le livre coûtera un peu plus, mais il verra le jour, mais on ne l'aura pas étouffé avant sa naissance ; mais surtout on n'aura pas été injuste envers celui à qui on le doit. Dire que l'on aimerait mieux passer un pont, un canal, sans rien payer, que d'en rembourser les frais par un péage ; que l'on aimerait à être gardé par une armée, sans payer les soldats ; jugé par les tribunaux, sans payer de juges ; instruit ou récréé par un auteur, sans payer son travail ; par un libraire, sans payer les frais de vente ; par un imprimeur, sans payer les frais de fabrication ; par un laboureur, sans payer sa culture et son blé, ce serait la prétention étrange de tout prendre dans la société sans y rien mettre, et d'exploiter nos semblables, comme s'ils n'étaient pas égaux à nous ; ce serait le renversement de toute idée sociale.
Cet impôt au profit de l'auteur sur son ouvrage peut se percevoir de deux manières. L'une consiste à interdire à tout autre qu'à l'auteur ou à ses ayant-cause, la faculté de fabriquer l'ouvrage et de le vendre ; l'autre serait de laisser à chacun pleine liberté de fabriquer et de vendre l'ouvrage, mais à la charge de payer une certaine rétribution à l'auteur. Le premier système établit un privilège, le second une redevance.
Le second système peut de prime abord séduire. Beaucoup de personnes qui ne renonceraient qu'avec peine à voir dans le droit de copie un objet de propriété, auraient volontiers recours aux redevances, pour conserver par une sorte de suzeraineté qui pourrait indéfiniment s'étendre, quelque image d'une propriété indéfiniment transmissible. Là se place à l'aise l'ordre d'idées qui, faisant deux parts de la partie spirituelle et de la partie lucrative de chaque ouvrage, livre au public la jouissance de la première, et ne retient parmi les biens vénaux et exploitables que la seconde.
Ne nous occupons pas encore des objections qu'il y aurait à faire, soit à la très longue durée, soit à la perpétuité d'une redevance. Ces arguments s'appliqueraient également à la trop grande extension que l'on essaierait de donner à la durée des privilèges. Examinons les inconvénients inhérents au mode de redevance considéré en lui-même.
Ce qui le rend inadmissible, c'est l'impossibilité d'une fixation régulière, et l'excessive difficulté de la perception.
Peut-être, à force de soins, surmonterait-on les obstacles à la perception ; mais, quant à la fixation de la redevance, le règlement en est impossible.
Cette fixation ne peut dépendre ni de la volonté arbitraire de l'auteur, ni de l'évaluation que jugerait à propos de faire toute personne qui voudrait user du droit de copie. S'en rapporter à l'appréciation du débiteur de la redevance est une absurdité manifeste ; mais il serait absurde, au même degré, de s'en remettre au prix que demanderait l'auteur. Que serait-ce, en effet, autre chose que de lui conférer le privilège d'exploitation ? Il vaudrait mieux mille fois lui attribuer usuellement le monopole sur son ouvrage que d'arriver au même résultat par cette voie détournée.
Demandera-t-on à la loi de déterminer une redevance fixe ? mais quoi de plus injuste qu'une mesure fixe, rendue commune à des objets essentiellement inégaux ? Prendrait-on pour base le nombre des exemplaires, l'étendue du volume, son prix de vente ? mais il est des ouvrages dont cent ou cinq cents, ou mille exemplaires suffiront à jamais à la consommation, tandis que d'autres se débitent par dix et cent mille ; mais l'étendue du volume varie avec tous les caprices de la fabrication ; mais le prix est plus variable encore. Sans parler des hausses et des baisses dont personne n'est maître, sans parler de l'extrême facilité des fictions dans les prix, et de l'impossibilité de les constater, ne sait-on pas que l'on fabrique des Télémaque à vingt sous, et d'autres, qui ne seront pas trop chers, à cent ou deux cents francs ? Avec le texte qui ne varie point, il faut parler du papier, des caractères d'impression, des soins typographiques, des ornements accessoires de gravure ou autres, objets tous variables à l'infini. Si votre redevance a pour base une valeur proportionnelle, chaque Télémaque de deux cents francs produira, pour le seul droit de copie, plus que ne vaudra, dans l'autre édition, chaque exemplaire tout fabriqué ; et cependant ce sera toujours le même texte qui n'aura pas plus de valeur intrinsèque dans un cas que dans l'autre.
Resterait un dernier mode de fixation ; il consisterait, en cas de désaccord entre le débiteur de la redevance et l'auteur, dans un règlement par experts, variable suivant les circonstances. Mais qui ne voit tous les frais, tous les délais, tous les procès auxquels chaque affaire donnerait lieu, pour n'être, la plupart du temps, que très capricieusement décidée ?
Le raisonnement juge cette question comme l'expérience l'a tranchée. L'exclusion de tout autre système acceptable conduit, par la logique, à l'adoption de privilèges destinés à garantir le monopole d'exploitation, soit à l'auteur seulement, soit à l'auteur et à ses ayant-cause. Toutes les législations actuellement en vigueur en adoptant ces privilèges ont voulu qu'ils fussent temporaires. Les motifs pratiques de cette opinion ont été indiqués par la haute intelligence de Napoléon dans une discussion du conseil d'état[9].
Privilèges, monopoles ; ces mots sonnent mal : les mots de propriété littéraire recommandent bien mieux une opinion. Si je disais que cette différence dans les mots n'a pas été sans influence sur le succès divers des deux systèmes, les lecteurs sérieux trouveraient cette remarque bien futile ; elle est futile en effet ; mais elle est vraie, et des personnes, tenues pour graves, s'imaginent qu'elles argumentent parce qu'elles s'écrient : Quoi ! vous attaquez la propriété, au nom du privilège et du monopole ! Je n'aurais point entendu ce propos que j'y aurais cru d'avance. Que d'opinions se déterminent par des mots !
J'ai défini la propriété. Quant à la définition du privilège, tout le monde la connaît : c'est une loi privée, privata lex. Ai-je besoin d'ajouter, d'une part, qu'il existe des privilèges parfaitement légitimes ; et, d'autre part, que souscrire au dogme de la propriété littéraire, c'est décider, d'un mot, que le monopole des productions de l'intelligence sera concentré, à perpétuité, entre un petit nombre de privilégiés.
§ X. Des privilèges perpétuels détruiraient les droits qui appartiennent à la société.
Accorder à l'auteur, à titre de rémunération de son travail et par une concession de la loi, la perpétuité de monopole, qui existerait par elle-même si le droit qui appartient à l'auteur lui était dévolu à titre de propriétaire, ce serait arriver par une autre voie, à des effets identiques avec ceux du droit de propriété.
L'on a pu voir que, jusqu'ici, j'ai cherché à démontrer que le droit des auteurs diffère du droit de propriété, en étudiant l'un et l'autre de ces droits dans leur nature et dans leur cause.
Il est temps maintenant de considérer les effets. Ceux qui découleraient de l'adoption de la théorie d'une propriété littéraire étant absolument les mêmes que ceux que produiraient des privilèges perpétuels, je ne les séparerai pas dans ce que j'ai à en dire.
La perpétuité de transmission, soit du privilège, soit de la propriété, renchérirait les livres et les exposerait à périr.
Le renchérissement perpétuel des livres, la destruction absolue de toute concurrence, pour le présent et pour l'avenir, en ralentissant la circulation des idées, porteraient aux progrès sociaux un mortel préjudice. La société n'y perdrait pas seule ; la gloire de l'auteur et de sa mémoire en serait amoindrie ; son vœu le plus cher et le plus noble, celui de la propagation de ses idées, serait compromis et trompé. Pour payer un plus haut prix à l'auteur, on restreindrait l'influence de son service ; on diminuerait, avec l'utilité de l'ouvrage, la justice de la récompense ; on affaiblirait son titre de créance sur l'humanité, par les mesures mêmes que l'on prendrait pour en exagérer la valeur. Le renchérissement momentané qu'amènent les privilèges temporaires a ses inconvénients, mais s'explique par la nécessité : la perpétuité du renchérissement serait un mal sans remède.
En dépassant ainsi le but, on courrait grandement le risque de le manquer et de nuire aux intérêts même que l'on aurait l'intention de servir ; les besoins de la consommation générale et la nécessité de la diffusion des bons ouvrages multiplieraient les contrefaçons, qui deviendraient le seul correctif du monopole perpétuel ; une connivence publique excuserait un délit dont le public profiterait, et qui cependant ne peut pas plus que les autres être toléré sans péril et sans habituer l'opinion au mépris des droits privés et des lois. Une prime, toujours ouverte, en faveur de l'industrie étrangère, écraserait la librairie nationale et détruirait tous les profits attachés aux droits d'auteurs, pour n'enrichir que la fraude. Quand le privilège n'est que temporaire, le sacrifice est plus court, sa justice est évidente ; et cependant il ne se garde que par la plus active surveillance. Que serait-ce s'il ne devait jamais prendre fin ?
Invoque-t-on, à l'appui de la perpétuité des droits d'auteurs, l'avantage qu'il y aurait à encourager puissamment les écrivains, en leur montrant la perspective de la création d'un bien qui se transmettrait à toujours dans leur famille et qui ne permettrait plus que l'on eût à gémir de la pauvreté où sont exposés à tomber les descendants des grands hommes dont le génie a enrichi leur patrie et le monde ?
Je comprends que cet argument peut un instant émouvoir, et qu'il peut balancer, auprès de beaucoup d'esprits, le tort grave, le mal irréparable que ferait à la mémoire de l'auteur le renchérissement perpétuel de son livre. Mais, avant de se rendre à cet argument, que du moins on en mesure la portée. Pour le rendre efficace, il faudrait interdire les aliénations qui feraient sortir de la famille de l'auteur le droit sur son ouvrage, et ne les permettre aux auteurs eux-mêmes que pour un temps limité ; car ce serait là l'unique moyen d'éviter le spectacle d'une famille d'auteur indigente à côté d'un opulent cessionnaire. Passons sur ce qu'aurait d'étrange cette interdiction d'aliéner et cette dérogation à la législation commune. Le droit de l'auteur se divisera-t-il à l'infini entre tous ses héritiers ? Mais alors, pour peu que les générations se succèdent et que la famille prenne d'extension, avec qui traiteront les tiers ? comment réunira-t-on tant de consentements divers lorsqu'il faudra traiter ? qui entreprendra de trouver tant d'individus épars, de régler leurs intérêts respectifs, de mettre d'accord leurs volontés ? Ajoutez que, par l'augmentation successive du nombre des parties prenantes, la part de chacun s'amoindrira par des morcellements indéfinis et sera réduite à rien. Essaiera-t-on, pour éviter une partie de ces inconvénients, d'autoriser, conformément au droit commun, les licitations et les partages ? Mais que devient, dans cette hypothèse, le rêve de mettre pour toujours à l'abri du besoin le nom et le sang de l'homme de génie dont on veut que les ouvrages protègent à jamais tous les héritiers ? Il ne faut pas longues années pour que, dans une même famille, quelques branches soient ruinées à côté de branches opulentes. Une partie tout au moins des descendants d'un même père cesserait ainsi de profiter du fruit de ses travaux.
Pour arriver à un résultat et pour garantir la jouissance de l'ouvrage à un membre de la famille, il faudrait oser davantage et aller jusqu'à un système de franche substitution. Créez donc hardiment un majorat intellectuel. Donnez par droit d'aînesse une représentation puissante aux droits de l'auteur.
Toutes ces hypothèses sont insensées. S'il arrive qu'un nom glorieux soit porté par des hommes condamnés à la misère, ce sont là des maux privés qui peuvent trouver des réparations. L'État peut se montrer généreux pour ces illustrations nationales, comme Voltaire pour la famille de Corneille. Ce ne sont pas là des considérations qui puissent autoriser à fausser un droit dans sa nature et dans ses conséquences. Si les droits d'auteurs étaient perpétuels, il faudrait qu'il entrassent dans le commerce, comme tous les autres biens, et rien ne pourrait empêcher que ce ne fut au profit de familles étrangères qu'ils grevassent le public de charges inconciliables avec les intérêts de la plus précieuse de toutes les consommations, celle des aliments de l'intelligence.
Lorsqu'un fils hérite du champ de son père, lorsqu'un acquéreur succède à son vendeur, lorsque enfin une propriété se transmet par quelque mode que ce soit, le nouveau propriétaire acquiert, dans toute leur plénitude, les droits qui appartenaient au propriétaire précédent ; maître absolu de sa chose, il peut en user ou n'en user pas, la conserver ou la détruire. Les ayant-cause qui succéderont soit à la propriété, soit au privilège de l'auteur seront donc à perpétuité les seuls propriétaires légitimes de tous les exemplaires du livre, dont pas un, à aucune époque, n'entrera dans le commerce, s'il n'est originairement sorti de leurs mains, ou de celles de leurs employés ou mandataires. Ici se manifeste la possibilité d'un immense danger ; ce n'est plus seulement la perte partielle du livre par son renchérissement, c'est une perte totale qui devient à craindre. Lorsque le cours habituel des transactions humaines aura amené un ouvrage dans les mains des spéculateurs en la possession desquels tous viendront se concentrer, lorsque, si même le privilège ne sort pas de la famille, l'éloignement des générations aura affaibli ou effacé le culte pieux du nom paternel, le sort de l'ouvrage se trouvera livré à tous les calculs de l'indifférence. Que l'on ne dise plus désormais qu'une pensée émise ne peut ni ne doit se détruire, et est acquise à l'humanité. Non seulement il deviendra loisible à l'avarice de tout héritier de paralyser la circulation de l'ouvrage, non seulement son avidité pourra impunément en ralentir, en renchérir la propagation, mais encore, pour un peu d'argent, tout parti puissant, tout gouvernement ombrageux, tout auteur rival, toute spéculation de concurrence seront maîtres de l'anéantir. L'héritier de Pascal aura pu se vendre aux Jésuites, et frapper d'interdit les Provinciales. Que l'on ne tienne plus compte de cette dette de tous les hommes qui doivent à la circulation les idées qu'ils ont empruntées d'elle, et qui ont à payer, à restituer au public ce que les plus grands génies, ce que les esprits les plus originaux doivent à leur siècle, aux siècles antérieurs, à leur éducation, à ce qu'ils ont vu et senti dans le monde, dans les livres et dans la conversation avec les grands esprits de tous les âges ! Les œuvres du génie n'appartiendront plus à l'humanité ; ils seront à jamais une marchandise que l'on pourra coter à la bourse.
Ces inévitables conséquences de la perpétuité suffisent pour faire écarter les privilèges perpétuels.
À elles seules aussi, et indépendamment de ce que révèle l'étude du droit de propriété, d'une part, et d'autre part celle du droit des auteurs, examinés et compris dans leur origine et dans leur essence, ces conséquences suffiraient pour condamner, par ses effets, le dogme d'une propriété littéraire. Si les théories entrent dans les convictions par l'examen de leurs causes, elles se jugent par leurs effets ; la pratique en est la pierre de touche, comme la théorie est la régulatrice de la pratique. Si le principe de propriété ne peut, quand on l'applique aux productions de la pensée, amener que des conséquences impossibles ou dangereuses ; il y a plus, s'il ne conduit pas à des résultats utiles à l'humanité et au bien-être social, on peut, par cela seul, affirmer hardiment qu'il n'est pas en cette matière le principe vrai ; car l'utilité, si elle n'est pas la base des systèmes, en est le contrôle ; autant il est certain qu'elle ne crée pas le droit, autant il faut croire à cette souveraine et sage harmonie qui, dans les lois par lesquelles est régie l'humanité, marie toujours le juste avec l'utile.
Considérée philosophiquement dans ses causes, la propriété littéraire serait une erreur ; envisagée pratiquement dans ses effets ce serait un mal social. Je sais bien que là se présente le souverain et bienfaisant remède des écarts de la pensée humaine et de son impuissance à saisir clairement la vérité : ce remède, c'est l'inconséquence. On ne voudra pas que les œuvres d'esprit périssent, et l'on obligera leurs propriétaires à les publier même malgré eux ; on ne voudra pas que leur prix soit inaccessible, et l'on déterminera des conditions de prix ; on ne voudra pas engager indéfiniment l'avenir, et l'on ménagera des éventualités de réversion au domaine public ; c'est-à-dire que l'on aimera mieux manquer à la logique qu'au bon sens, et pour conserver le mot de propriété on se montrera facile à sacrifier les conséquences nécessaires de ce droit.
Mieux vaut, sans doute, être illogique qu'insensé : mais il faut tâcher d'être logique, et abandonner une théorie quand ses résultats sont évidemment faux. C'est en procédant par des inconséquences que l'on répand le scepticisme sur les principes. Plus le respect pour la propriété joue un rôle important dans les sociétés humaines, plus il faut le préserver de ces extensions exagérées, qui, loin de fortifier ce grand principe conservateur, ne feraient que l'exposer au doute.
En résumé, voici une alternative de laquelle on ne sortira pas : ou bien on ébranlera le droit de propriété, en proclamant qu'il n'est inviolable et perpétuellement transmissible qu'en théorie et que l'on peut en détruire le principe par des exceptions, lorsqu'on en vient à ses applications pratiques ; ou bien on niera que la perpétuité, que l'inviolabilité soient les caractères essentiels de la propriété ; et alors sans doute on se chargera de lui trouver d'autres explications, d'autres conditions, d'autres bases, une autre nature.
Les difficultés s'évanouissent si, renonçant à confondre les idées pour agrandir les mots, on consent à reconnaître, dans la publication d'un livre, ce qu'il est si beau, si facile, si satisfaisant d'y voir : un service rendu. Les conséquences de la propriété, en affaiblissant le service, en l'exposant à périr, rendent au contraire le problème insoluble et empêchent d'obéir à la première de toutes les conditions qu'il faut poser pour la justice du paiement de l'auteur, la nécessité, en récompensant son travail, de maintenir intacts les droits de la société sur la jouissance des idées, pour la plus grande gloire de l'auteur et pour l'accomplissement même de son œuvre.
§ XI. Le privilège doit exister pendant toute la vie de l'auteur, et pendant un certain temps après sa mort.
En matière d'inventions industrielles, nos lois fixent à cinq, dix ou quinze ans le privilège des inventeurs.
C'est avec raison que nos lois assurent une durée plus longue au privilège des auteurs sur les productions de la littérature, des sciences, des beaux-arts.
On en peut donner un premier motif qui n'est cependant pas assez universellement vrai pour être invoqué comme décisif ; c'est qu'un livre, un tableau, donnant à leur auteur des profits moindres et plus lents qu'un grand nombre d'inventions industrielles, doivent lui profiter pendant plus longtemps.
Il faut reconnaître ensuite qu'une invention industrielle peut se rencontrer par plusieurs esprits à la fois. Elle n'est pas aussi individuelle qu'une création littéraire. L'état de la science, ses besoins, ses travaux antérieurs peuvent conduire presque inévitablement à des inventions sur lesquelles celui qui les découvre n'a souvent, en quelque sorte, qu'un droit de priorité.
Il est un motif qui, à lui seul, prouve que le privilège doit d'abord s'étendre à toute la durée de la vie de l'auteur.
L'œuvre littéraire engage au plus haut degré la personnalité, l'individualité de l'auteur. Une responsabilité morale, et même légale, s'attache à la publication d'un livre. La plus stricte justice commande de laisser l'auteur maître de l'émission de ses idées : rien ne doit faire obstacle à ce qu'il les reprenne, les complète, les retouche, les modifie. Il faut qu'il ménage et combine, ainsi qu'il le voudra, la publication des œuvres auxquelles sa renommée et sa conscience sont attachées, et qu'il demeure l'arbitre absolu de ses communications intellectuelles avec le public.
La justice ne s'arrête pas là ; et il ne serait pas équitable, même à l'égard de l'auteur, de borner la durée du privilège à celle de sa vie. Si le privilège était purement viager, et par conséquent d'une durée tout aléatoire, l'auteur conclurait difficilement les traités commerciaux nécessaires à la publication de son ouvrage. Dans tous les cas où une avance de fonds assez forte sera indispensable, il faudra que le spéculateur puisse compter sur une certaine durée de privilège, afin que, pendant ce temps, l'ouvrage se fabrique, se termine, s'écoule, et que les capitaux rentrent.
Ajoutons que, tout en maintenant au public une large part, il est nécessaire aussi de se montrer généreux envers la famille de l'auteur, et que des considérations fondées sur la plus rigoureuse justice exigent que le privilège appartienne à ses héritiers pendant un temps assez long pour leur être profitable. Il ne faut ni inféoder indéfiniment à une famille une propriété sans travail, ni interdire à l'écrivain dans ses veilles toute pensée d'avenir pour l'existence de ses enfants. Il faut qu'un chef de famille ne soit pas glacé au milieu de ses travaux par la pensée qu'ils demeureront inutiles à ceux dont le bonheur lui importe plus que le sien, et sur lesquels le plus impérieux devoir lui commande d'étendre une prévoyante protection après lui. La loi ne peut pas se montrer indifférente à l'accomplissement des obligations sur le respect desquelles l'esprit de famille repose.
En arrivant au terme de cette longue discussion, je suis heureux d'avoir à conclure par l'approbation du système sur lequel repose la législation de mon pays. Les esprits sont trop facilement enclins à blâmer les lois sous lesquelles nous vivons. Je me félicite d'être arrivé, même par trop de détours, à rendre hommage à l'une des parties de notre législation qu'il est aujourd'hui de mode d'attaquer avec le plus d'insistance et de légèreté.
Notre législation sur les droits d'auteurs est imparfaite, sans doute ; elle est surtout fort incomplète dans ses détails et a besoin d'être coordonnée dans une loi générale.
Mais altérer son principe qui est sage, ébranler sa base qui est solide, pour améliorer ses détails, ce serait faire plus de mal que de bien. Mieux vaudrait, cent fois, garder nos lois actuelles avec leurs imperfections.
Notes
[1] Mémoire de 1725. V. p. 157 et suiv.
[2] Pag. 162.
[3] Pag. 164, 173 et suiv.
[4] Pag. 164.
[5] Pag. 182 et suiv.
[6] Pag 309 Rapport de Chapelier ; p. 324 Rapport de Lakanal ; etc., etc.
[7] V. p. 253 à 261. Dans le Mémoire lu à l'Institut en 1837, j'ai une seule fois parlé de l'opinion de Kant (pag. 258 de la Revue), et j'en ai parlé à contresens. J'avais eu le tort de m'en rapporter à des citations incomplètes, qui m'avaient donné une idée fausse de sa théorie. Elle repose, ainsi que le lecteur a pu en juger, sur une argumentation dont la déduction logique ne peut être saisie que lorsqu'on l'étudie dans son ensemble. Ces citations de confiance sont une source inévitable d'erreurs ; j'ai pris soin, dans cet ouvrage, de vérifier tous les textes et tous les auteurs auxquels je me suis référé.
[8] V. p. 10, p. 146, etc.
[9] Séance du 2 septembre 1898. V. pag. 387.
