sept.102015
La « propriété intellectuelle » c'est le viol ! troisième partie
dans la catégorie Informatologie
 Nous arrivons au terme de ce tryptique de billets sur la « propriété intellectuelle ». À partir d'un article de Richard Stallman, le premier billet nous avait permis, par une simple analyse textuelle du titre de cet article, de problématiser la question. La « propriété intellectuelle » y était en effet présentée comme un
Nous arrivons au terme de ce tryptique de billets sur la « propriété intellectuelle ». À partir d'un article de Richard Stallman, le premier billet nous avait permis, par une simple analyse textuelle du titre de cet article, de problématiser la question. La « propriété intellectuelle » y était en effet présentée comme un séduisant mirage
, un être fantasmagorique et composite à l'apparence pourtant bien réelle.
L'étude bibliographique menée dans le second billet a confirmé que la « propriété intellectuelle » avait effectivement réussi à imposé l'unification de divers droits – droits d'auteurs, brevets, marques, dessins et modèles, etc. – malgré toutes leurs disparités. Somme toute, le seul point commun les rassemblant s'est avéré être justement qu'ils soient tous raccrochés à la banière de la propriété. Toutefois, cette caractérisation en termes de propriété s'est révélée on ne peut plus contingente et, au final, portée par un unique objectif de marchandisation qu'ont poussé des acteurs juridiques et industriels.
C'est donc dans le seul domaine de l'économie que le mirage de la « propriété intellectuelle » existe réellement. Il s'en suit que toute critique de la « propriété intellectuelle » en tant que telle, n'a de sens que située dans le champ économique. Pour le dire autrement : ce n'est qu'en tant qu'objet économique que la « propriété intellectuelle » est susceptible d'être appréhendée. Il nous faut donc, dans ce troisième et dernier billet, pénétrer le monde merveilleux de l'économie, tenter d'en dégager les lois spécifiques grâce auxquelles surgissent des êtres chimériques tels que la « propriété intellectuelle » et comprendre ainsi comment est régie leur mystérieuse existence.
1re partie : Stupeur et dévoilement
2e partie : Archéologie du savoir approprié
Le capital imaginaire – Critique de l'économie politique de la « propriété intellectuelle »
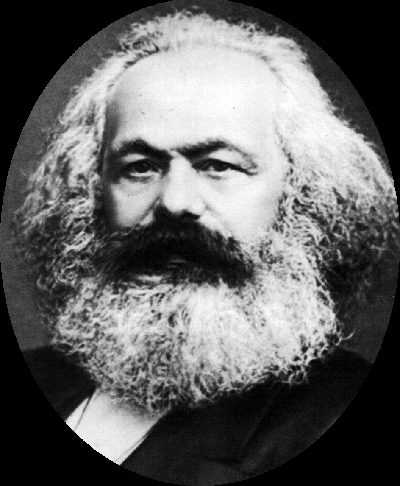
Nous l'avons vu, la science économique ne peut nous être d'un grand secours pour saisir la nature profonde de la « propriété intellectuelle », celle-là prenant celle-ci pour acquise, sans plus se poser de question, et l'intégrant dans ses bilans comptables comme si l'existence de la « propriété intellectuelle » était la plus naturelle du monde. C'est que la science économique adopte un point de vue depuis l'économie elle-même et se retrouve par conséquent incapable d'en proposer une analyse réflexive. Pour ce faire, un pas de côté est nécessaire. Il nous faut nous placer hors, contre et au-delà de l'économie, y compris de l'économie critique. Et nous nous retrouvons ainsi dans le domaine de la critique de l'économie, dont Marx a jeté les bases.
Entendons-nous bien : il ne s'agit pas ici d'embrasser l'idéologie marxiste centrée sur la lutte des classes et l'abolition de la propriété privée au profit de la collectivisation. Ce qui nous intéresse dans la théorie que l'on nomme marxienne pour la distinguer, c'est l'analyse à la finesse toujours inégalée des mécanismes internes qui font tourner l'économie politique, c'est-à-dire le capitalisme. C'est la mise en lumière des catégories fondamentales – argent, valeur, travail abstrait, capital, etc. – qui le constituent historiquement et socialement et permettent d'en démontrer les lois qui régissent, dans le stade ultime de son développement, la totalité de la société et que l'économie – tout autant les économistes de l'orthodoxie dominante que les courants qualifiés d'hétérodoxes – tient pour naturelles.
Malheureusement, Marx n'a jamais réellement abordé la critique de l'économie de la « propriété intellectuelle ». Tout juste a-t-il évoqué le rôle des inventions[1] dans l'augmentation de productivité ou le caractère productif ou non des activités produisant des œuvres littéraires ou artistiques[2]. Mais, ainsi que nous l'avons observé dans le précédent billet, le XIXe siècle fut la période de maturation de la « propriété intellectuelle » et celle-ci jouait encore un rôle négligeable au sein de l'économie. Il nous faut donc chercher du côté de ceux qui ont tenté de prolonger l'œuvre de Marx en prenant en compte les évolutions subies par le capitalisme durant les deux derniers siècles afin d'actualiser la critique de l'économie.
Mais, à ma connaissance, la « propriété intellectuelle » n'a jamais été directement l'objet spécifique d'une quelconque théorie critique. Certes, l'importance qu'elle a prise, depuis environ un quart de siècle, n'a pu passée inaperçue des divers courants s'inscrivant dans la critique de l'économie, mais ceux-ci ne l'ont finalement toujours abordée que « par la bande », que ce soit en élaborant le concept de capitalisme cognitif[3], c'est-à-dire basé sur la production de connaissances, en étudiant la capitalisation financière[4] ayant investi dans la bulle de la nouvelle économie de la fin du siècle dernier[5], en relatant la constitution de l'industrie culturelle[6], ou en constatant la part croissante de la composante immatérielle[7] tant dans le travail de production que dans les marchandises ainsi produites. Le problème majeur de ces analyses est qu'en ne se confrontant à la question de la « propriété intellectuelle » qu'accessoirement à leurs principaux objets d'étude, en ne la rencontrant presque que par accident, elles se laissent totalement abuser par le piège du mirage que nous avons dénoncé, avec Richard Stallman, dans le premier billet de cette série. Elles prennent tout d'abord pour argent comptant l'unification opérée par ce mirage des droits disparates qu'il rassemble sous son aile, en considérant que ces divers droits peuvent s'appliquer à un même objet, que celui-ci soit défini comme la production de connaissances[8], de savoirs ou d'informations, d'objets abstraits[9], ou encore comme travail intellectuel, cognitif ou immatériel[10], etc. Ensuite, lorsque ces études vont jusqu'à se pencher sur le rôle économique de la « propriété intellectuelle », elles l'évacuent rapidement en le réduisant à une rente d'information[11]. Le constat n'est certes pas faux – nous aurons l'occasion d'y revenir –, mais sans plus d'explications, il ne fait que révéler une certaine subjugation par la forme de propriété sous laquelle se présente le mirage de la « propriété intellectuelle ». Reflétant la nature et les propriétés de la rente foncière à laquelle donne droit la propriété foncière[12], on calque sur la « propriété intellectuelle », comme forme particulière de propriété, une sorte particulière de rente.
Ainsi, les recherches récentes de la critique de l'économie pourront nous être utiles, de par les intuitions qu'elles soulèvent ou pour ne pas reproduire les erreurs qu'elles commettent sous la séduction du mirage, mais force est de constater qu'une véritable théorie critique de l'économie de la « propriété intellectuelle » reste encore à être élaborée.
 La première tâche d'une telle théorie est d'identifier les objets sur lesquels portent les différents droits de « propriété intellectuelle ». Et pour éviter de se faire piéger par l'image unitaire qu'exhibe le mirage de la « propriété intellectuelle », il est nécessaire d'établir séparément cet objet pour chacun de ces droits, en les prenant un par un. Nous n'avons d'ailleurs pas encore précisé jusqu'ici en quoi consistait chacun de ces droits réunis sous la houlette de la « propriété intellectuelle », alors que nous avons vu que la définition légale de celle-ci revenait précisément à dresser un tel inventaire. Il est temps de s'y atteler ! Et nous pouvons suivre pour cela la liste de droits inclus dans le texte de loi le plus universellement reconnu, l'Accord sur le respect des droits de « propriété intellectuelle » qui touchent au commerce, ou Accord sur les ADPIC :
La première tâche d'une telle théorie est d'identifier les objets sur lesquels portent les différents droits de « propriété intellectuelle ». Et pour éviter de se faire piéger par l'image unitaire qu'exhibe le mirage de la « propriété intellectuelle », il est nécessaire d'établir séparément cet objet pour chacun de ces droits, en les prenant un par un. Nous n'avons d'ailleurs pas encore précisé jusqu'ici en quoi consistait chacun de ces droits réunis sous la houlette de la « propriété intellectuelle », alors que nous avons vu que la définition légale de celle-ci revenait précisément à dresser un tel inventaire. Il est temps de s'y atteler ! Et nous pouvons suivre pour cela la liste de droits inclus dans le texte de loi le plus universellement reconnu, l'Accord sur le respect des droits de « propriété intellectuelle » qui touchent au commerce, ou Accord sur les ADPIC : droit d'auteur et droits connexes ; marques de fabrique ou de commerce ; indications géographiques , dessins et modèles industriels ; brevets ; schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ; et protection des renseignements non divulgués
[13].
Le droit d'auteur et les droits connexes portent sur la production d'œuvres littéraires ou artistiques, comprenant toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences
[14]. Sont également inclus les programmes d'ordinateur et les compilations de données – ces dernières étant parfois l'objet d'un droit de « propriété intellectuelle » spécifique, comme dans l'Union européenne avec le droit sui generis sur les bases de données. Économiquement, les œuvres sous droit d'auteur ou droits connexes entrent dans le procès de circulation – sont vendues et achetées – sous forme de produits, lorsqu'elles peuvent être fixées sur un support, ou de services, lorsque c'est leur exécution, leur interprétation qui est commercialisée.
Les marques de fabrique ou de commerce portent sur tout signe, […] en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises
[15]. La marque est ainsi le fruit du travail relationnel, communicationnel, symbolique, du savoir-faire, développés par une entreprise et représente l'image que celle-ci souhaite donner d'elle-même sur le marché. Économiquement, la marque est attachée aux marchandises, produits ou services, commercialisées par cette entreprise[16].
Les indications géographiques servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique
[17]. Elles représentent donc un savoir faire lié à un territoire et jouent un rôle économique similaire à celui des marques, en étant attachées à toute marchandise produite ou assemblée par une entreprise implantée sur ce territoire.
Les dessins et modèles industriels décrivent dans un schéma nouveau et original, bidimensionnel – par exemple, un assemblage de lignes et de couleurs – ou tridimensionnel – modélisant la forme ou la surface –, l'aspect ornemental ou esthétique d'objets manufacturés. Ce sont donc les marchandises produites conformément à ces dessins ou modèles qui entrent dans le circuit économique.
Les brevets portent sur des inventions de produits ou de procédés, nouvelles, non évidentes pour un homme du métier et susceptibles d'application industrielle, qui doivent être divulguées avec suffisamment de précision pour être reproduites. Leur rôle économique est sensiblement le même au niveau fonctionnel que celui des dessins et modèles au niveau esthétique : il repose sur les marchandises décrites par les brevets sur les produits ou fabriquées conformément aux méthodes exposées dans les brevets de procédés[18].
Les schémas de configuration, ou topographies, de circuits intégrés portent sur des représentations tridimensionnelles de circuits électroniques, qui sont originaux en ce sens qu'ils sont le fruit de l'effort intellectuel de leurs créateurs et que, au moment de leur création, ils ne sont pas courants pour les créateurs de schémas de configuration (topographies) et les fabricants de circuits intégrés
[19]. Ils entrent bien entendu dans le procès de circulation via les marchandises incorporant les circuits intégrés fabriqués selon ces schémas.
Les renseignements non divulgués concernent des secrets de fabrication et peuvent peu ou prou être considérés de la même façon que des brevets, à la différence près que les procédés qui les composent ne doivent pas être divulgués. Économiquement, ils se retrouvent dans les marchandises fabriquées selon ces secrets.
 Ce n'est que maintenant que nous avons passé en revue les objets sur lesquels porte chacun des droits de « propriété intellectuelle », en nous préservant de l'apparence séductrice – aussi réelle soit-elle – du mirage unificateur sous laquelle cette dernière se présente, que nous pouvons dégager les points communs entre ces droits disparates. Ce n'est qu'à présent que nous avons identifié que cette chimérique « propriété intellectuelle » n'avait de sens que d'un point de vue économique et que nous avons recensé comment les objets de ces droits entraient dans le circuit économique, que nous pouvons chercher la fonction économique qui les détermine.
Ce n'est que maintenant que nous avons passé en revue les objets sur lesquels porte chacun des droits de « propriété intellectuelle », en nous préservant de l'apparence séductrice – aussi réelle soit-elle – du mirage unificateur sous laquelle cette dernière se présente, que nous pouvons dégager les points communs entre ces droits disparates. Ce n'est qu'à présent que nous avons identifié que cette chimérique « propriété intellectuelle » n'avait de sens que d'un point de vue économique et que nous avons recensé comment les objets de ces droits entraient dans le circuit économique, que nous pouvons chercher la fonction économique qui les détermine.
De prime évidence, les droits de « propriété intellectuelle » partagent ceci qu'ils portent sur des objets – restant encore pour le moment mystérieux – qui doivent – si l'on fait pour l'instant abstraction de ce que la croyance en la « propriété intellectuelle » vient justement changer – être incorporés dans des marchandises on ne peut plus ordinaires afin de participer au procès d'échange et de circulation. Dit autrement : chacun des droits de « propriété intellectuelle » s'applique à des objets qui ne peuvent être vendus et achetés qu'indirectement, en étant inextricablement intégrés au sein de véritables marchandises. Et ce sont ces marchandises englobantes, ces marchandises complexes[20], qui sont véritablement vendues et achetées. La question qui dès lors se pose est de savoir si ces objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle » sont eux-mêmes des marchandises.
Dans le monde merveilleux de l'économie – c'est-à-dire dans la société régie par les lois du capitalisme –, une marchandise est un être tout à fait fabuleux, présentant un double visage, et doté du pouvoir extraordinaire de se métamorphoser en n'importe quelle autre marchandise, y compris la marchandise reine, l'équivalent général de toutes les autres : l'argent. Ce prodige, la marchandise l'accomplit justement grâce à son caractère bifide. En effet, si l'une de ses faces représente la valeur d'usage de la marchandise, son utilité particulière, ce à quoi cette marchandise spécifique doit être employée, le besoin propre qu'elle vient satisfaire, son autre face lui permet de faire abstraction de ses particularités et de se présenter sur le marché à égalité avec ses homologues, dans un rapport d'équivalence à toute autre marchandise. Qu'importe la valeur d'usage de celle-ci et de celle-là, les marchandises entrent en relation entre elles parce qu'elles se reconnaissent comme semblables, elles ne peuvent s'échanger que grâce à ce second visage qui leur est commun et que l'économie politique nomme la valeur[21].
Tout le capitalisme – c'est-à-dire toute l'économie – repose sur ce principe cardinal – cette formule magique – qui veut que le système puisse engendrer dans sa globalité toujours plus de valeur. La masse totale de la valeur, et donc la masse totale des marchandises dans lesquelles s'incarne cette valeur, doit sans cesse s'accroître. C'est-à-dire que la quantité de valeur que le système capitaliste, dans son ensemble, consomme en entrée pour sa reproduction doit se retrouver en sortie dans une quantité supérieure. Et nous l'avons évoqué au début de cette série de billets : toute la richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste se réduit à un gigantesque amoncellement de marchandises
[22] dont la grandeur est mesurée par la quantité de valeur représentée dans ces marchandises, quantité déterminée par ce système à augmenter en permanence[23].
Par quel miracle la valeur peut-elle s'accroître ? Grâce à un certain type fantastique de marchandise : la force de travail[24]. Cette dernière, comme toute marchandise, possède une valeur qui fait qu'on peut l'acheter et la vendre[25]. Mais elle détient également un pouvoir prodigieux qui lui vient de sa valeur d'usage particulière qui est précisément de produire de la valeur[26]. Ce qui fait du travail humain cet être absolument formidable du monde merveilleux de l'économie, capable de produire plus de valeur qu'il n'en consomme pour sa propre reproduction[27]. Cette valeur supplémentaire que la force de travail est capable de produire, au-delà de la valeur nécessaire pour se reproduire, est nommée survaleur – ou plus-value dans les traductions plus anciennes. Et cette créature féérique qu'est le travail – au sens économique du terme, c'est-à-dire tel qu'historiquement ancré dans le capitalisme[28] – se manifeste également, symétriquement à la marchandise, avec une double face. Sa face concrète représente le type de travail particulier dont il s'agit, l'activité qui le caractérise, la tâche spécifique qu'il exige. Tandis que sa face abstraite[29] se moque de ses particularités pour ne plus représenter qu'une dépense d'énergie, quelle qu'elle soit, physique, psychique, intellectuelle, etc.[30] Dans le système capitaliste, tout travail, en tant qu'il est également du travail abstrait, est qualitativement semblable à tous les autres travaux existants. Seul son aspect quantitatif compte. Et c'est précisément parce que toute marchandise est produite par du travail humain et que celui-ci en tant que travail abstrait peut être quantifié[31], que sa valeur se mesure par la quantité de travail dépensée dans sa production[32].
 Si nous revenons aux marchandises englobant les objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle », il ne fait aucun doute que celles-ci ont une existence économique en tout point conforme aux déterminations du capitalisme que nous venons de brièvement rappeler. Les exemplaires d'un livre, d'un CD musical ou d'un DVD vidéo, les chaussures ou les frigidaires de marque, les bouteilles de vin AOC ou les montres suisses, les tablettes à coins arrondis ou les robes de haute couture, les appareils innovants ou les boîtes de médicaments brevetés, les gadgets électroniques ou les voitures avec ordinateur de bord, les bouteilles de coca-cola ou les flacons de parfums, etc. ont tous une valeur d'usage. Ils servent tous à quelque chose de bien précis, sans quoi personne ne voudrait les acheter, que cette fonction spécifique soit futile ou vitale peu importe. Et ils ont tous également une valeur, qui fait qu'on peut les vendre à un certain prix, c'est-à-dire les échanger contre une certaine somme d'argent. En outre, tous ces produits résultent d'un travail qui a beau être à chaque fois bien particulier pour produire chacun d'entre eux, n'en reste pas moins du travail, terme commun à toutes ces tâches diversifiées, du travail en général, du travail
Si nous revenons aux marchandises englobant les objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle », il ne fait aucun doute que celles-ci ont une existence économique en tout point conforme aux déterminations du capitalisme que nous venons de brièvement rappeler. Les exemplaires d'un livre, d'un CD musical ou d'un DVD vidéo, les chaussures ou les frigidaires de marque, les bouteilles de vin AOC ou les montres suisses, les tablettes à coins arrondis ou les robes de haute couture, les appareils innovants ou les boîtes de médicaments brevetés, les gadgets électroniques ou les voitures avec ordinateur de bord, les bouteilles de coca-cola ou les flacons de parfums, etc. ont tous une valeur d'usage. Ils servent tous à quelque chose de bien précis, sans quoi personne ne voudrait les acheter, que cette fonction spécifique soit futile ou vitale peu importe. Et ils ont tous également une valeur, qui fait qu'on peut les vendre à un certain prix, c'est-à-dire les échanger contre une certaine somme d'argent. En outre, tous ces produits résultent d'un travail qui a beau être à chaque fois bien particulier pour produire chacun d'entre eux, n'en reste pas moins du travail, terme commun à toutes ces tâches diversifiées, du travail en général, du travail sans phrase
[33], une dépense de muscles, de nerfs, de cerveau[34], bref : du travail abstrait.
Mais au sein de ces marchandises englobantes, qu'en est-il de la part qui fait précisément l'objet des droits de « propriété intellectuelle » ? Qu'en est-il du texte qui se retrouve dans chacun des exemplaires du livre, de la musique dans chaque CD ou du film dans chaque DVD, du goût de terroir de chaque bouteille de vin ou du savoir-faire faisant la précision de chaque montre suisse, du schéma des coins de tablettes ou du patron des robes, du procédé inventif selon lequel tous ces appareils ont été fabriqués ou de la formule chimique des comprimés, du schéma des puces intégrées dans les gadgets ou de la topologie des circuits électroniques incorporés dans les voitures, de la recette du coca qui donne le même goût à toutes les bouteilles ou de la composition d'arômes permettant de sentir le même parfum dans chaque flacon ? Tous sont bel et bien également issus d'un travail. Mais d'un travail qui, dans tous ces cas où il est question que ce que l'on produit puisse être l'objet de droits de « propriété intellectuelle », possède quelques caractéristiques distinctives.
Il est facile au premier abord d'y voir, pour tous ces travaux, un travail intellectuel. Mais cela ne nous mènerait pas plus loin que de considérer qu'il s'agit d'un travail comme tous les autres[35], au sens capitaliste du terme, c'est-à-dire tout à la fois concret et abstrait. Puisque toute dépense d'énergie, qu'elle soit physique, psychique ou intellectuelle, est un travail dès qu'il présente cette apparence bifide. Sans compter que tout travail requiert une part d'effort intellectuel[36]. Que celle-ci soit réduite à un quasi-automatisme évitant de se taper sur les doigts n'empêche pas qu'il faille quelques déplacements de neurones pour que la main guide le marteau sur le clou. On pourrait alors préciser que les purs produits faisant l'objet de droits de « propriété intellectuelle » sont issus d'un travail purement intellectuel. Mais d'autres travaux purement intellectuels n'ont aucune prétention à être couverts par un droit de « propriété intellectuelle ». Qu'on songe par exemple aux calculs mathématiques d'un comptable ou aux séances prodiguées par un psychanalyste. Enfin, après tout le chemin parcouru jusqu'ici, il devient inévitable de se méfier de qualifier ce travail seulement d'intellectuel. Ne serait-ce pas se laisser par trop influencer par la forme du mirage en prenant un raccourci simpliste pour aller de la « propriété intellectuelle » au travail intellectuel ?
L'une des principales caractéristiques de ce travail, certes purement intellectuel, est qu'il doit, dans tous les cas, élaborer des produits nouveaux, originaux, inédits. Les objets des droits de « propriété intellectuelle » doivent être créés par ce travail, au sens biblique du terme : ce travail leur donne existence en les tirant du néant. Cet acte de création est évidemment unique en son genre. Autant l'on peut graver autant de fois que l'on veut des CD, autant la musique dont ils sont les vecteurs n'a pu être créée qu'une seule fois. On peut fabriquer des machines semblables autant de fois que l'on souhaite, mais l'invention sur laquelle se base ces machines n'a été créée qu'une seule fois. Etc.
De cette caractéristique en découle tout de suite une autre. Puisque les objets des droits de « propriété intellectuelle » doivent être créés ex nihilo par le travail qui les produit, ce travail ne peut être comparé à une activité similaire, celle-ci n'existant pas. Ce qui rend ce travail difficilement mesurable selon une unité de temps objective[37]. En effet, ce qui fait que, dans le monde merveilleux de l'économie, la grandeur de la valeur des marchandises est mesurée par le temps de travail dépensé pour les produire est qu'il s'agit de travail socialement nécessaire, déterminé[38] en fonction des conditions standards de production et du degré de productivité en vigueur dans la société au moment où elles sont produites[39]. Or les conditions et le degré de productivité – et par conséquent le temps de travail socialement nécessaire – sont nécessairement indéterminés lorsqu'il s'agit d'un travail créant de toutes pièces un produit encore inconnu. Le travail produisant les objets des droits de « propriété intellectuelle » est donc non déterminé, non quantifiable et non reproductible, ce qui en fait une créature monstrueuse difficilement domptable par les lois économiques[40].
Ainsi, si les objets des droits de « propriété intellectuelle » sont produits par un travail productif – au sens capitaliste du terme, c'est-à-dire s'il s'agit d'un travail produisant de la survaleur[41] –, ce travail étant incommensurable, l'éventuelle valeur représentée dans ses objets ne pourra être – au moins en partie – qu'arbitraire[42]. La question reste entière de savoir si justement ces objets incarnent une quelconque valeur. Autrement dit, si le travail qui les produit engendre de la survaleur, si c'est un travail productif, au sens économique du terme.
Pour le capitalisme, un travail est productif à partir du moment où le capital investi dans les moyens de productions, les matières premières, les marchandises intermédiaires, etc., ainsi que dans la force de travail nécessaires à ce travail, permet d'obtenir un capital supérieur à celui d'origine lorsque le procès de production a fait son office[43]. Or, dans l'état actuel de la société, il ne fait pas de doute que tous les travaux dont sont issus les objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle » sont des travaux productifs. Il n'est pas d'œuvre littéraire ou artistique qui ne soit issue de l'industrie culturelle. Il n'est pas d'invention qui ne soit produite par un département de recherche et développement d'une entreprise[44]. Ni de marque dont l'image n'a été créée par des employés, salariés à cet effet – que la novlangue à la mode nomme d'ailleurs « créatifs ». Etc. Et toutes ces industries et entreprises ont clairement investi dans cette production un capital, dans le but précis de l'agrandir.
Notons en outre que cet investissement porte principalement, voire uniquement, sur la force de travail, puisqu'en simplifiant, ces travaux ne nécessitent aucun moyen de production, aucune matière première, aucun carburant, autre que l'énergie cérébrale de leurs créateurs. Ce qui nous intéresse dans ces travaux, ce sur quoi porte directement les droits de « propriété intellectuelle », peut entièrement se dérouler à l'intérieur du cerveau de ceux qui créent ces produits. Nul autre besoin que du degré de connaissance et de savoir culturels et scientifiques disponibles dans la société, de ce que Marx nomme l’intellect général, produit par le travail général – ou travail universel selon les traductions[45]. On a d'ailleurs parfois tendance à considérer un peu trop rapidement que les objets des droits de « propriété intellectuelle » n'enrichissent que cet intellect général, que le travail qui les produit n'est que du travail général[46], et d'en conclure non moins précipitamment qu'il s'agit d'un travail non productif, ne générant pas de survaleur et que ces objets en tant que tels ne sont donc pas des marchandises, dans lesquelles n'est représentée aucune valeur. C'est aller un peu vite en besogne ! Premièrement, c'est faire l'économie d'une analyse scrupuleuse qui montre inévitablement, nous venons de le constater, que dans le stade actuel de développement du capitalisme, ce travail est bel et bien productif. Deuxièmement, c'est généraliser à la « propriété intellectuelle » dans son ensemble, les attributs de certains des droits qu'elle englobe : s'il est indéniable que les inventions brevetées se retrouvent dans l’intellect général, cela devient plus contestable pour les œuvres sous droits d'auteur – suivant la qualité de celles-ci –, jusqu'à être difficilement concevable pour les marchandises quelconques portant une marque de fabrique. Bref, c'est être encore par trop sous le charme du mirage de la « propriété intellectuelle ».
 Gardons-nous de cette influence et de conclusions hâtives et continuons d'examiner ces créatures mystérieuses du monde merveilleux de l'économie que sont les objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle ». Ayant établi que le travail purement intellectuel et créatif dont ils sont issus est, au sens du capitalisme, productif, c'est-à-dire qu'il provient d'un capital qui ressort enrichi de la valeur créée par ce travail, il nous faut examiner la nature de cet enrichissement de capital – ou de cette supposée valeur créée, ce qui revient au même. Puisque nous avons vu que ces objets n'entraient dans le circuit économique qu'en tant que partie de marchandises ordinaires, nous pourrions être tenté d'y voir un simple moyen de production ou une matière première ou intermédiaire[47]. Après tout, le texte d'un livre n'est-il pas une matière première que l'on associe à des feuilles de papier vierge pour donner les exemplaires de ce livre ? Une invention, un dessin ou un modèle, un schémas de circuit intégré n'est-il pas un moyen de production pour fabriquer les machines qui s'y rapportent ? Une marque n'est-elle pas une sorte de carburant pour les marchandises qu'elle estampille ?
Gardons-nous de cette influence et de conclusions hâtives et continuons d'examiner ces créatures mystérieuses du monde merveilleux de l'économie que sont les objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle ». Ayant établi que le travail purement intellectuel et créatif dont ils sont issus est, au sens du capitalisme, productif, c'est-à-dire qu'il provient d'un capital qui ressort enrichi de la valeur créée par ce travail, il nous faut examiner la nature de cet enrichissement de capital – ou de cette supposée valeur créée, ce qui revient au même. Puisque nous avons vu que ces objets n'entraient dans le circuit économique qu'en tant que partie de marchandises ordinaires, nous pourrions être tenté d'y voir un simple moyen de production ou une matière première ou intermédiaire[47]. Après tout, le texte d'un livre n'est-il pas une matière première que l'on associe à des feuilles de papier vierge pour donner les exemplaires de ce livre ? Une invention, un dessin ou un modèle, un schémas de circuit intégré n'est-il pas un moyen de production pour fabriquer les machines qui s'y rapportent ? Une marque n'est-elle pas une sorte de carburant pour les marchandises qu'elle estampille ?
Marx a proposé[48] de définir les moyens de production, c'est-à-dire les matériaux bruts, les matières auxiliaires et les moyens de travail comme étant du capital constant[49], qu'il oppose au capital variable composé uniquement de la force de travail humaine, seule à même – comme nous l'avons vu – de créer de la survaleur, venant ainsi augmenter le capital de départ, d'où son nom de variable : la production capitaliste fait varier ce capital en l'accroissant. Comme toutes les créatures magiques du monde merveilleux de l'économie, le capital constant jouit d'un pouvoir spécifique. La valeur qu'il incarne – et qui provient elle-même du travail qui a été nécessaire pour produire ou extraire ce capital constant – se transmet au fil du temps aux marchandises qu'il contribue à produire jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Par exemple, une machine représente une valeur dont la grandeur est déterminée, comme toutes les marchandises, par le travail vivant nécessaire à sa production. Par le pouvoir du capital constant, cette valeur se retrouvera divisée dans toutes les marchandises que cette machine contribuera à produire au rythme de son usure, jusqu'à ce qu'elle soit inutilisable. De même, si cette machine fonctionne avec de l'essence, la valeur de l'essence acheté – qui provient du travail vivant socialement nécessaire pour l'extraction du pétrole, son raffinement, etc. – sera proportionnellement distribuée à toutes les marchandises que chaque cycle de la machine est capable de produire, jusqu'à épuisement du stock.
Force est de constater que les objets des droits de « propriété intellectuelle » ne se comportent absolument pas comme du capital constant[50]. Les deux sortes de créatures ont des existences complètement différentes. Le capital constant a un rapport temporel au monde, semblable à celui de tout être vivant : il naît, vit et meurt, mûrissant et se décomposant au fil du temps. Les objets des droits de « propriété intellectuelle » ont quant à eux une durée de vie, non pas éternelle puisqu'ils ont un début, ayant été créés ex nihilo, mais infinie, sans fin, interminable – tout du moins potentiellement. On peut certes dire que le texte d'un livre qui n'est plus réimprimé se meurt. Tout comme une invention qui est remplacée par une autre plus ingénieuse – quoique bien souvent dans ce cas, la seconde se base sur la première de sorte que celle-ci vit encore dans celle-là. De même que les marques d'une entreprise qui fait faillite. Et ainsi de suite. Mais cette temporalité est seulement dûe à l'existence ou non des marchandises englobantes. Tant qu'on est capable d'en produire, la part qui est l'objet des droits de « propriété intellectuelle » est immortelle. Son existence se multiplie potentiellement à l'infini.
Et nous avons là une réfutation décisive du caractère de propriété de ces objets. Car la propriété repose ontologiquement sur l'unicité, la singularité d'existence de la chose appropriée[51]. C'est parce qu'une chose ne peut exister simultanément en plusieurs exemplaires – nous parlons bien entendu des choses elles-mêmes et non des catégories abstraites qui peuvent quant à elles regrouper plusieurs choses identiques – qu'elle peut devenir ma propriété, mais pas la tienne, ni celle de quiconque autre que moi tant qu'elle reste mienne[52]. Car toute propriété est privation de propriété pour autrui[53]. Rien de tout cela pour les objets des droits de « propriété intellectuelle ». Au contraire, le même objet existe en même temps dans une pléthore d'existences. En fait, il se démultiplie dans chacune des marchandises qui l'englobe et ne cesse d'exister que lorsque toutes celles-ci sont mortes sans que plus aucune ne naisse. Voici par conséquent une autre caractéristique commune aux objets de tous les droits de « propriété intellectuelle » : ils sont inappropriables !
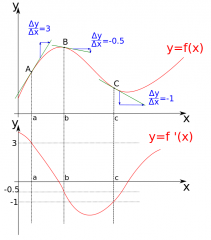 Il nous reste une remarque à faire à propos de l'inscription dans le temps des objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle » : leur existence temporelle doit précéder celle des marchandises qui les englobent. Il est nécessaire que ces objets soit préalablement créés pour que les marchandises qui en sont les vecteurs puissent être produites. Le travail de création des objets des droits de « propriété intellectuelle » doit se situer dans le passé pour que soit réalisée dans le futur la valeur – s'il s'agit bien de valeur – des marchandises complexes auxquelles elles participent.
Il nous reste une remarque à faire à propos de l'inscription dans le temps des objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle » : leur existence temporelle doit précéder celle des marchandises qui les englobent. Il est nécessaire que ces objets soit préalablement créés pour que les marchandises qui en sont les vecteurs puissent être produites. Le travail de création des objets des droits de « propriété intellectuelle » doit se situer dans le passé pour que soit réalisée dans le futur la valeur – s'il s'agit bien de valeur – des marchandises complexes auxquelles elles participent.
Ce rapport au temps n'est pas sans rappeler celui des actifs financiers. En effet, les actions, les obligations, les emprunts d'État, les crédits bancaires, les produits dérivés, etc., ce que Marx nommait déjà le capital fictif[54] et qui, à notre époque, constitue à travers l'industrie financière la principale richesse du capitalisme, surpassant désormais de loin la valeur réelle dégagée de l'économie dite « réelle », tous ces produits financiers représentent en dernière analyse de la valeur future, de la valeur qui sera produite dans un avenir plus ou moins proche. Alors que les marchandises ordinaires incarnent une valeur déjà effectivement créée, résultat d'un travail abstrait passé, ces marchandises particulières de l'économie financière ne font qu'anticiper de la valeur qui reste à produire[55]. Les objets des droits de « propriété intellectuelle », si nous faisons l'hypothèse qu'ils incarnent de la valeur qui ne se réalisera véritablement que dans le futur, lorsqu'elle aura été incorporée dans les marchandises englobantes qui restent à produire, ne seraient-ils pas semblables ?[56]
Sans compter que ces créances et prêts financiers s'objectivent dans des marchandises du capital fictif que les fées du capitalisme ont baptisées du doux nom de « titres de propriété ». La résonance ne peut être manquée avec les titres de « propriété intellectuelle » dans lesquels s'objectivent les droits de « propriété intellectuelle ». Nous reviendrons sur ces derniers mais méfions-nous des apparences et voyons si la ressemblance est telle qu'on pourrait assimiler les objets des droits de « propriété intellectuelle » à du capital fictif.
Si le concept de capital fictif, en tant que capital-argent négocié comme marchandise, est déjà posé par Marx dans son analyse du capital porteur d'intérêt[57], l'importance relative des produits financiers restait encore minime dans l'économie du XIXe siècle. On doit au mouvement de la « critique de la valeur » et en particulier à Ernst Lohoff et Norbert Trenkle[58], d'avoir poursuivi au-delà de Marx la critique de l'économie politique et permis de percer les arcanes de cette créature décidément étrange, qui s'apparente tout à fait à une marchandise et n'en constitue pas moins de la richesse capitaliste, mais qui possède cependant en même temps des propriétés bien particulières. La première de ces caractéristiques spécifiques – nous venons de le voir – est d'incarner une anticipation de valeur plutôt que de la valeur produite par un travail passé. Toujours est-il que lorsqu'un titre de propriété financier arrive à terme, se pose la question de savoir si de la valeur réelle a effectivement été produite par l'emprunteur, auquel cas il pourra rembourser son créancier, ou si, au contraire, le capital-argent prêté a été entièrement consommé de manière improductive et, dans ce cas, il devra faire défaut sur cette dette ou en contracter une autre pour rembourser la première. Ainsi, les produits des marchés financiers sont-ils toujours liés en dernière analyse à de la valeur réelle, incarnée dans des marchandises ordinaires. Lohoff et Trenkle les modélisent par conséquent comme étant des marchandises dérivées, des marchandises d'ordre 2, fatalement attachées à des marchandises ordinaires – celles-ci étant logiquement qualifiées de marchandises d'ordre 1 –, à un point de référence dans l'économie réelle[59].
Surtout, ces créatures dérivées ont reçu à leur naissance de la part des fées de l'économie un don particulièrement extraordinaire : celui de multiplier le capital[60]. En effet, lorsqu'un titre financier est émis, par exemple une action, l'acquéreur de cette marchandise d'ordre 2 fournit en échange un capital-argent à la société émettrice. Mais il ne se départit pas tout à fait de son capital, celui-ci ne fait pas qu'être transmis. Car il est échangé contre une marchandise, en l'occurrence une action, dont la valeur d'usage est de réserver à son propriétaire une part des profits futurs réalisés par le vendeur, la société par actions. Cette marchandise dérivée peut alors vivre son existence propre, être revendue autant qu'on le souhaite sur les marchés financiers, sans que le capital de départ n'en soit affecté. À côté de ce capital initial, existe désormais son reflet, en tant que capital fictif, qui fait que la richesse capitaliste a magiquement doublé.
C'est tout à fait différent du pouvoir spécifique des objets des droits de « propriété intellectuelle ». Tout d'abord, ces derniers sont engendrés par du travail – purement intellectuel et créatif –, c'est-à-dire lors du procès de production, comme les marchandises ordinaires, alors que les titres de propriétés financiers ne surgissent que de la relation de crédit, durant le procès de circulation. Ensuite leur apparition ne provoque nullement de multiplication de richesse capitaliste. S'ils se multiplient, c'est plutôt parce qu'ils ont une existence infinie, parce que leur valeur d'usage n'est jamais véritablement consommée, au sens où leur consommation n'épuise pas leur existence. Mais ils ne représentent en aucune façon un reflet du capital réel.
Cette différence de taille s'éclaire encore davantage si nous nous amusons à développer la modélisation proposée par Lohoff et Trenkle, empruntant au concept mathématique de dérivation, et que l'on compare, d'un côté, le lien entre les marchandises dérivées et leur point de référence dans le cosmos des marchandises ordinaires et, de l'autre côté, celui entre les objets des droits de « propriété intellectuelle » et les marchandises complexes qui les englobent. La dérivée d'une fonction mathématique `f` est une fonction `f′` qui, à tout nombre `x`, associe le nombre dérivé de `f` en `x` : `f′(x)`. Ainsi, `f` et `f′` sont toutes deux des fonctions autonomes, qui vivent chacune leur vie de fonction dans l'espace mathématique des fonctions, tout en étant inextricablement liées l'une à l'autre. De même, dans le monde merveilleux de l'économie, tout titre de propriété est une marchandise d'ordre 2, `m′`, représentant une richesse `r`, dérivée d'une marchandise ordinaire, d'ordre 1, `m`, incarnant une valeur `v`. Nous pouvons donc noter `r=f′(v)`. Et nous voyons que le lien de dérivation unissant les marchandises d'ordre 2 et d'ordre 1 est d'ordre fonctionnel. Il est conceptuellement génératif[61] : l'existence de la marchandise d'ordre 1 engendre celle de la marchandise d'ordre 2. L'existence de marchandises dérivées reste conditionnée à celle de marchandises ordinaires. Si aucune valeur réelle n'est finalement formée, alors la richesse fictive du titre financier associé s'évaporera dans les limbes. Mais elles vivent, chacune de leur côté, leur vie de marchandise dans ce monde merveilleux de l'économie.
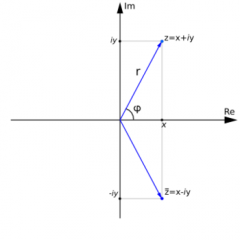 Le lien qui unit un titre de « propriété intellectuelle » aux marchandises englobantes est de toute autre nature. C'est un lien d'inclusion multiple : l'éventuelle valeur d'un objet de droits de « propriété intellectuelle » est nécessairement comprise dans chaque marchandise complexe l'englobant.
Le lien qui unit un titre de « propriété intellectuelle » aux marchandises englobantes est de toute autre nature. C'est un lien d'inclusion multiple : l'éventuelle valeur d'un objet de droits de « propriété intellectuelle » est nécessairement comprise dans chaque marchandise complexe l'englobant.
Le concept mathématique le plus approprié pour modéliser cette relation me semble être celui des nombres complexes. L'ensemble `CC` des nombres complexes est une extension de l'ensemble `RR` des nombres réels, incluant un nombre extrêmement particulier : le « nombre imaginaire », noté `i`, possèdant cette propriété extraordinaire – au sens où aucun nombre réel ne peut la satisfaire – d'avoir son carré qui vaut `-1`, soit : `i^2=-1`. Tout nombre complexe `z` peut ainsi s'écrire `z=x+yi`, `x` et `y` étant tous deux des nombres réels, avec `x` nommé « partie réelle » de `z` et `y` « partie imaginaire » de `z`. Nous pouvons ainsi tout à fait considérer que la valeur `z` de toute marchandise complexe englobe une partie constituée par la valeur `v` de cette marchandise englobante si elle n'englobait aucun objet des droits de « propriété intellectuelle », comme si elle était nue ! Et nous pouvons nommer marchandise support cette partie de la marchandise englobante. Outre la valeur `v` de cette marchandise support, supposons que la valeur `z` de la marchandise complexe englobe également une part provenant de l'objet d'un droit de « propriété intellectuelle », dont nous cherchons justement si elle incarne ou non de la valeur. Notons `p` cette valeur potentielle liée au droit de « propriété intellectuelle ». Nous pouvons donc poser :
Par ailleurs, les objets sur lesquels portent les droits de « propriété intellectuelle » ayant une existence infinie, s'ils incarnent une valeur potentielle, celle-ci doit se retrouver dans l'ensemble des `n` exemplaires des marchandises complexes qui les englobent, alors que pour chacun d'entre eux, une nouvelle marchandise support doit être produite, incarnant à chaque fois une nouvelle valeur. Ce que nous pouvons traduire par l'équation suivante :
Si nous admettons que la quantité de valeur `z` est identique dans chaque exemplaire de marchandise complexe, de même que `v` dans chaque exemplaire de marchandise support – ce qui revient au même, la seconde n'étant que la première conceptuellement dépouillée de la part qui est l'objet d'un droit de « propriété intellectuelle » –, l'équation `(2)` s'écrit alors :
Et si nous injectons dans cette équation `(3`) la valeur de `z` donnée par l'équation `(1)`, et que nous nous amusons à développer :
`{((1)),((3)):} hArr n(v+p i)=nv+p i`
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ hArr nv+np i=nv+p i`
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ hArr np i=p i`
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ hArr (n-1)p i=0`
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ hArr {(text{si } n = 1 => p in RR),(text{si } n!=1 => p = 0):} \ \ \ \ \ \ \ \ sf"(4)"`
Ce que signifie l'équation `(4)` résultante est on ne peut plus clair : la valeur potentielle d'un objet de droits de « propriété intellectuelle » est inestimable dans le cas où elle est englobée dans une marchandise complexe non-reproductible, unique – comme cela peut être par exemple le cas pour une œuvre d'art plastique –, ce qui est l'un des postulats communément admis dans le monde merveilleux de l'économie : la loi de la valeur ne s'applique qu'aux marchandises reproductibles[62] ; dans tous les autres cas, cette valeur potentielle est nulle. C'est-à-dire que, par nature – j'entends par là : selon les déterminations socio-historiques du monde merveilleux de l'économie –, le produit d'un travail créatif purement intellectuel n'incarne pas de valeur en lui-même.
Mais, jusqu'ici, nous n'avons fait que considérer les objets des droits de « propriété intellectuelle » comme s'ils étaient parfaitement neutres, comme s'ils n'étaient objets qu'au sens où ils constituaient ce sur quoi portent les droits de « propriété intellectuelle », comme si, au fond, le mirage de la « propriété intellectuelle » n'était qu'une illusion, une vue de l'esprit, n'ayant aucune capacité d'action, aucun pouvoir. Or nous avons vu qu'il s'agissait économiquement d'une chimère bien réelle et, par conséquent, agissant et produisant ses effets au sein du monde merveilleux de l'économie. Il est donc temps de faire entrer en scène cette créature magique qu'est la « propriété intellectuelle » et d'examiner quels sont ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'il nous faut maintenant considérer les objets des droits de « propriété intellectuelle », au sens où ils sont objets sur lesquels agit la « propriété intellectuelle » en tant que sujet actif, sur lesquels celle-ci projette les rayons des sorts qu'elle lance.
Ce pouvoir magique de la « propriété intellectuelle », nous l'avons sous nos yeux depuis que nous la contemplons : c'est de faire apparaître les marchandises par lesquelles elle investit le monde merveilleux de l'économie comme n'étant pas de vulgaires marchandises, mais comme des marchandises complexes, des marchandises englobantes. Tout ce que la « propriété intellectuelle » touche de sa baguette se présente comme comportant quelque chose de plus que la simple marchandise support que l'on achète et que l'on vend, comme si ces marchandises étaient composées, outre la partie réelle que l'on s'échange, d'une part invisible, intangible, imaginaire et pourtant réifiée[63]. C'est bien du fait même que la « propriété intellectuelle » existe que nous avons pu modéliser la valeur de ces marchandises sous la forme `z=v+p i`. Sans cela, nous aurions considéré leur valeur, sans plus nous poser de questions, comme celle de toute marchandise économique. Mais l'existence même de la créature « propriété intellectuelle » la métamorphose à nos sens, nous oblige à entendre le charme de sa voix nous dire : « Attention, je suis bien plus que ce que tu vois, que ce que tu touches, que ce que tu utilises, car je possède en moi une part exceptionnelle, extraordinaire, unique, fruit d'un travail de génie… et dont tu dois payer le prix ! »[64]
Car c'est bien de cela dont il s'agit depuis le début ! Ce chant des sirènes entamé par les marchandises touchées par la grâce de la « propriété intellectuelle » nous révèle l'objectif premier, le but fondamental poursuivi par ce mirage séduisant : grâce à ce rôle qu'elle joue dans le monde merveilleux de l'économie de transformer de simples marchandises en marchandises complexes, englobant une partie qui est purement son objet, la « propriété intellectuelle » vise à soumettre à l'emprise capitaliste les produits du travail intellectuel créatif, qui sans son intervention échapperait au capital[65]. En objectivant le travail créatif purement intellectuel au sein de chaque exemplaire de marchandises englobantes, cette réification opérée par la « propriété intellectuelle » permet de considérer les fruits de ce travail comme étant eux-mêmes des marchandises. Mais – nous l'avons vu –, il ne peut s'agir que de pseudo-marchandises, de marchandises imaginaires n'incarnant aucune véritable valeur, seulement de la valeur imaginaire, de la pseudo-valeur.
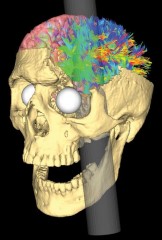 Voilà donc enfin dévoilé l'être économique de la « propriété intellectuelle ». Mais notre critique ne s'arrête pas à cette conclusion, si essentielle soit-elle. Toutefois, avant de la poursuivre, esquissons rapidement les quelques conséquences qui en découlent directement. Ce sont là autant de pistes de recherche qui mériteraient d'être davantage explorées…
Voilà donc enfin dévoilé l'être économique de la « propriété intellectuelle ». Mais notre critique ne s'arrête pas à cette conclusion, si essentielle soit-elle. Toutefois, avant de la poursuivre, esquissons rapidement les quelques conséquences qui en découlent directement. Ce sont là autant de pistes de recherche qui mériteraient d'être davantage explorées…
Car si, comme nous l'avons démontré, les produits visés par la « propriété intellectuelle » n'incarnent aucune autre valeur que celles des marchandises supports qui en sont les vecteurs économiques, si le travail intellectuel créatif qui les produit n'engendre que de la pseudo-valeur, nous pouvons alors rejoindre les critiques que nous avions écartées dans un premier temps comme étant trop hâtives. En effet, nous pouvons maintenant admettre que cette pseudo-valeur que nous avons modélisée comme un imaginaire pur, puisse être assimilée à de la rente[66]. Et nous pouvons reconnaître que certains de ces travaux créatifs purement intellectuels puissent être considérés comme du travail universel, du travail général, comme contribuant à l'intellect général[67]. Mais nous ne pouvons nous rendre à ces conséquences, que parce que nous sommes arrivés à déterminer la substantifique moelle de cette créature fantasmagorique qu'est la « propriété intellectuelle » à travers une analyse critique de son économie, et non sous le charme subjuguant du mirage sous lequel elle se présente.
En outre, nous avons vu que le pouvoir surnaturel de la « propriété intellectuelle » résidait dans la séparation conceptuelle qu'elle introduisait dans les marchandises concernées entre la part de valeur réelle inhérente à la marchandise support et la part de pseudo-valeur qui est celle qui fait directement l'objet d'un droit de « propriété intellectuelle ». Dès lors, il devient possible de pousser cette abstraction en isolant cette seconde partie imaginaire pour directement l'échanger en tant que pseudo-marchandise sur le marché des biens. C'est ainsi qu'on a vu se développer récemment des ventes aux enchères de brevets, de marques, de droits d'auteur, de noms de domaine, etc.[68] Comme un pâtissier séparant les blancs des jaunes d'œufs pour monter les premiers en neige, la « propriété intellectuelle » réussit la prouesse d'extraire la part soumise à son empire depuis les marchandises par lesquelles elle pénétrait dans le procès de circulation, pour que cette part imaginaire puisse à son tour entrer en tant que telle dans ce même procès d'échange. Et c'est ainsi que, malgré le fait qu'elles n'incarnent pas de valeur réelle, ces pseudo-marchandises se comportent à la manière de titres de propriété financiers, pouvant changer de mains en générant à chaque fois un peu plus de capital imaginaire, indépendamment de la production réelle des marchandises complexes. Prises isolément, ces pseudo-marchandises imaginaires peuvent effectivement s'échanger en anticipant la valeur réelle qui pourrait être dégagée de la vente des marchandises complexes, une fois que ces dernières auront été effectivement produites. Il conviendrait d'analyser par exemple sur ce point s'il existe une corrélation entre l'inflation de la bulle des brevets avec celle des actifs boursiers. Ou à un degré supérieur de dérivation, si ce capital imaginaire ne serait pas un candidat idéal pour constituer un point de référence privilégié pour le capital fictif. C'est-à-dire si la « propriété intellectuelle » ne pourrait pas incarner un porteur d'espoir sur lequel se baserait l'émission de titres de propriété financiers. Le comportement boursier des industries se basant sur la production de « propriété intellectuelle » – « trolls » de brevets, entreprises « fabless » développant des marques, etc. – pourrait apporter de riches enseignements.
Par ailleurs, ayant établi que seule la part de la marchandise support donnait de sa valeur à la marchandise complexe – pour le dire selon notre modèle : `z=v` –, se pose la question de savoir ce qu'il advient lorsque le support vient à disparaître. Par exemple, le calcul du prix d'un livre papier ne fait intervenir nulle part un éventuel coût du texte qu'il contient – nous avons d'ailleurs confirmé que la pseudo-valeur de ce contenu était nulle –, juste celui de fabrication des exemplaires. Mais que devient ce prix lorsque l'on considère un livre électronique ? Selon notre analyse, il devrait être nul, comme celui de toute œuvre soumise au droit d'auteur qui se trouve « dématérialisée », privée de « support ». S'il ne l'est pas, c'est forcément que de la richesse capitaliste créée par ailleurs doit nécessairement être redistribuée et redirigée vers les producteurs de ces pseudo-marchandises, ou plutôt vers les détenteurs des droits[69]. De même, nous pouvons clairement comprendre pourquoi l'industrie logicielle ne crée que de la pseudo-valeur, de la valeur imaginaire, et nulle réelle valeur – alors qu'elle en a massivement détruite de par le saut de compétitivité que l'utilisation de ses produits a engendré –, puisque ses produits, soumis à un droit d'auteur spécifique, ne nécessitent aucun support réel pour exister, puisqu'ils sont donc vendus et achetés en tant que pures pseudo-marchandises. Par suite, les brevets logiciels n'entrent dans le circuit économique que portés par ces pures pseudo-marchandises que sont les logiciels. Pourtant grâce à ces brevets logiciels, la « propriété intellectuelle » a pu accaparer des secteurs entiers de travaux intellectuels qui jusqu'ici échappaient à son emprise : méthodes de soins médicaux, d'apprentissage, d'optimisation fiscale, etc. L'impasse économique que cela constitue mériterait d'être analysée[70].
Enfin, il conviendrait d'étudier comment ces conclusions éclairent la frappante concomitance du développement de la « propriété intellectuelle » avec celui du capitalisme. Dans le précédent billet, nous avons vu comment les événements majeurs de la naissance de la « propriété intellectuelle » et de sa jeune croissance s'inscrivaient invariablement dans des moments essentiels de la formation du mode de production capitaliste. Il faudrait examiner l'importance exponentielle prise ces dernières décennies par la « propriété intellectuelle » et la replacer dans le contexte de crise interne du capitalisme[71] ; évaluer si les bouleversements du mode de fonctionnement du capitalisme dans les périodes keynésienne-fordiste puis néolibérale y ont eu une incidence ; si les évolutions du rôle économique de l'État ont influé sur son comportement en tant que garant des divers droits de « propriété intellectuelle » ; si la financiarisation accrue de l'économie va de pair avec les renforcements incessants des droits de « propriété intellectuelle » ; s'il existe une corrélation entre la chute vertigineuse de l'emploi de force de travail humaine et le fait que la « propriété intellectuelle » se fait de plus en plus hargneuse pour accaparer le travail créatif purement intellectuel ; si la face abstraite du travail intellectuel créatif – qui est de produire de la valeur imaginaire en quantité – n'a pas pris l'ascendant sur sa face concrète – le contenu qualitatif issu de ce travail, soit : la production, au choix, de connaissances, de savoirs, d'informations, d'idées, de pensées, etc. à chaque fois particuliers –, suivant ainsi la logique capitaliste faisant primer la production de valeur sur celle de valeur d'usage…
 L'exposé de toutes ces pistes de recherche prometteuses est certainement – je l'admets volontiers – trop lapidaire. Mais elles sortent du cadre de la présente étude. Je me devais toutefois de les mentionner en tant que celles-là prolongent celle-ci. Revenons maintenant à notre analyse, car si nous sommes parvenus à proposer une théorie sur l'essence de la « propriété intellectuelle » dans l'ordre économique – qui est le seul où elle existe réellement –, la critique serait incomplète si nous n'abordions pas la forme sous laquelle elle se présente et s'impose socialement à nous – et ce, sur tous les plans. Cette forme, c'est bien entendu celle de la propriété. Jusqu'ici nous ne l'avons considérée que comme un moyen contingent de signaler un objectif de marchandisation, d'indiquer que l'être réel de la « propriété intellectuelle » se situait dans le champ économique. Mais maintenant que nous avons explicité cette nature économique, nous pouvons considérer les implications qu'entraîne le choix de la forme spécifique de la propriété. En d'autres termes : il n'est pas innocent que la « propriété intellectuelle » soit appelée ainsi et il nous faut par conséquent déterminer quelle coupable intention charrie cette appellation lorsqu'elle est appliquée aux déterminations économiques que nous venons d'exposer.
L'exposé de toutes ces pistes de recherche prometteuses est certainement – je l'admets volontiers – trop lapidaire. Mais elles sortent du cadre de la présente étude. Je me devais toutefois de les mentionner en tant que celles-là prolongent celle-ci. Revenons maintenant à notre analyse, car si nous sommes parvenus à proposer une théorie sur l'essence de la « propriété intellectuelle » dans l'ordre économique – qui est le seul où elle existe réellement –, la critique serait incomplète si nous n'abordions pas la forme sous laquelle elle se présente et s'impose socialement à nous – et ce, sur tous les plans. Cette forme, c'est bien entendu celle de la propriété. Jusqu'ici nous ne l'avons considérée que comme un moyen contingent de signaler un objectif de marchandisation, d'indiquer que l'être réel de la « propriété intellectuelle » se situait dans le champ économique. Mais maintenant que nous avons explicité cette nature économique, nous pouvons considérer les implications qu'entraîne le choix de la forme spécifique de la propriété. En d'autres termes : il n'est pas innocent que la « propriété intellectuelle » soit appelée ainsi et il nous faut par conséquent déterminer quelle coupable intention charrie cette appellation lorsqu'elle est appliquée aux déterminations économiques que nous venons d'exposer.
Traitons d'emblée de l'adjectif « intellectuelle » car, avec tout ce que nous avons vu jusqu'ici, sa compréhension ne devrait poser aucune difficulté, voire nous sauter directement à la figure. Comment en effet ne pas y voir désigné le principe économique même qui est l'essence de la « propriété intellectuelle » : la séparation, l'isolement, l'abstraction de cette part que nous avons identifiée comme imaginaire ? Le mirage aurait d'ailleurs très bien pu revêtir une forme nommée « propriété imaginaire » si ce costume alternatif n'avait pas l'immense inconvénient d'être par trop transparent et laisser deviner son corps nu, sa réalité économique qui est précisément qu'il n'est pas réel, qu'il n'a d'autre substance qu'une pseudo-valeur imaginaire. Si la propriété était imaginaire, elle s'afficherait comme n'étant pas réelle. Mieux valait donc la qualifier d'intellectuelle. L'effet est identique : cela désigne l'objet de la « propriété intellectuelle », ce sur quoi elle porte, tout autant que ce sur quoi elle agit. Mais il y a plus dans ce choix terminologique, car à l'opposition « imaginaire / réel », se substitue celle entre intellectuel et matériel. La « propriété intellectuelle » précise ainsi ce qu'elle n'est pas : une propriété matérielle. On lui accordera donc de ne pas se comporter comme son contraire et l'on y projettera même une relation de supériorité par rapport à lui : la « propriété intellectuelle » est la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés
[72], c'est pour tout homme la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point
[73]. Et avec cet adjectif « intellectuel » qui emmène avec lui son double opposé « matériel », on plonge alors en plein dualisme cartésien, on nage dans le sujet transcendantal kantien, on éclabousse la réalité d'idéologie hégélienne. Bref, on barbote dans les sources philosophiques mêmes du capitalisme. On reproduit en outre ainsi la division artificielle[74], sur laquelle joue abondamment le mode de production capitaliste[75], entre travail intellectuel et travail manuel liée à la contradiction entre le travail intellectuel socialisé et le travail manuel individuel
[76].
 Mais intellectuelle plutôt qu'imaginaire, la « propriété intellectuelle » n'en reste pas moins propriété. Et c'est de toute évidence ce substantif qui donne sa couleur dominante à la forme chimérique du mirage. Il n'est qu'à constater dans toutes les controverses qu'elle a suscitées, combien la discussion du caractère de propriété a toujours de loin été la plus fournie, alors que sa qualification en tant qu'intellectuelle n'est pratiquement jamais remise en cause. Pourtant l'abstraction réalisée – comme nous venons de le voir – par l'épithète est également celle poursuivie par le nom. Car qu'est-ce que la propriété, sinon et avant tout un rapport ? Et tout rapport induit une séparation entre les deux termes qu'il relie[77]. En l'espèce, la notion de propriété introduit une séparation de fait entre un propriétaire et une chose appropriée, instituant par là même un sujet possédant et un objet possédé[78]. Ainsi, le déchirement consistant à extraire la partie imaginaire du substrat réel qui l'englobe, se double d'un arrachement au producteur de son produit, condition sine qua non pour que ce dernier puisse entrer dans le règne fétichiste de la marchandise.
Mais intellectuelle plutôt qu'imaginaire, la « propriété intellectuelle » n'en reste pas moins propriété. Et c'est de toute évidence ce substantif qui donne sa couleur dominante à la forme chimérique du mirage. Il n'est qu'à constater dans toutes les controverses qu'elle a suscitées, combien la discussion du caractère de propriété a toujours de loin été la plus fournie, alors que sa qualification en tant qu'intellectuelle n'est pratiquement jamais remise en cause. Pourtant l'abstraction réalisée – comme nous venons de le voir – par l'épithète est également celle poursuivie par le nom. Car qu'est-ce que la propriété, sinon et avant tout un rapport ? Et tout rapport induit une séparation entre les deux termes qu'il relie[77]. En l'espèce, la notion de propriété introduit une séparation de fait entre un propriétaire et une chose appropriée, instituant par là même un sujet possédant et un objet possédé[78]. Ainsi, le déchirement consistant à extraire la partie imaginaire du substrat réel qui l'englobe, se double d'un arrachement au producteur de son produit, condition sine qua non pour que ce dernier puisse entrer dans le règne fétichiste de la marchandise.
À ce double processus de séparation s'en ajoute un troisième. En effet, s'il était pratiquement opportun, en se parant d'un ornement intellectuel, de se distinguer et surpasser la propriété en général, l'uniforme de propriété redevient bien commode à endosser pour bénéficier des attributs que d'autorité il confère. Car toute propriété permet l'échange marchand en réalisant l'unicité d'existence de la marchandise appropriée. Et tout échange marchand de propriété s'avère être, en négatif, une privation de propriété, tant pour le vendeur que pour l'acheteur, qui tous deux, dans l'acte d'échange, se voient privés l'un de sa marchandise, l'autre de la quantité équivalente de son argent. Toute intellectuelle qu'elle est, la « propriété intellectuelle » ne se dépare pas de cette qualité privative de toute propriété. C'est même là son sens juridique plein : quel que soit le droit de « propriété intellectuelle » considéré, et donc l'ensemble de la « propriété intellectuelle », en privatisant ses objets, on prive d'accès quiconque n'en est pas propriétaire, c'est-à-dire la société en général. Or, les objets de la « propriété intellectuelle », ce sont les produits du travail intellectuel créatif. Mais ceux-ci sont tout à la fois les moyens de production de ce même travail. Le travail créatif purement intellectuel n'a besoin pour s'effectuer de rien d'autre que de tout le travail créatif intellectuel accompli par ailleurs et de tout temps, en partie, la coopération avec des hommes vivants, en partie l'utilisation des travaux de nos prédécesseurs
[79].
Sans cette triple séparation, il ne pourrait être question que le travail intellectuel créatif participe de la production marchande. La séparation du travailleur des produits de son travail, ainsi que de ses moyens de production est une condition nécessaire de la formation du mode de production capitaliste. Or, ces séparations n'auraient aucun sens s'agissant du travail créatif purement intellectuel… si la créature fantasmagorique qu'est la « propriété intellectuelle » ne déployait sa puissance d'agir. Ce travail n'aurait d'ailleurs aucune raison d'être considéré autrement que pour ce qu'il produit concrètement, c'est-à-dire le contenu même, la substance des savoirs, connaissances, informations, etc. qu'il crée. Sans la « propriété intellectuelle », ce travail n'aurait aucune face abstraite, qui – nous l'avons vu – se réduit à la production d'une quantité de valeur imaginaire. Et c'est parce qu'elle apparaît comme propriété, par la forme même du mirage, que la « propriété intellectuelle » parvient à ce triple prodige de séparation.
 Nous devrions d'ailleurs plutôt parler d'un triple maléfice, car cet acte de séparation – quel que soit l'un des trois angles sous lequel on le considère – s'avère de toute évidence être une violence. Violence parce que, ainsi que nous venons de le voir, les séparations qu'elle opère vont en quelque sorte « contre nature ». Il n'est qu'à voir l'effort nécessaire qu'il faut pour arracher à la marchandise par laquelle la « propriété intellectuelle » se présente naturellement sur le marché, cette part imaginaire que l'on veut faire rentrer de force, pour elle même, sur ce même marché. Et toute la théorie économique proposée ci-dessus n'est que l'illustration de cette violence aveugle, puisque même selon les lois du monde merveilleux de l'économie, toute cette brutalité ne dégage en fin de compte aucune valeur réelle, juste de la valeur imaginaire.
Nous devrions d'ailleurs plutôt parler d'un triple maléfice, car cet acte de séparation – quel que soit l'un des trois angles sous lequel on le considère – s'avère de toute évidence être une violence. Violence parce que, ainsi que nous venons de le voir, les séparations qu'elle opère vont en quelque sorte « contre nature ». Il n'est qu'à voir l'effort nécessaire qu'il faut pour arracher à la marchandise par laquelle la « propriété intellectuelle » se présente naturellement sur le marché, cette part imaginaire que l'on veut faire rentrer de force, pour elle même, sur ce même marché. Et toute la théorie économique proposée ci-dessus n'est que l'illustration de cette violence aveugle, puisque même selon les lois du monde merveilleux de l'économie, toute cette brutalité ne dégage en fin de compte aucune valeur réelle, juste de la valeur imaginaire.
Violence on ne peut plus manifeste dans la séparation des cerveaux humains d'avec les moyens de production du travail créatif intellectuel dont ils sont capables. C'est d'ailleurs sur cette violence-là que porte l'essentiel de la critique classique de la « propriété intellectuelle ». Comment celle-ci échapperait-elle au déferlement croissant de férocité déployée ces derniers temps par les détenteurs de « propriété intellectuelle » pour défendre cette dernière ? On en arrive à parler de « guerre thermonucléaire » à propos des batailles gigantesques que se livrent les fabricants dans le domaine des télécommunications à coup de brevets – logiciels pour la plupart. Les industries du divertissement en sont venues à employer des moyens de coercition technique – les DRM – pour faire respecter – le terme anglo-saxon enforce est significatif – les droits d'auteurs qu'elles ont accumulés. Et l'on notera que ces exemples ne sont la plupart du temps pas rapportés comme concernant des brevets ou des droits d'auteurs, mais la « propriété intellectuelle » elle-même, avec tout l'aspect menaçant que cela peut susciter. La « propriété intellectuelle » est ainsi devenue avant toute chose une arme de guerre économique. Il faut bien voir qu'à chaque assaut de la « propriété intellectuelle », c'est la puissance d'agir d'autrui et, au final, de la société dans son ensemble, qui se voit diminuée par cet arrachement de ce qui la nourrit.
Mais c'est dans la séparation des producteurs de travail créatif purement intellectuel d'avec leurs produits que la violence de la « propriété intellectuelle » déploie toute sa sauvagerie de manière insidieuse. Car ici, cette séparation est une abstraction qui agit au beau milieu du cerveau humain et, du fait qu'elle est une propriété, nécessite une réification, une chosification, une objectivation du produit de ce cerveau afin de le considérer comme un objet et qu'ainsi la relation entre ce dernier et le sujet qui l'a produit se situe au niveau de l'avoir. Alors que, ce que cette objectivation arrache à l'homme, se trouve pris dans un rapport qui s'effectue naturellement dans l'ordre de l'être. Ce que la « propriété intellectuelle » prend pour un objet et transforme en objet, c'est tout bonnement une partie de l'homme lui-même. Car enfin, quel est cet objet de la « propriété intellectuelle », cette part imaginaire que nous avons identifiée sans jamais nommer ce qu'elle est réellement ? Qu'est-ce qui doit être pris comme une chose dans le but express de la posséder, d'en disposer à sa guise et d'assoir ainsi sa domination sur elle ? Toutes les analyses existantes, si elle proposent chacune une dénomination différente – objets abstraits, information[80], savoir, connaissance[81], idée, pensée, produit immatériel, objet cognitif, etc. –, ont en commun d'opérer la même réification qu'elles sont censées critiquer[82]. Considérer comme objet, comme chose, le produit du travail intellectuel créatif ne peut mener qu'à une impasse[83]. Car ce que le cerveau humain accomplit en produisant ce travail, c'est une pensée en acte, c'est l'acte de penser[84]. C'est un agir qui est l'essence même de l'être, son effectuation, son actualisation.
C'est donc au plus profond de l'intimité du sujet que s'insinue la « propriété intellectuelle ». C'est ainsi toute personnalité qui est évacuée lorsqu'on ne considère plus toute création intellectuelle, via la « propriété intellectuelle », que sous l'angle de sa valeur d'échange – quand bien même il ne s'agit que de pseudo-valeur –, en évacuant sa valeur d'usage, soit le contenu même de cette création intellectuelle. C'est en quelque sorte la subjectivité même que la « propriété intellectuelle » s'efforce d'objectiver. Qu'on n'aille pas prétendre qu'un tel tour de force ne nécessite pas une barbarie d'une intensité effrayante ! Car penser ne peut s'objectiver naturellement que dans le langage. Toute autre réification de la pensée ne peut être le fait que d'une atteinte à l'intégrité de l'être. Et c'est précisément le crime commis par la « propriété intellectuelle ».
 Alors comment qualifier une telle violence – se moquant de toute personnalité jusque dans son intégrité pour ne considérer que des objets qu'elle doit contraindre par la force à se soumettre à sa domination –, sinon de viol ? La « propriété intellectuelle » c'est le viol !
Alors comment qualifier une telle violence – se moquant de toute personnalité jusque dans son intégrité pour ne considérer que des objets qu'elle doit contraindre par la force à se soumettre à sa domination –, sinon de viol ? La « propriété intellectuelle » c'est le viol !
Et c'est pour cette raison qu'il faut dénoncer, avec Richard Stallman, cette monstruosité séductrice. Mais il faut bien avoir conscience d'opérer ainsi, dans le même mouvement, une critique du capitalisme, de la société basée sur la production de marchandises, de valeur, sur l'argent et le travail abstrait[85]. Car ce monstre qu'est la « propriété intellectuelle » ne s'autorise à s'adonner au crime intolérable qu'est le viol, que parce qu'il se meut dans le monde cauchemardesque[86] qui l'a engendré, celui de l'économie, c'est-à-dire du capitalisme.
Toute critique de la « propriété intellectuelle » en tant que telle s'inscrit dans une critique du capitalisme, sinon elle n'a aucun sens, celle-là n'existant qu'au sein de celui-ci. Mais, à l'inverse, la critique de l'économie se doit de prendre en compte la critique de la « propriété intellectuelle », puisque cette créature immonde sévit dans l'univers surnaturel et terrifiant de l'économie et y produit des effets qui l'impactent nécessairement.
Notes
[1] Karl Marx, Le Capital – Critique de l'économie politique, Livre troisième : Le procès d'ensemble de la production capitaliste, (trad. Catherine Cohen-Solal et de Gilbert Badia), Éditions sociales, Paris, 1976, p. 113, 114 : V. – Économie résultant d'inventions.
[2] Karl Marx, Le chapitre VI – Manuscrits de 1863-1867, traduction nouvelle préparée et présentée par Gérard Cornillet, Laurent Prost et Lucien Sève, éditions sociales-Geme, 2010, p. 220, 221 : Par exemple, Milton, qui écrivit le paradis perdu, était un travailleur improductif. Par contre, l'écrivain qui fabrique pour fournir à son libraire est un travailleur productif. Milton a produit Le Paradis perdu comme un vers à soie produit la soie, comme une mise en action de sa nature. Il vendit ensuite son produit pour 5 £ et de la sorte devint marchand. Mais le littérateur prolétaire de Leipzig qui produit des livres sur commande de son libraire, par exemple des abrégés d'économie politique, se rapproche d'un travailleur productif pour autant que sa production est subsumée sous le capital et n'a lieu que pour sa valorisation. Une cantatrice qui chante comme l'oiseau est un travailleur improductif. Si elle vend son chant pour de l'argent, elle est dans cette mesure salariée ou marchande. Mais la même cantatrice, engagée par un entrepreneur qui la fait chanter pour gagner de l'argent, est un travailleur productif, car elle produit directement du capital. Un maître d'école qui enseigne autrui n'est pas un travailleur productif. Mais un maître d'école engagé avec d'autres comme salarié par un institut pour valoriser par son travail l'argent de l'entrepreneur de cette institution vendeuse de savoir est un travailleur productif. Cependant la plupart de ces travaux, considérés du point de vue de leur forme, ne sont qu'à peine subsumés formellement sous le capital, et appartiennent bien plutôt aux formes de transition. Au total, les travaux qui ne sont utilisés que comme services, n'étant pas séparables des travailleurs et donc ne se convertissant pas en produits existant en dehors d'eux à titre de marchandises autonomes, bien qu'ils puissent être exploités de façon capitaliste directe, représentent des grandeurs infinitésimales par rapport à la masse de la production capitaliste. Pour cette raison ils sont à laisser de côté et à traiter seulement avec le salariat, sous la catégorie du travail salarié qui n'est pas en même temps du travail productif. Le même travail (par exemple de jardinier, de tailleur, etc.) peut être exécuté par un même travailleur au service d'un industriel capitaliste ou d'un consommateur immédiat, etc. Dans les deux cas c'est du travail de salarié ou de journalier, mais dans le premier cas il est productif et dans l'autre improductif, parce que dans le premier cas il produit du capital, dans l'autre non ; parce que dans le premier cas son travail constitue un facteur de l'autovalorisation du capital, ce qu'il n'est pas dans l'autre.
; p. 226, 227 : En ce qui concerne la production non matérielle, même lorsque c'est uniquement pour l'échange qu'elle produit des marchandises, deux cas sont possibles : 1) Elle a pour résultat des marchandises qui subsistent séparément de leurs producteurs, qui donc peuvent circuler en tant que marchandises dans l'intervalle entre production et consommation, tels les livres, les tableaux, productions artistique de toute sorte qui se distinguent de l'activité artistiques par laquelle l'artiste les a exécutées. Ici la production capitaliste ne peut jouer que dans une très faible mesure. Ces gens, dans la mesure où ils n'ont pas, comme les sculpteurs, etc., des compagnons, etc., travaillent le plus souvent (s'ils ne sont pas autonomes) pour un marchand capitaliste, par exemple un libraire, rapport qui ne représente lui-même qu'une forme de transition au mode de production capitaliste simplement formel. Que dans ces formes de transition l'exploitation du travail soit justement à son maximum ne change rien à la chose ; 2) Le produit n'est pas séparable de l'acte qui le produit. Ici encore le mode de production capitaliste ne peut intervenir que de façon limitée et dans de rares domaines, en fonction de la nature de la chose. (Je veux le médecin, non son garçon de courses.) Dans les institutions enseignantes, par exemple, les enseignants peuvent n'être que des salariés pour le compte de l'entrepreneur de la fabrique-à-apprendre. Pareils éléments n'entrent pas en ligne de compte dans l'ensemble de la production capitaliste.
[3] Cf. Yann Moulier Boutang, Le capitalisme cognitif – La nouvelle grande transformation, Éditions Amsterdam, 2007, p. 136 : Il s'agit d'un des piliers de ce que l'on appelait un “mode de production”, à savoir le régime des droits de propriété et des modes d'appropriation des bien matériels (droit réel), des personnes (droit personnel). Il faut également y inclure les droits sur les biens immatériels (ce que peut être la propriété “intellectuelle” […]).
; Yann Moulier Boutang, Droits de propriété intellectuelle, terra nullius et capitalisme cognitif, Multitudes 2/2010 (n° 41) , p. 66-72 : L'apprentissage, l'invention, l'innovation, la création artistique qui possèdent des caractéristiques des biens publics tels que les définit l'économie deviennent le cœur de la valeur économique. Ils ne peuvent cependant être transformés en biens marchands que par l'attribution juridique d'un monopole de détention à une entité privée (marque, brevet, droit d'auteur).
; Enzo Rullani, Le capitalisme cognitif : du déjà vu ?, Multitudes, n°2, mai 2000 : La valeur d'échange de la connaissance est donc entièrement liée à la capacité pratique de limiter sa diffusion libre. C'est-à-dire de limiter avec des moyens juridiques (brevets, droits d'auteur, licences, contrats) ou monopolistes, la possibilité de copier, d'imiter, de “réinventer”, d'apprendre des connaissances des autres.
[4] Ernst Lohoff, Norbert Trenkle, La grande dévalorisation, essai traduit de l'allemand par Paul Braun, Gérard Briche et Vincent Roulet, Post-éditions, 2014.
[5] André Gorz, Richesse sans valeur, valeur sans richesse, Cadernos OHV Ideias, n° 31, SãoPaulo, Unisos, 2005 : Pour capitaliser et valoriser les connaissances, l'entreprise capitaliste doit les privatiser, rendre rare par appropriation privée et brevetage, ce qui est potentiellement abondant et gratuit. Et cette privatisation et raréfaction ont un coût très élevé, car il faut protéger le monopole temporaire que la firme acquiert contre des connaissances équivalentes et nouvelles, contre les imitations et réinventions, en verrouillant le marché contre d'éventuels concurrents par des campagnes de marketing et par des innovations qui prennent les éventuels concurrents de vitesse. Les connaissances ne sont pas des marchandises comme les autres, et leur valeur commerciale, monétaire, est toujours une construction artificielle. Les traiter comme du “capital immatériel” et les coter en Bourse, c'est toujours assigner une valeur fictive à ce qui n'a pas de valeur mesurable. Que vaut par exemple le capital de Coca Cola, de Nike, de Mc Donald's, toutes firmes qui ne possèdent pas de capital matériel, mais seulement un know how, une organisation commerciale et un nom de marque réputé ? Que vaut même Microsoft ? La réponse dépend essentiellement de l'estimation boursière des rentes de monopole que ces firmes espèrent obtenir. On dit que l'effondrement du Nasdaq en 2001 a appauvri le monde de 4000 milliards de dollars. Mais ceux-ci n'ont jamais eu qu'une existence fictive. Si l'effondrement des “valeurs immatérielles” a démontré quelque chose, c'est essentiellement la différence intrinsèque qu'il y a à vouloir faire fonctionner le capital immatériel, comme un capital et l'économie de la connaissance, comme un capitalisme. L'absence d'étalon de mesure commun à la connaissance, au travail immatériel et au capital, la baisse de la valeur des produits matériels et l'augmentation artificielle de la valeur d'échange de l'immatériel disqualifient les instruments de mesure macroéconomique. La création de richesses ne se laisse plus mesurer en termes monétaires. Les fondements de l'économie politique s'écroulent. C'est en ce sens que l'économie de la connaissance est la crise du capitalisme.
[6] Robert Kurz, L'industrie culturelle au XXIe siècle. De l'actualité du concept d'Adorno et Horkeimer, Exit !, n° 9, mars 2012, traduit de l'allemand par Wolfgang Kukulies, Illusio, n° 12/13, 2014.
[7] André Gorz, L'immatériel. Connaissance, valeur et capital, Galilée, Paris, 2003
[8] André Gorz, L'immatériel, op. cit., p. 74-76 : À la confusion entre les “nouvelles formes du capital” et le capital au sens de l'économie politique s'ajoute la confusion entre la “valeur” (d'échange) au sens économique et la “valeur” qui a sa source dans la connaissance (et l'expérience, la culture, les liens sociaux, etc.). […] Or, il n'y a aucun rapport de proportionnalité (ni, a fortiori, d'équivalence) entre ces deux “valeurs”. La valeur argent ne reflète en rien la valeur esthétique, laquelle ne reflète en rien la valeur travail. La “valeur intrinsèque” se situe par essence en dehors de l'économie. […] Les créations esthétiques, cognitives, idéelles ne sont jamais réellement “échangées” ni vendues, puisque “celui qui [les] transmet ne les perd pas, ne se dépouille pas en les socialisant” et que leur “échange” bénéficie à toutes les parties concernées : elles s'enrichissent de leurs dons.
[9] Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property, Aldershot, Brookfield, Dartmouth, 1996 (je traduis) : [la propriété intellectuelle] sert à protéger l'investissement par les membres individuels de la classe capitaliste dans un mode de production basé sur les objets abstraits. La propriété intellectuelles, en d'autres termes, est en premier lieu une question d'organisation et d'entretien de la production et un ensemble de relations économiques, plutôt qu'une incitation à la production pour les individus. Les droits de propriété intellectuelle, davantage qu'être un stimulus pour la création, forment la base juridique sur laquelle une classe organise la production par une autre.
[10] André Gorz, Richesse sans valeur, op. cit. : Les expressions “économie de la connaissance”, “société de la connaissance” (knowledge society) circulent depuis trente-cinq ans dans la littérature anglo-saxonne. Elles signifient, d'une part, comme je l'ai déjà remarqué, que le travail, pratiquement tout travail dans tous les types de production, exige du travailleur des capacités imaginatives, communicationnelles, cognitives, etc., bref, l'apport d'un savoir vivant qu'il doit puiser en lui-même. Le travail n'est plus mesurable par le temps seulement qu'on y passe. L'implication personnelle qu'il exige fait qu'il n'y a pratiquement plus d'étalon de mesure universel pour l'évaluer. Sa composante immatérielle revêt une importance plus grande que la dépense d'énergie physique. Il en va de même pour la valeur marchande des produits. Leur substance matérielle demande de moins en moins de travail, leur coût est faible et leur prix tend donc à baisser. Pour contrer cette tendance à la baisse, les firmes transforment les produits matériels en vecteurs de contenus immatériels, symboliques, affectifs, esthétiques. Ce n'est plus leur valeur pratique qui compte, mais la désirabilité subjective que doivent leur donner l'identité, le prestige, la personnalité qu'ils confèrent à leur propriétaire ou la qualité des connaissances dont ils sont censés être le résultat. Vous avez donc une très importante industrie, celle du marketing et de la publicité, qui ne produit que des symboles, des images, des messages, des styles, des modes, c'est-à-dire les dimensions immatérielles qui feront vendre les marchandises matérielles à un prix élevé et ne cesseront d'innover pour démoder ce qui existe et lancer des nouveautés. C'est là aussi une façon de combattre l'abondance qui fait baisser les prix et de produire de la rareté – le nouveau est toujours rare, au début – qui les fera augmenter. Même les produits d'usage quotidien et les aliments sont commercialisés selon cette méthode : par exemple les produits laitiers ou les lessives. Le logo des différentes firmes est destiné à conférer à leurs produits une spécificité qui les rends incomparables, non échangeables avec d'autres. Tout comme l'importance de sa composante immatérielle rendait le travail non mesurable selon un étalon universel, l'importance de la composante immatérielle des marchandises les soustrait, temporairement au moins, à la concurrence en les dotant de qualités symboliques qui échappent à la comparaison et à la mesure.
[11] André Gorz, La sortie du capitalisme a déjà commencé, 17 septembre 2007, EcoRev' et 16 septembre 2007, université d'Utopia ; Ernst Lohoff, Norbert Trenkle, op. cit..
[12] Karl Marx, Le Capital, livre 3, op. cit., p. 581 : Quelle que soit la forme spécifique de la rente, tous les types de rente ont cependant ceci de commun que l'appropriation de la rente est la forme économique sous laquelle se réalise la propriété foncière ; et que, d'autre part, la rente foncière suppose la propriété foncière : certains individus sont propriétaires de parcelles déterminées du globe
.
[13] Accord sur les aspects des droits de « propriété intellectuelle » qui touchent au commerce (ADPIC), article 1.2 : Aux fins du présent accord, l'expression “propriété intellectuelle” désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de la Partie II.
[14] Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, article 2 (1).
[15] Accord sur les aspects des droits de « propriété intellectuelle » qui touchent au commerce (ADPIC), article 15.1.
[16] André Gorz, L'immatériel, op. cit., p. 63 : la marque doit doter le produit d'une valeur symbolique non mesurable qui l'emporte sur sa valeur utilitaire et d'échange. Elle doit rendre l'article de marque non interchangeable avec des articles destinés au même usage et le doter d'une valeur artistique ou esthétique, sociale et expressive. La marque doit fonctionner de la même manière que la signature d'un artiste réputé, attestant que l'objet n'est pas une vulgaire marchandise mais un produit rare, incomparable. Elle dote le produit d'une valeur symbolique dont la firme a le monopole et qui le soustrait au moins temporairement à la concurrence. […] Dans la mesure où la valeur symbolique du produit devient la source principale du profit, la création de valeur se déplace sur un terrain où les progrès de productivité peuvent rester sans effet notable sur le niveau des prix.
[17] Accord sur les aspects des droits de « propriété intellectuelle » qui touchent au commerce (ADPIC), article 22.1.
[18] André Gorz, L'immatériel, op. cit., p. 57, 58 : les produits matériels et une proportion croissante des services sont travestis en vecteurs de “connaissances” brevetés. Celles-ci confèrent à la marchandise une “valeur” sans rapport avec ce qu'on entendait jusqu'ici par “valeur économique” (d'échange) : à savoir une valeur quasi artistique, symbolique de ce qui est inimitable et sans équivalent.
[19] Traité sur la « propriété intellectuelle » en matière de circuits intégrés (Traité de Washington), article 3 (2) (a).
[20] À ce stade de notre étude, nous pouvons rapprocher ces marchandises complexes de la notion de travail complexe, cf. Karl Marx, Le Capital – Critique de l'économie politique, Livre premier : Le procès de production du capital, (trad. Jean-Pierre Lefebvre (dir.)), Quatrième édition allemande, Quadrige / PUF, Paris, 1993 (1867), p. 50 : Le travail plus complexe ne vaut que comme potentialisation ou plutôt comme multiplication de travail simple, si bien qu'un quantum moindre de travail complexe sera égal à un quantum plus grand de travail simple. L'expérience montre que cette réduction se produit en permanence. Une marchandise aura beau être le produit du travail le plus complexe possible, sa valeur la met à parité avec un produit de travail simple ; elle ne représente donc elle-même qu'un quantum déterminé de travail simple
; nous verrons cependant que les marchandises complexes le sont pour des raisons… plus complexes !
[21] Alain Bihr, Universaliser le salaire ou supprimer le salariat ? A propos de « L'enjeu du salaire » de Bernard Friot, À l'encontre, La Brèche, 23 juin 2013 : Confondre ainsi valeur et valeur d'échange n'est pas sans conséquence. Cela témoigne de l'incompréhension de ce qu'est la valeur pour Marx, à savoir la forme énigmatique et fétichiste sous laquelle se réalise le caractère social des multiples activités productives dès lors qu'elles sont prises dans les rets de la propriété privée des moyens de production et de la division marchande du travail social (l'une et l'autre allant de pair). Dès lors, en effet, ces activités ne peuvent plus confirmer leur caractère de travaux socialement nécessaires (du double point de vue de leur qualité et de leur quantité), partant le caractère de valeurs d'usage sociales de leurs produits, que par l'intermédiaire de l'échange marchand entre ces derniers. Autrement dit, pour Marx, les rapports sociaux qui font exister la valeur sont la propriété privée des moyens de production et la division marchande du travail social ; en dehors de ces rapports, la valeur n'a ni sens ni existence ; et, dans le cadre de ces rapports, elle est la seule forme sous laquelle se manifeste et se masque, à la fois, aux yeux des producteurs le caractère social tant de leurs activités productives que de leurs produits. Forme dont le caractère nécessairement fétichiste conduit à la naturaliser : la qualité de valeur des marchandises (le fait qu'elles aient une valeur, qui les rend échangeables et commensurables) tout comme leur quantité de valeur (partant les proportions dans lesquelles elles s'échangent entre elles ou s'échangent contre de la monnaie, leur équivalent général) semblent constituer des qualités ou propriétés substantielles, qu'elles posséderaient en et par elles-mêmes, qui semblent ne rien devoir aux hommes qui en sont les producteurs et qui leur permettraient de vivre de leur vie propre sur le marché, en s'autonomisant totalement par rapport à eux, jusqu'à se retourner contre eux pour les ruiner.
[22] Karl Marx, Le Capital, livre 1, op. cit., p. 39.
[23] Karl Marx, Le Capital, livre 1, op. cit., p. 663, 664 : En outre, le développement de la production capitaliste fait de l'accroissement constant du capital placé dans une entreprise industrielle une nécessité, et la concurrence impose à chaque capitaliste individuel de se soumettre à la contrainte extérieure des lois immanentes du mode de production capitaliste. Elle contraint à étendre sans cesse son capital pour le conserver, et il ne peut continuer de l'étendre qu'au moyen d'une accumulation progressive.
; Michel Henry, Introduction à la pensée de Marx, In: Revue Philosophique de Louvain, Troisième série, Tome 67, N°94, 1969, p. 262 : Que l'économique soit une abstraction, l'abstraction de la vie subjective concrète, et qu'il y renvoie nécessairement, c'est ce que montre non seulement sa possibilité même, la possibilité de la valeur, mais plus encore son développement. Celui-ci se produit et s'exaspère lorsque la valeur devient précisément le but de la production, lorsque la production n'est plus dirigée vers la satisfaction des besoins, vers la valeur d'usage mais vise au contraire la création de la valeur comme telle et son augmentation, lorsqu'elle n'est plus rien d'autre qu'une mise en valeur de la valeur. C'est ce qui se produit dans le capital. Dans le capital le procès matériel de production est devenu un procès de valorisation. La transformation de procès matériel de production en un procès de valorisation suppose que la totalité des éléments matériels du procès de production soient convertibles en valeur. Ce n'est pas seulement le résultat de ce procès, le produit, la valeur d'usage qui doit pouvoir s'échanger : la matière première, l'instrument de travail et les matières auxiliaires, le travail vivant lui-même doivent le faire, c'est-à-dire se proposer sur le marché comme valeur d'échange, comme marchandise.
[24] Karl Marx, Le chapitre VI, op. cit., p. 129 : C'est précisément en tant qu'il crée de la valeur que le travail vivant est, au cours du procès de valorisation, continuellement incorporé au travail objectalisé. En tant qu'effort, dépense de force vitale, le travail est l'activité personnelle du travailleur. Mais en tant qu'il crée de la valeur, en tant qu'il est impliqué dans le procès de son objectalisation, le travail du travailleur, dès qu'il entre dans le procès de production, est lui-même un mode d'existence de la valeur du capital, il lui est incorporé. Cette force qui conserve de la valeur et en crée de nouvelles est donc la force du capital et ce procès apparaît comme le procès de son autovalorisation, et plus encore l'appauvrissement du travailleur qui, en même temps qu'il crée de la valeur, la crée comme une valeur qui lui est étrangère.
[25] Karl Marx, Le Capital, livre 1, op. cit., p. 406 : Si, à l'origine, le travailleur vendait sa force de travail au capital parce que lui manquaient les moyens matériels de produire une marchandise, désormais sa force de travail individuelle n'est plus elle-même d'aucun service si elle n'est pas vendue au capital. Elle ne fonctionne plus que dans un système de connexion qui n'existe lui-même qu'après qu'elle a été vendue, dans l'atelier du capitaliste. Rendue inapte, par sa conformation naturelle à faire quelque chose d'autonome, l'ouvrier de manufacture ne développe plus d'activité productive que comme accessoire de l'atelier du capitaliste. De même que le peuple élu portait inscrit sur le front qu'il était la propriété de Jéhova[h], la division du travail inscrit au fer rouge sur l'ouvrier de manufacture la marque qui le désigne comme propriété du capital. Tout l'ensemble de connaissances, de clairvoyance et de volonté que le paysan ou l'artisan indépendants peuvent développer, y compris à petite échelle, un peu comme le sauvage exerce tout art de la guerre à la façon d'une ruse personnelle, tout cela n'est plus maintenant requis que pour le tout de l'atelier. L'échelle des potentialités spirituelles de la production s'agrandit d'un côté, parce que de beaucoup d'autres côtés elles disparaissent. Ce que les travailleurs partiels perdent se concentre face à eux, dans le capital. L'un des produit de la division manufacturière du travail est de leur opposer les potentialités spirituelles du procès matériel de production comme une propriété d'autrui et un pouvoir qui les domine. Ce processus de scission commence dans la coopération simple, là où le capitaliste représente face aux travailleurs singuliers l'unité et la volonté du corps de travail social. Il se développe dans la manufacture qui mutile l'ouvrier en en faisant un travailleur partiel. Il s'achève dans la grande industrie qui sépare la science, en tant que potentialité productive autonome, du travail, et la met de force au service du capital.
[26] Alain Bihr, op. cit. : Et la mesure de la valeur par le travail abstrait n'est pas davantage une convention arbitraire : le rapport d'échange pose le travail abstrait comme la seule substance possible de la valeur et, par conséquent, comme sa mesure ; et c'est lui, de même, qui exige que tout travail concret soit réduit à du travail abstrait dès lors que le premier n'est plus destiné à produire immédiatement des valeurs d'usage mais à former de la valeur, qui plus est de la survaleur (plus-value). C'est si peu une convention arbitraire que Marx consacre de longues pages à analyser toutes les transformations que le capital (le rapport capitaliste de production) doit faire subir aux procès de travail concret dont il s'empare (par l'intermédiaire de la propriété privée des moyens de production et de l'achat-vente de la force de travail) pour parvenir à se valoriser, autrement dit pour le transformer en travail abstrait, en ce travail social, homogène et moyen, qui seul forme de la valeur. C'est tout l'objet de la section IV du Livre I du Capital, dans laquelle Marx expose les différents moments de ce processus d'appropriation capitaliste, depuis la coopération jusqu'à la mécanisation qu'opère la grande industrie en passant par la manufacture, qui tout à la fois socialise le procès de travail (substitue un travail collectif au travailleur individuel comme sujet de ce procès), autonomise le capital au sein de ce procès sous forme d'un travail mort (le système des machines) qui non seulement domine le travail vivant du travailleur collectif mais encore s'empare progressivement de toutes ses fonctions productives et exproprie ainsi le travailleur individuel de la maîtrise de son propre procès de travail, en le réduisant de plus en plus à du travail simple. Un processus qui n'a cessé de se poursuivre depuis Marx, sous forme des vagues successives de taylorisation, mécanisation fordiste et, aujourd'hui, d'automation. Ainsi le concept de travail abstrait ne fait que définir le destin de tout travail concret (de toute activité productive) dès lors que le capital s'en empare pour en faire le moyen de sa propre valorisation.
[27] Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858 dits Grundrisse, ouvrage publié sous la responsabilité de Jean-Pierre Lefebvre, 2011, Paris, La Dispute/Éditions Sociales, p. 285 : Si le travailleur a seulement besoin d'une demi-journée de travail pour vivre une journée entière, pour perpétuer son existence de travailleur, il n'a besoin de travailler qu'une demi-journée. La deuxième moitié de la journée de travail est du travail forcé, du surtravail.
[28] Karl Marx, Le Capital, livre 3, op. cit., p. 585 : Aucun producteur pris isolément, l'industriel pas plus que l'agriculteur, ne produit de valeur ou de marchandise. Leur produit ne devient valeur et marchandise que dans un contexte social défini. Primo dans la mesure où il représente du travail social, le temps de travail propre du producteur n'apparaissant donc que comme fraction du temps de travail social ; deuxièmement, ce caractère social de son travail apparaît comme un caractère social de son produit qui s'exprime dans son caractère monétaire et dans son pouvoir général d'échange, déterminé par le prix.
[29] Michel Henry, op. cit., p. 260 : Immédiatement après avoir dit que le travail subjectif particulier ne peut être échangé par l'individu qui l'accomplit, Marx ajoute : “Pour pouvoir l'échanger universellement, il doit d'abord disposer d'un intermédiaire et prendre une forme différente de lui-même”. La forme différente de lui-même prise par le travail subjectif réel pour pouvoir s'échanger, c'est le travail social, c'est une certaine quantité de ce travail social, quantité qui définit effectivement la valeur d'échange qui sera celle du produit de ce travail réel. Comment passe-t-on du travail subjectif réel à cette quantité de travail qu'on lui fait correspondre ? Comment s'accomplit, en d'autres termes, la généalogie de l'économie à partir de la vie ? Par une abstraction. Le travail économique, social, est pour Marx le travail abstrait. Cette abstraction revêt diverses formes. À l'effort subjectif du travail vivant, on substitue son cadre extérieur, le cadre temporel objectif où il s'inscrit, le jour, la demi- journée, l'heure. Telle activité devient tant d'heures de travail. À la qualité de cette activité, à sa difficulté subjective propre, on substitue un prototype, le prototype du travail simple ou du travail complexe, c'est-à-dire du travail qualifié. On estimera par exemple qu'une heure de travail qualifié équivaut à deux heures de travail simple. Enfin, en ce qui concerne le travail nécessaire à la fabrication de tel produit, on substituera, ici encore, au travail réel effectué par tel ouvrier, l'idée de la quantité d'énergie qu'il devrait normalement dépenser pour parvenir au résultat en question. Le travail nécessaire n'est donc plus le travail effectivement accompli, mais l'idée du travail à accomplir, une norme idéale de travail comprise comme une moyenne et définie elle-même de façon abstraite.
[30] Karl Marx, Le Capital, livre 1, op. cit., p. 50 : Si l'on fait abstraction du caractère déterminé de l'activité productive et donc du caractère utile du travail, il reste que celui-ci est une dépense de force de travail humaine. La confection et le tissage bien qu'étant des activités productives qualitativement distinctes, sont l'une et l'autre une dépense productive de matière cérébrale, de muscle, de nerf, de mains, etc. et sont donc, en ce sens, l'une et l'autre du travail humain. Ce ne sont que deux formes distinctes de dépense de la force de travail humaine.
[31] Karl Marx, Grundrisse, op. cit., p. 127 : C'est précisément l'objectivation du caractère social, universel du travail (et donc du temps de travail contenu dans la valeur d'échange) qui fait de son produit une valeur d'échange ; qui donne à son tour à la marchandise la qualité d'argent. […] Le temps de travail déterminé est objectivé dans une marchandise déterminée, particulière, dotée de propriétés particulières et entretenant des relations particulières avec les besoins ; mais, en tant que valeur d'échange, elle doit être objectivée dans une marchandise qui n'exprime que sa quotité ou sa quantité, qui soit indifférente à ses propriétés naturelles, et, pour cette raison, puisse être métamorphosée en toute autre marchandise objectivant le même temps de travail – c'est-à-dire échangée. C'est en tant qu'objet qu'elle doit posséder ce caractère universel qui contredit sa particularité naturelle. Cette contradiction ne peut être résolue qu'en étant elle-même objectivée ; c'est-à-dire en posant la marchandise doublement, d'abord dans sa forme naturelle, immédiate, puis dans sa forme médiatisée, en tant qu'argent. […] L'argent est le temps de travail en tant qu'objet universel ; ou l'objectivation du temps de travail universel, du temps de travail en tant que marchandise universelle.
[32] Karl Marx, Grundrisse, op. cit., p. 126 : Comme la marchandise est valeur d'échange, elle est échangeable contre de l'argent, est posée = à de l'argent. Le rapport dans lequel est mise l'équation avec l'argent, c'est-à-dire la déterminité de sa valeur d'échange, est présupposé à sa conversion en argent. Le rapport dans lequel la marchandise particulière est échangée contre de l'argent, c'est-à-dire le quantum d'argent en quoi on peut convertir un quantum déterminé de marchandise, est déterminé par le temps de travail objectivé dans la marchandise. En tant que réalisation d'un temps de travail déterminé, la marchandise est valeur d'échange ; dans l'argent, le quota de temps de travail qu'elle représente est aussi bien mesuré que contenu dans sa forme échangeable universelle, adéquate au concept.
[33] Karl Marx, Introduction à la critique de l'économie politique cité par Isaac Roubine, Essais sur la théorie de la valeur de Marx, ch. II.14.
[34] Karl Marx, Le Capital, livre 1, op. cit., p. 82 : quelle que soit la variété des travaux utiles ou des activités productives, c'est une vérité physiologique qu'il s'agit là de fonctions de l'organisme humain, et que chacune de ces fonctions, quels que soient son contenu et sa forme, est essentiellement une dépense de cerveau, de nerf, de muscle, d'organe sensoriel, etc. de l'être humain.
[35] Peter Drahos, op. cit. (je traduis) : Les travailleurs créatifs, c'est-à-dire les travailleurs qui inventent, écrivent, peignent, etc., ne seraient pas dans une position différente de celle de n'importe quel autre travailleur dans le capitalisme. De tels travailleurs vendraient, par nécessité, leur force de travail créative. Pour cette raison, les lois sur la propriété intellectuelle sont inutiles pour motiver les individus à travailler créativement. Par contre, les lois sur la propriété intellectuelle seraient nécessaires pour s'assurer que les intérêts dominants maintiennent et étendent leur contrôle sur une partie vitale des moyens de productions – les objets abstraits.
[36] Alfred Sohn-Rethel, Travail intellectuel et travail manuel : essai d'une théorie matérialiste, In: L'Homme et la société, N. 15, 1970. marxisme et sciences humaines, p. 340 : Avant tout il faut affirmer qu'aucun travail humain ne pourrait être fait sans un certain degré d'unité entre la tête et les mains. Il s'agit, bien entendu, d'une unité individuelle, et non sociale. Ce degré peut être variable.
[37] André Gorz et Jean-Marie Vincent, Dialogue avec André Gorz, Variations, 17 | 2012 : La quantification des prestations de travail ne s'applique avec la force d'une évidence acceptée que pour les prestations quasi intégralement hétérodéterminées, prescrites à des travailleurs interchangeables. Or la quantification est de moins en moins acceptable quand le capital prétend s'emparer de “l'or dans la tête” des travailleurs, c'est-à-dire de leurs savoirs, capacités et compétences informelles, de leur sens de la responsabilité, leur autonomie, etc. S'emparer du capital humain c'est tout simplement s'emparer de la personne et de la vie tout entières du travailleur.
[38] Karl Marx, Le chapitre VI, op. cit., p. 127 : Pour que le temps de travail du travailleur crée de la valeur en rapport avec sa durée, il faut qu'il soit temps de travail socialement nécessaire. Autrement dit, il faut que le travailleur exécute dans un temps déterminé le quantum social normal de travail approprié, et le capitaliste le contraint donc à ce que son travail possède au moins le degré moyen social normal d'intensité.
[39] Karl Marx, Le Capital, livre 1, op. cit., p. 44 : Le temps de travail socialement nécessaire est le temps de travail qu'il faut pour faire apparaître une valeur d'usage quelconque dans les conditions de production normales d'une société donnée et avec le degré social moyen d'habileté et d'intensité du travail.
[40] Peter Drahos, op. cit. (je traduis) : les objets abstraits causent probablement de sérieux problèmes à certaines parties de la théorie économique de Marx. Parmi d'autres choses, cela signifie qu'on ne peut pas traiter du travail de manière homogène.
[41] À l'inverse d'un travail immédiatement consommé, comme la plupart des services à la personnes. Cf. Karl Marx, Le chapitre VI, op. cit., p. 214, 215 : Toutes les fois que le travail est acheté pour être employé comme valeur d'usage, comme service, et non pas pour être mis à la place de la valeur du capital variable en tant que facteur vivant, pour être incorporé au procès de production capitaliste, le travail n'est pas un travail productif ni le salarié un travailleur productif. Son travail étant alors posé en raison de sa valeur d'usage, non comme valeur d'échange, il est consommé de façon improductive et non pas productive
. Ou pour le dire plus crûment, Karl Marx, Grundrisse, op. cit., p. 236, 237 : Ou bien les économistes modernes sont devenus de tels sycophantes du bourgeois qu'ils veulent lui faire accroire que c'est un travail productif quand on lui cherche des poux dans la tête ou quand on lui astique la queue parce que, en le branlant de la sorte par exemple, on décongestionnera sa grosse tête de lard – sa tête de bois – pour le bureau, le lendemain.
[42] Karl Marx, Le Capital, livre 3, op. cit., p. 580, 581 : Enfin, lorsqu'on étudie les aspects de la rente foncière, c'est-à-dire le fermage payé au propriétaire foncier sous le nom de rente foncière pour l'utilisation du sol, soit pour la production, soit pour la consommation, il faut encore retenir ceci : le prix d'objets n'ayant en soi aucune valeur, c'est-à-dire n'étant pas le produit du travail, comme par exemple la terre, ou, du moins, ne pouvant pas être reproduits par le travail comme les antiquités, les chefs-d'œuvre de certains artistes, etc., peut être déterminé par des combinaisons très fortuites. Pour vendre un objet, il suffit uniquement qu'il soit monopolisable et aliénable.
[43] Karl Marx, Le chapitre VI, op. cit., p. 210 : Dès lors que la production capitaliste a pour but immédiat et pour produit spécifique la survaleur, le travail n'est donc productif et celui qui exerce sa capacité de travail n'est un travailleur productif que si, de façon immédiate, il produit de la survaleur, autrement dit seul le travail qui dans le procès de production est consommé directement pour la valorisation du capital.
[44] Karl Marx, Grundrisse, op. cit., p. 660 : L'invention devient alors un métier et l'application de la science à la production immédiate devient elle-même pour la science un point de vue déterminant et qui la sollicite.
[45] Karl Marx, Le Capital, livre 3, op. cit., p. 114 : Remarquons en passant qu'il y a lieu de faire une différence entre travail général et travail collectif. Les deux catégories ont leur rôle dans le procès de production, l'une se fond dans l'autre et réciproquement, mais elles ont aussi leurs différences. Le travail général, c'est tout le travail scientifique, ce sont toutes les découvertes, toutes les inventions. Il a pour condition, en partie, la coopération avec des hommes vivants, en partie l'utilisation des travaux de nos prédécesseurs. Le travail collectif suppose la coopération directe des individus.
[46] Ernst Lohoff et Norbert Trenkle, op. cit., p. 279 : Le travail effectué dans le domaine de l'information ainsi que ses produits possèdent en revanche un autre caractère. De tels biens, comme un programme informatique d'un accès universel, sont le résultat de l'application de travail général. Si Microsoft et compagnie encaissent tout de même des revenus, c'est uniquement parce qu'une législation adaptée (“propriété intellectuelle”) leur permet de demander de l'argent pour l'accès au savoir (licences, etc.) qu'elles produisent. Il ne s'agit pas là de la réalisation de valeur, mais d'une rente d'information. Le travail accompli dans ces entreprises n'augmente alors en aucune façon la masse sociale de valeur, et il permet seulement de répartir la masse de valeur existante en faveur du capital jouissant d'une rente de situation – comme dans le cas de la rente pétrolière, qui profite aux propriétaires des gisements pétroliers, non pas parce que du travail y serait massivement accompli, mais parce qu'ils contrôlent l'accès à une ressource naturelle. Évidemment, cela ne reste pas sans conséquence pour le capital-argent engendré par l'industrie financière qui possède dans les industries de l'information son point de référence de l'économie réelle. Ce capital fictif est non seulement insuffisamment couvert, mais il est en outre dépourvu de toute couverture sociale globale.
; cf. également Stefan Meretz, Der Kampf um die Warenform – Wie Knappheit bei Universalgütern hergestellt wird, Krisis 31, 2007 ; et Ernst Lohoff, Der Wert des Wissens – Grundlagen einer Politischen Ökonomie des Informationskapitalismus, Krisis 31, 2007
[47] Karl Marx, Le Capital, livre 1, op. cit., p. 240 : Dès lors que formation de valeur et modification de valeur sont considérées pour elles-mêmes, dans leur pureté, les moyens de production, ces figures matérielles du capital constant, ne fournissent que la matière dans laquelle doit se solidifier la force fluide formatrice de valeur.
; p. 286 : Le capital constant, les moyens de production ne sont là, considérés du point de vue du procès de valorisation, que pour aspirer du travail et avec chaque goutte de travail un quantum proportionnel de surtravail.
[48] Karl Marx, Le Capital, livre 1, op. cit., p. 684 : Je rappelle ici au lecteur que c'est moi qui ai employé le premier les catégories : capital variable et capital constant. Depuis A. Smith, l'économie politique confond allégrement les déterminations contenues dans ces catégories et les différences formelles issues du procès de circulation, qui distinguent capital fixe et capital circulant.
[49] Karl Marx, Le Capital, livre 1, op. cit., p. 234 : La partie du capital qui se convertit en moyens de production, c.-à-d. en matériau brut, matières auxiliaires et moyens de travail, ne modifie donc pas sa grandeur de valeur dans le procès de production. Je l'appellerai par conséquent partie constante du capital, ou plus brièvement : capital constant.
[50] C'est notamment l'analyse de Ernst Lohoff et Norbert Trenkle, op. cit., p. 278 – bien qu’elle conclut trop rapidement à l’absence de valeur, par ex., des brevets : Entre-temps, il est devenu courant de considérer également les “facteurs non quantifiables”, tels que, par exemple, une position dominante sur le marché, la propriété de patentes, etc., comme du “capital”, et de les assimiler conceptuellement à ceux de la production de biens et de leur gestion, les machines, les bâtiments et les matières premières utilisées. Cette façon de parler confond des “facteurs de production” qui diffèrent fondamentalement les uns des autres. Les machines, les bâtiments et les produits semi-finis représentent du capital constant parce qu'ils sont eux-mêmes le résultat de travaux privés isolés, et qu'ils représentent de la valeur. On peut certes attribuer un prix aux “facteurs non quantifiables”, mais il n'“incarnent” aucune valeur. Si le concept de capital doit conserver un sens analytique et non pas seulement métaphorique, il faut en préserver l'usage au “capital physique” et à la force de travail acquise.
[51] Alfred Sohn-Rethel, op. cit., p. 327-328 : les marchandises sont échangeables entre leurs propriétaires privés précisément par le fait qu'elles font l'objet d'une privation mutuelle de propriété de la part de leurs propriétaires. Cette qualité devrait être manifestement celle qui rend impossible la possession simultanée d'une marchandise par deux propriétaires privés. La réponse semble trop simple et trop banale pour mériter d'être notée : c'est que chaque produit est unique en face des revendications antagonistes de deux propriétaires qui veulent le posséder. Cependant, il est nécessaire de définir avec soin cette unicité. Est-ce réellement la marchandise qui est unique ? La qualité en question ne doit pas, bien sûr, être confondue avec l'indivisibilité de la marchandise en tant que corps. Les biens vendus comme matières premières par exemple, sont divisibles en n'importe quelle fraction, mais, quelle que soit la fraction choisie comme objet d'échange, celle-ci ne pourrait être possédée séparément par deux prétendants à la fois. Et ceci pourrait se poursuivre jusqu'à l'extrême limite de divisibilité où la marchandise ne serait plus qu'un atome et l'on pourrait toujours appliquer le même principe. Le problème est rendu complexe par la nécessité de faire la distinction entre l'échangeabilité, en tant que condition de la structure de base de l'échange et l'équivalence (equatability) de tous les lots particuliers de marchandises. En fait, la raison pour laquelle un objet donné ne peut pas être possédé séparément par des personnes différentes n'a rien à voir avec la nature de l'objet ; ce n'est ni son unicité physique ou indivisibilité, ni son caractère unique dans le genre, ou son irremplaçabilité. Si nous pénétrons dans le sujet avec suffisamment de soin, il n'est pas difficile de s'apercevoir que ce n'est pas dans l'unicité des marchandises, mais dans l'unicité ou la singularité de leur existence, que résident les prétentions des différentes personnes à la possession séparée d'objets identiques. Si l'existence d'un objet était divisible, l'objet pourrait évidemment être possédé simultanément par des propriétaires différents. Chaque propriétaire pourrait non seulement éprouver le monde comme “donnée privée”, mais encore le posséder en tant que propriété exclusive. Tout le monde pourrait posséder le monde, comme Robinson son île. Nous affirmons donc que ce qui constitue la forme d'échangeabilité des produits est l'unicité (ou singularité ou indivisibilité) de leur existence.
[52] Alfred Sohn-Rethel, op. cit., p. 329 : Pour chaque “moi” solipsistique, le monde peut être sa donnée privée exclusive mais, devant tous ces “moi” privés, le monde lui-même est Unique, unique dans son existence. Bien que l'existence d'un objet soit unique, sa perception est aussi multiple qu'il y a de personnes qui le perçoivent. Quoi qu'il en soit, en faisant d'un objet ma propriété privée, j'en fais une partie de ma propre existence aussi longtemps que j'existerai, à l'exclusion de l'existence de toute autre personne (“autre personne” signifiant quelqu'un qui dit, comme moi “j'existe”) [Ceci a la valeur de définition : aussi longtemps que j'existerai, j'appellerai ma propriété privée tout ce qui fait partie de mon existence. Soit dit en passant, le même mot ”ousia” signifie en Grec à la fois propriété et existence.]. Ainsi, c'est l'unité de l'existence des objets qui crée la nécessité existentielle de l'échange en tant que seule manière possible d'acquérir et de céder des objets entre personnes se considérant l'un l'autre comme propriétaires privés. Nous répétons donc que l'unité de leur existence constitue la forme d'échangeabilité des marchandises.
[53] Alfred Sohn-Rethel, op. cit., p. 336 : L'échange de marchandises présente le cas d'une connexion sociale créée par une activité qui la nie. La société qui en résulte se nie elle-même, c'est une société à l'état de négativité. C'est une société qui produit l'individualisme. Cet état de négativité est une des raisons pour lesquelles l'origine sociale de l'intelligence indépendante est apparue, il n'y a pas longtemps, à travers les frustrations de l'épistémologie. Ce sujet épistémologique – le ego cogitans, le nous, le logos, le intellectus purus – résulte de l'identité formelle des propriétaires de marchandises dans leur privation mutuelle de propriété, c'est-à-dire qu'il résulte de l'identité formelle de tous les propriétaires de marchandises dans la négation de leur connexion sociale.
[54] Karl Marx, Le Capital, livre 3, op. cit., p. 330, 331 : Le capitaliste financier aliène au capitaliste industriel cette valeur d'usage de l'argent en tant que capital, sa capacité d'engendrer le profit moyen. Il la cède pour le temps déterminé pendant lequel il met le capital prêté à la disposition du capitaliste industriel. En ce sens, l'argent prêté présente une certaine analogie avec la force de travail dans sa situation vis-à-vis du capitaliste industriel. À ceci près que celui-ci paie la valeur de la force de travail alors qu'il restitue purement et simplement la valeur du capital prêté. Pour le capitaliste industriel, la valeur d'usage de la force de travail est de produire par son emploi plus de valeur (profit) qu'elle n'en possède elle-même et qu'elle ne coûte. Pour le capitaliste industriel, cet excédent de valeur représente la valeur d'usage de la force de travail. De même, c'est sa capacité de créer de la valeur et de l'accroître qui est la valeur d'usage du capital prêté. Le capitaliste financier aliène effectivement une valeur d'usage, et, de ce fait, ce qu'il cède il le cède comme marchandise. Dans cette mesure, l'analogie avec la marchandise en tant que telle est complète. Primo, il s'agit ici d'une valeur qui passe d'une main à une autre. Pour la marchandise simple, la marchandise en tant que telle, la même valeur reste entre les mains de l'acheteur et du vendeur, à ceci près que sa forme change. Tous deux, vendeur et acheteur, possèdent comme devant la même valeur, qu'ils ont aliénée, l'un sous forme de marchandise, l'autre sous forme d'argent. Pour le prêt, il y a cette différence que le capitaliste financier est le seul qui se dessaisisse de valeur dans cette transaction ; mais il la préserve puisqu'elle sera restituée plus tard. Dans le prêt, la valeur est reçue d'un seul côté, puisqu'elle est aussi cédée d'un seul côté. – Secundo, une valeur d'usage réelle est cédée d'une part, reçue et employée de l'autre. Mais, à la différence de la marchandise ordinaire, cette valeur d'usage constitue elle-même une valeur, à savoir l'accroissement au-dessus de sa valeur initiale qui résulte du fait que l'argent a été employé comme capital. Cette valeur d'usage est le profit.
[55] Ernst Lohoff et Norbert Trenkle, op. cit., p. 136 : Mais dans sa soif de changer toute richesse en richesse marchande, le capital ne se contente pas du devenir-marchandise de la richesse sensible-matérielle, et il fait un pas supplémentaire pour se métamorphoser lui-même, sous sa forme argent, en une marchandise. Un type de marchandise d'une sorte tout à fait particulière se présente ainsi à côté des marchandises négociées sur les marchés des biens. Elle médiatise des rapports sociaux d'une nature complètement différente de celle des marchandises habituelles. Mais en dépit de leur caractère à part, les actions ou les emprunts ne représentent pas moins de la richesse capitaliste que les marchandises qui prospèrent sur les marchés des biens. Alors que le tout-venant des marchandises incarne, comme résultat du travail privé passé, de la valeur effective, les titres de propriété incarnent une anticipation de valeur future. Dans le rapport entre créancier et emprunteur, émetteur et acquéreur d'actions, surgit ainsi une sorte de richesse capitaliste qui n'est en aucune façon moins réelle que la variante de la richesse capitaliste fondée sur l'exploitation effective du travail vivant.
[56] André Gorz, L'immatériel, op. cit., p. 54, 55 : La valeur boursière de l'invention reflétera essentiellement les profits futurs escomptés. L'immatérialité du capital intellectuel est le plus apte à fonctionner comme promesse des marchés futurs illimités pour des marchandises d'une valeur non mesurable et, par conséquent, comme promesse de plus-values boursière illimitées. À condition, bien sûr, que ce capital soit une propriété protégée et qu'il occupe une position de monopole. […] L'effondrement de la Bourse des intangibles reflète la difficulté intrinsèque qu'il y a à assigner un équivalent monétaire – une “valeur” – à des actifs non échangeables sur le marché, non divisibles, non mesurables, donc sans valeur d'échange monnayable.
[57] Ernst Lohoff et Norbert Trenkle, op. cit., p. 148 : À partir du moment où le crédit est émis jusqu'à la fin de la relation de crédit, le capital-argent de départ existe simultanément sous deux formes distinctes. La somme originale, le capital-argent préexistant au crédit, qui doit toujours – au moins quand on considère le crédit originel – être le fruit d'une valorisation réelle, et que l'on nomme donc dans l'exposé marxien “capital-argent réel”, est parvenue chez l'emprunteur. Mais le prêteur peut également continuer à considérer le capital-argent comme sien. Il reçoit pour le capital-argent réel cédé son reflet qui s'est autonomisé : la prétention à un remboursement et au paiement des intérêts. Marx nomme ce reflet autonomisé le capital fictif.
; Karl Marx, Le Capital, livre 3, op. cit., p. 433 : Le mouvement autonome de la valeur de ces titres de propriété – pas seulement des bons d'État, des actions aussi – renforce l'illusion qu'ils constituent un véritable capital à côté du capital qu'ils représentent ou des droits qu'ils peuvent ouvrir. Ils se transforment en marchandises dont le prix varie et est fixé selon des lois propres. Leur valeur de marché est déterminée autrement que leur valeur nominale, sans que soit modifiée la valeur (sinon la mise en valeur) du capital réel. D'abord, leur valeur de marché oscille avec le montant des sommes auxquelles ils donnent droit et les garanties qu'ils offrent.
; p. 440, 441 : Les titres de propriété sur des sociétés, des chemins de fer, des mines, etc., sont, nous l'avons vu également, en fait, sans doute des titres sur du capital réel. Mais ils ne permettent pas de disposer de celui-ci. Il ne peut être retiré. Les titres établissent seulement des droits sur une fraction de la plus-value qu'il va s'approprier. Mais ces titres se transforment eux aussi en duplicata du capital réel, en chiffons de papier, comme si un certificat de chargement pouvait avoir une valeur à côté du chargement, et en même temps que lui. Ils se transforment en représentants nominaux de capitaux qui n'existent pas. Car le capital réel existe à côté d'eux et ne change absolument pas de mains, si ces duplicata passent d'une main dans une autre. Ils se métamorphosent en formes du capital productif d'intérêt, non seulement parce qu'ils assurent certaines recettes, mais aussi parce qu'en les vendant on peut obtenir qu'ils soient remboursés en valeurs-capital. Dans la mesure où l'accumulation de ces titres traduit l'accumulation de chemins de fer, mines, bateaux à vapeur, etc., c'est l'expansion du procès de reproduction réel qu'elle exprime, – tout à fait à la façon dont l'extension d'une feuille d'impôts, par exemple, relatifs à des biens mobiliers, témoigne de l'augmentation de ces biens mobiliers. Mais en tant que duplicata, négociables eux-mêmes comme marchandises et circulant donc comme valeurs-capital, leur valeur est fictive : elle peut augmenter ou diminuer tout à fait indépendamment du mouvement de valeur du capital réel, sur lesquels leurs détenteurs ont un droit. Leur valeur, c'est-à-dire leur cotation en Bourse, a nécessairement tendance à augmenter avec la baisse du taux de l'intérêt, dans la mesure où celle-ci est une conséquence toute simple de la chute tendancielle du taux de profit, indépendamment des variations propres du capital-argent : voilà pourquoi cette richesse imaginaire, dont la valeur nominale primitive est déterminée pour chacune de ses fractions aliquotes en ce qui concerne son expression de valeur, augmente, ne serait-ce que pour cette raison, au fur et à mesure du développement de la production capitaliste.
[58] Ernst Lohoff et Norbert Trenkle, op. cit., p. 139 : Même si Marx n'a pas légué une analyse complète du capital-argent négocié comme marchandise, cela ne dément pas l'attitude de la critique de l'économie politique à percer les arcanes du capital-argent.
[59] Ernst Lohoff et Norbert Trenkle, op. cit., p. 293 : En tant que perspectives de rendement devenues marchandises, les produits des marchés financiers sont des marchandises dérivées. Leur aptitude à incarner de la richesse capitaliste à travers l'anticipation de création de valeur future est influencée essentiellement par le changement des perspectives attachées au point de référence dans l'économie réelle auquel se rapportent les titres de propriété correspondant.
[60] Ernst Lohoff et Norbert Trenkle, op. cit., p. 150 : Lors de l'émission d'actions, on n'assiste en aucune façon à une simple transmission de richesse capitaliste déjà existante mais à une multiplication de celle-ci à travers le reflet. Il est clair qu'une société qui émet des actions reçoit de l'acquéreur du capital-argent frais. La vente d'actions lui rapporte du capital supplémentaire. En tant que somme d'argent particulière, ce capital-argent existait certes auparavant, précisément dans les mains du futur acquéreur d'actions ; mais il n'a pas été seulement transféré à la société par actions. Après la transaction, les acquéreurs ne se trouvent en aucune façon les mains vides, car, en fin de compte, ils n'ont pas fait que donner leur argent. Ils ont bien plus acheté des marchandises, des actions précisément, qui n'existaient pas avant ladite émission. Ces marchandises nouvellement créées confèrent à leur propriétaire actuel la valeur d'usage qui se traduit par le droit de recevoir une part du profit que la société émettrice est censée réaliser dans le futur. Avec l'achat d'une telle valeur d'usage, l'argent ne quitte l'acquéreur des actions que dans le sens où il devient du capital, précisément du capital fictif.
[61] « Conceptuellement », car dans la temporalité réelle, ce rapport est inversé : les marchandises dérivées, les titres de propriété, anticipent la valeur réelle des futures marchandises ordinaires.
[62] Isaac Roubine, Essais sur la théorie de la valeur de Marx, ch. II.15 : Cette idée, que l'on trouve déjà chez Adam Smith, a été particulièrement développée par L. Ljubimov dans Kurs političeskoj ekonomii (Cours d'économie politique, 1923, p.72-78). Malheureusement, Ljubimov a confondu deux choses : la question de savoir ce qui détermine la valeur moyenne des produits d'une profession hautement qualifiée, par exemple les ingénieurs, les artistes, etc., et celle de savoir ce qui détermine le prix individuel d'un objet non reproductible donné (une peinture de Raphaël). Quand il traite des biens reproductibles produits à une échelle de masse (par exemple le travail d'un ingénieur peut être considéré comme un travail qui produit, à de rares exceptions près, des produits homogènes et reproductibles), on peut obtenir la valeur d'une unité de produit en divisant la valeur de la production tout entière dans une profession donnée par le nombre de produits homogènes que cette profession a produits. Mais cela est impossible si l'on considère des objets particuliers non reproductibles. Le fait que le travail dépensé en vain par des milliers de peintres qui n'ont pas réussi soit compensé par le prix d'un tableau de Raphaël, ou que travail dépensé en vain par des centaines de peintres sans succès soit compensé par le prix d'un tableau de Salvador Rosa, ne peut absolument pas être déduit du fait que la valeur moyenne du produit d'une heure de travail d'un peintre est égale à la valeur du produit de cinq heures de travail simple (pour chaque heure de travail du peintre, on ajoute une heure de travail dépensé par le peintre pour sa formation et trois heures dépensées lors de l'apprentissage de trois peintres qui n'ont pas percé). L. Ljubimov a parfaitement raison de subsumer la valeur du produit d'un travailleur qualifié sous la loi de la valeur. Mais il ne peut nier le fait du monopole qui est lié au prix individuel des objets non reproductibles. P. Maslov commet l'erreur opposée. Il attribue un caractère monopolistique également à la valeur moyenne des produits du travail hautement qualifié (cf. son livre Kapitalizm, 1914, p. 191-192). Il n'est pas question pour Marx de subsumer le prix des objets non reproductibles sous la loi de la valeur, pour la simple raison que la loi de la valeur doit expliquer précisément les lois des activités humaines productives. Dans la théorie de la valeur, Marx ne traite pas de la valeur des produits “ne pouvant pas être reproduits par le travail, comme les antiquités, les chefs-d'œuvre de certains artistes, etc.” (Le Capital, L. III, t. 8, p. 25)
[63] Sébastien Charbonnier, La « propriété intellectuelle » : une idée radine pour penseurs mort-nés : En effet, la propriété intellectuelle a pour but de protéger du vol d'une idée. Or, le concept de vol et de négoce de “pensées” n'a de sens que pour les idées réifiées : la propriété intellectuelle protège les recettes qui marchent – d'où l'importance du brevetage en science, où une formule peut demeurer efficace sans qu'en soit retracée la dynamique et vécu le sens problématique. Concevoir la possibilité d'une propriété des idées est le propre de l'image dogmatique de la pensée qui consacre le règne des solutions. L'attribution devient alors la modalité principale de ce système d'échange marchand : chacun y va de son modèle, de sa théorie, et tient à la signer de son nom dans la mesure où il a implicitement renoncé à l'idéal d'objectivité. Ce qui compte est d'affirmer la paternité d'énoncés qui permettent d'exhiber ses richesses (érudition : capital culturel), de rapporter de l'argent (droit d'auteur : capital économique) ou d'atteindre la gloire (reconnaissance des pairs, CV fourni : capital social).
[64] André Gorz, La sortie du capitalisme, op. cit. : Le problème auquel se heurte “l'économie de la connaissance” provient du fait que la dimension immatérielle dont dépend la rentabilité des marchandises n'est pas, à l'âge de l'informatique, de la même nature que ces dernières : elle n'est la propriété privée ni des entreprises ni des collaborateurs de celles-ci ; elle n'est pas de par sa nature privatisable et ne peut par conséquent devenir une vraie marchandise. Elle peut seulement être déguisée en propriété privée et marchandise en réservant son usage exclusif par des artifices juridiques ou techniques (codes d'accès secrets). Ce déguisement ne change cependant rien à la réalité de bien commun du bien ainsi déguisé : il reste une non-marchandise non vendable dont l'accès et l'usage libres sont interdits parce qu'ils demeurent toujours possibles, parce que le guettent les “copies illicites”, les “imitations”, les usages interdits. Le soi-disant propriétaire lui-même ne peut les vendre, c'est-à-dire en transférer la propriété privée à un autre, comme il le ferait pour une vraie marchandise ; il ne peut vendre qu'un droit d'accès ou d'usage “sous licence”.
[65] Peter Drahos, op. cit. (je traduis) : Notre thèse centrale est que la propriété intègre le travail créatif dans la vie productive du capital. […] En fait, les objets abstraits ont pour effet d'augmenter qualitativement les possibilités de production de marchandises du capitalisme. […] La propriété intellectuelle, en marchandisant les constructions mentales universelles, accroît de façon spectaculaire les horizons marchands du capitalisme. La propriété intellectuelle est peut-être le signe que la nature marchande du capitalisme ne cessera jamais d'évoluer. Marx pensait que la marchandise-force de travail était la forme de marchandise distinctive du capitalisme. Notre analyse suggère que la compréhension des puissances productives du capitalisme ne s'arrête pas avec la marchandisation de la force de travail. À travers la création d'objets abstraits, le droit sur la propriété intellectuelle fournit au capitalisme une autre forme distinctive de marchandise et, du moins potentiellement, un autre moyen d'expansion supplémentaire. En créant des objets abstraits, la propriété intellectuelle amène le travail créatif directement dans les relations de production. Le capitalisme peut poursuivre sa production historiquement spectaculaire de marchandises parce qu'à travers le droit sur la propriété intellectuelle, il a restructuré les possibilités de production de marchandises. En outre, le travail créatif, à travers la création de moyens de productions plus performants, diminue en fait le rôle du travail physique. L'objectif d'un industriel n'est plus de contrôler le travail physique par des contrats et le droit sur les relations industrielles mais de contrôler le travail créatif par le droit sur la propriété intellectuelle.
[66] André Gorz, La sortie du capitalisme, op. cit. : Les qualités immatérielles incomparables procurent à la firme productrice l'équivalent d'un monopole et la possibilité de s'assurer une rente de nouveauté, de rareté, d'exclusivité. Cette rente masque, compense et souvent surcompense la diminution de la valeur au sens économique que la baisse des coûts de production entraîne pour les produits en tant que marchandises par essence échangeables entre elles selon leur rapport d'équivalence. Du point de vue économique, l'innovation ne crée donc pas de valeur ; elle est le moyen de créer de la rareté source de rente et d'obtenir un surprix au détriment des produits concurrents. La part de la rente dans le prix d'une marchandise peut être dix, vingt ou cinquante fois plus grand que son coût de revient, et cela ne vaut pas seulement pour les articles de luxe ; cela vaut aussi bien pour des articles d'usage courant comme les baskets, T-shirts, portables, disques, jeans etc. Or la rente n'est pas de même nature que le profit : elle ne correspond pas à la création d'un surcroît de valeur, d'une plus-value. Elle redistribue la masse totale de la valeur au profit des entreprises rentières et aux dépends des autres ; elle n'augmente pas cette masse.
[67] Karl Marx, Grundrisse, op. cit., p. 660-662 : L'échange de travail vivant contre du travail objectivé, c.-à-d. la position du travail social sous la forme de l'opposition entre capital et travail salarié – est le dernier développement du rapport de valeur et de la production reposant sur la valeur. La condition implicite de celle-ci est et demeure : la masse de temps de travail immédiat, le quantum de travail employé comme facteur décisif de la production de la richesse. Cependant, à mesure que se développe la grande industrie, la création de la richesse réelle dépend moins du temps de travail et du quantum de travail employé que de la puissance des agents mis en mouvement au cours du temps de travail, laquelle à son tour […] n'a elle-même aucun rapport avec le temps de travail immédiatement dépensé pour les produire, mais dépend bien plutôt du niveau général de la science et du progrès de la technologie […]. La richesse réelle se manifeste plutôt […] dans l'extraordinaire disproportion entre le temps de travail utilisé et son produit, tout comme dans la discordance qualitative entre un travail réduit à une pure abstraction et la force du procès de production qu'il contrôle. Ce n'est plus tant le travail qui apparaît comme inclus dans le procès de production, mais l'homme plutôt qui se comporte en surveillant et en régulateur du procès de production lui-même. […] Il vient se mettre à côté du procès de production au lieu d'être son agent essentiel. Dans cette mutation, ce n'est ni le travail immédiat effectué par l'homme lui-même, ni son temps de travail, mais l'appropriation de sa propre force productive générale, sa compréhension et sa domination de la nature, par son existence en tant que corps social, en un mot le développement de l'individu social, qui apparaît comme le grand pilier fondamental de la production et de la richesse. Le vol du temps de travail d'autrui, sur quoi repose la richesse actuelle, apparaît comme une base misérable comparée à celle, nouvellement développée, qui a été créée par la grande industrie elle-même. Dès lors que le travail sous sa forme immédiate a cessé d'être la grande source de la richesse, le temps de travail cesse nécessairement d'être sa mesure et, par suite, la valeur d'échange d'être la mesure de la valeur d'usage. Le surtravail de la masse a cessé d'être la condition du développement de la richesse générale, de même que le non-travail de quelques-uns a cessé d'être la condition du développement des pouvoirs universels du cerveau humain. […] Le capital est lui-même la contradiction en procès, en ce qu'il s'efforce de réduire le temps de travail à un minimum, tandis que d'un autre côté il pose le temps de travail comme seule mesure et source de la richesse. C'est pourquoi il diminue le temps de travail sous la forme du travail nécessaire pour l'augmenter sous la forme du travail superflu ; et pose donc dans une mesure croissante le travail superflu comme condition – question de vie et de mort – pour le travail nécessaire. […] La nature ne construit ni machines, ni locomotives, ni chemins de fer, ni télégraphes électriques, ni métiers à filer automatiques, etc. Ce sont là des produits de l'industrie humaine : du matériau naturel, transformé en organes de la volonté humaine sur la nature ou de son activation dans la nature. Ce sont des organes du cerveau humain créés par la main de l'homme : de la force de savoir objectivée. Le développement du capital fixe indique jusqu'à quel degré le savoir social général, la connaissance, est devenue force productive immédiate, et par suite, jusqu'à quel point les conditions du processus vital de la société sont elles-mêmes passées sous le contrôle de l'intellect général, et sont réorganisées conformément à lui. Jusqu'à quel degré les forces productives sociales sont produites, non seulement sous la forme du savoir, mais comme organes immédiats de la pratique sociale ; du processus réel de la vie.
[68] Marina Cousté et Gaëlle Bousson, La vente aux enchères Vogica un coup d'essai à confirmer, Revue des marques, numéro 79, juillet 2012 : en 2006, Ocean Tomo a procédé, à New-York, à une vente aux enchères portant sur des lots composés de brevets, marques, copyrights, droits musicaux et noms de domaine, les vendeurs étant notamment, IBM, Motorola, Siemens AG, Kimberly Clark…
[69] Ainsi, lorsque l'on est sottement accusé de piller le travail d'un artiste qui, sans la « propriété intellectuelle » mourrait de faim dans son garage et qui, grâce à elle, peut devenir milliardaire, il est possible de simplement répondre : « foutaises » ! Car cet artiste ne créant aucune valeur, s'il peut s'enrichir, ce n'est que parce qu'on lui redistribue gracieusement de la valeur que le système de production dans son ensemble a créé par ailleurs. Il n'est question d'aucun vol et cet artiste ferait mieux de changer de garage pour rejoindre ceux où l'on refuse de rabaisser ses talents créatifs à du travail comme un autre.
[70] J'ai abordé ce sujet dans le passé sur ce blog, mais cela demanderait à être enrichi par la théorie économique de la « propriété intellectuelle » proposée ici.
[71] André Gorz, La sortie du capitalisme, op. cit. : Par son développement même, le capitalisme a atteint une limite tant interne qu'externe qu'il est incapable de dépasser et qui en fait un système mort-vivant qui se survit en masquant par des subterfuges la crise de ses catégories fondamentales : le travail, la valeur, le capital. Cette crise de système tient au fait que la masse des capitaux accumulés n'est plus capable de se valoriser par l'accroissement de la production et l'extension des marchés. La production n'est plus assez rentable pour pouvoir valoriser des investissements productifs additionnels. Les investissements de productivité par lesquels chaque entreprise tente de restaurer son niveau de profit ont pour effet de déchaîner des formes de concurrence meurtrières qui se traduisent, entre autres, par des réductions compétitives des effectifs employés, des externalisations et des délocalisations, la précarisation des emplois, la baisse des rémunérations, donc, à l'échelle macro-économique, la baisse du volume de travail productif de plus-value et la baisse du pouvoir d'achat. Or moins les entreprises emploient de travail et plus le capital fixe par travailleur est important, plus le taux d'exploitation, c'est-à-dire le surtravail et la survaleur produits par chaque travailleur doivent être élevés. Il y a à cette élévation une limite qui ne peut être indéfiniment reculée, même si les entreprises se délocalisent en Chine, aux Philippines ou au Soudan.
[72] Archives parlementaires, Tome 22 : Du 3 janvier au 5 février 1791, Séance du jeudi 13 janvier 1791, au soir, page 212. Rapport du comité de Constitution sur la pétition des auteurs dramatiques, M. Le Chapelier.
[73] Mami Fujiwara, Diderot et le droit d'auteur avant la lettre : autour de la Lettre sur le commerce de la librairie, Revue d'histoire littéraire de la France 1/2005 (Vol. 105) , p. 79-94 citant Denis Diderot, Lettre historique et politique adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie, son état ancien et actuel, ses règlements, ses privilèges, les permissions tacites, les censeurs, les colporteurs, le passage des ponts et autres objets relatifs à la police littéraire.
[74] Qui s'ajoute à la division du travail déjà monstrueuse en soi, cf. Michel Henry, op. cit., p. 252 : Reprenons la généalogie de la classe. Marx lui assigne comme fondement la division du travail. C'est la division du travail qui sous-tend la première grande division sociale entre la ville et la campagne. C'est la division du travail dans la manufacture et dans la grande industrie qui façonne et détermine la physionomie du prolétariat. Toutes les structures économico-sociales reposent sur elle. C'est elle qui fonde la propriété privée, la contradiction entre l'intérêt privé et l'intérêt général, qui rend possible l'échange, c'est-à-dire l'économie marchande et, par suite, le capitalisme. Quant au socialisme, son but dernier et le plus explicite n'est autre que la suppression de la division du travail. Qu'est-ce donc que la division du travail ? En quoi consiste ce phénomène ultime et décisif ? Considérons l'individu, je veux dire un individu. Considérons-le comme une subjectivité, non pas la subjectivité de l'idéalisme qui s'épuise dans la pensée, une pensée d'ailleurs universelle, dans la représentation, dans ce que Marx appelle, – avec les philosophes classiques du reste, la “conscience”, mais considérons au contraire l'individu comme une subjectivité concrète, particulière, portant en elle, à titre de virtualités, une multiplicité d'activités et d'intentionnalités possibles. Marx appelle ces potentialités subjectives des “puissances personnelles”. La vie comme vie chaque fois individuelle est l'unité subjective de ces puissances elles-mêmes subjectives, qui lui appartiennent en propre, qui définissent son être originel et sont voulues par lui, qui sont ses besoins. Vivre, c'est nécessairement développer de telles possibilités. Marx parle dans Le Capital du “libre jeu des forces du corps et de l'esprit”. Laisser jouer ces forces veut dire les actualiser, leur donner l'être, la réalité. La réalisation des possibilités individuelles ne signifie en aucun cas, comme chez Hegel, leur objectivation, leur devenir manifeste sous la forme de l'objet, dans ce qui est là pour tous et pour chacun, dans l'œuvre. Bien au contraire, la réalisation première des virtualités subjectives est elle-même subjective. Elle en est l'actualisation dans la vie même, comme un de ses moments, comme une de ses modalités phénoménologiques effectives, comme un vécu. Il s'agit chaque fois d'un acte ou d'un état : c'est la consommation, la jouissance, qui est la réalisation du besoin, c'est l'acte de se mouvoir, le mouvement vivant, le travail vivant, c'est le développement esthétique subjectif de chaque sens. C'est pourquoi le développement universel de l'individu sans cesse visé, sans cesse exigé par Marx, est “l'épanouissement entier de l'intériorité humaine”. Dans la division du travail l'actualisation de la totalité des potentialités subjectives individuelles s'accomplit de telle manière qu'une seule de ces potentialités se trouve réalisée dans un individu donné. L'effectuation des autres potentialités, des autres puissances de la vie, tombe en dehors de lui, elle se produit dans des sphères monadiques différentes. Marx dit dans L'Idéologie allemande : “la division du travail entraîne la possibilité et même la réalité que l'activité spirituelle et matérielle, la jouissance et le travail, la production et la consommation échoient à des individus différents”. Dès lors chaque individu, considéré en lui-même, se trouve privé de la réalisation de multiples possibilités d'une vie qui est pourtant la sienne, qui constitue son être propre. Quand cet être individuel ne se réalise que partiellement, il est mutilé. La division du travail, dit Marx dans Le Capital, “attaque l'individu à la racine même de sa vie”, et encore : “elle mutile le travailleur au point de le réduire à une parcelle de lui-même”. La signification éthique de la critique de la division du travail est seconde, sa signification première est ontologique, elle présuppose une philosophie de la subjectivité monadique. Si on affirme le primat de l'universel ou encore du tout, de quelque manière qu'on le conçoive, la critique de la division du travail n'a aucun sens. Du point de vue de l'organisme ou de la structure, en effet, chaque partie ou chaque élément accomplit sa fonction, joue son rôle dans l'économie de l'ensemble. C'est seulement si on pose le point, l'élément, comme l'absolu, et l'individu comme le tout de l'être que tout ce qui est hors de lui signifie aussitôt une atteinte à son être propre, n'est plus rien d'autre que ce dont il est privé. La critique de la division du travail est la théorie de l'aliénation réelle. Celle-ci n'est ni idéologique, ni politique, ni sociale, ni économique, elle définit l'état intérieur de la monade absolue. La division du travail, c'est la division de la subjectivité.
[75] Moishe Postone, Repenser Le Capital à la lumière des Grundrisse, Variations, 17 | 2012. Pour Marx donc, la fin de la préhistoire signifie l'avènement de l'opposition entre les travaux manuel et intellectuel. Pourtant, cette opposition ne peut être dépassée en mélangeant simplement le travail manuel et le travail intellectuel. La vision de la production par Marx dans les Grundrisse implique non seulement que la séparation de ces deux modes de travail, mais aussi que les caractéristiques déterminantes de chacun, sont enracinées dans la forme de production existante. Leur séparation pourrait être dépassée en transformant les modes existants des travaux manuel et intellectuel, c'est-à-dire, par la construction d'une nouvelle structure et organisation du travail. Une telle structure renouvelée devient possible, selon l'analyse de Marx, quand la production du surplus n'est plus basée nécessairement et avant tout sur le travail humain direct.
[76] Alfred Sohn-Rethel, op. cit., p. 337 : La division entre le travail intellectuel et le travail manuel est liée à la contradiction entre le travail intellectuel socialisé et le travail manuel individuel. Par sa pensée socialisée, le travailleur intellectuel agit en plénipotentiaire de la société. Son travail individuel est fait pour l'ensemble de la société. Il a l'universalité. Le travailleur manuel ne peut pas faire de même. Son travail est individuel aussi bien par sa portée que par l'acte. Si un travail manuel a une portée plus qu'individuelle, par exemple la construction d'une digue d'irrigation dans l'Égypte ancienne, ou d'un temple sur l'Acropole, ou d'une Mini Austin à Longbridge, il doit être fait par une association d'ouvriers coopérants. Mais tout individu fournissant un travail intellectuel de style universel peut arriver à la confrontation d'opéra-comique de l'Homme à la Nature, accompagnée par l'épistémologie traditionnelle.
[77] Christopher May, La marchandisation à « l'âge de l'information » : droits de propriété intellectuelle, l'État et Internet, [Commodifying the information age : intellectual property rights, the state and the internet], Actuel Marx 2/2003 (n° 34) , p. 81-97 : Tout comme les rapports de propriété matérielle, les rapports de propriété intellectuelle rendent les réalisations aliénables et par conséquent échangeables sur les marchés ; ils marchandisent le savoir et l'information au profit du capital. Le déploiement ininterrompu de la technologie a fait de l'activité intellectuelle une activité directement productive et a permis de démystifier nombre de pratiques économiques. […] La propriété intellectuelle permet donc une séparation entre les individus et les produits de leur esprit, reconduisant ainsi l'aliénation du travailleur face aux produits de son travail, aliénation qui, chez Marx, était elle-même au cœur de l'analyse de la soumission du travail au régime de la marchandise.
[78] Et le mode de production capitaliste use et abuse de cette dialectique entre sujet et objet, cf. Karl Marx, Grundrisse, op. cit., p. 48, 49 : La production ne produit donc pas seulement un objet pour le sujet, mais aussi un sujet pour l'objet.
[79] Karl Marx, Le Capital. Critique de l'économie politique. Livre troisième : Le procès d'ensemble de la production capitaliste, (trad. Catherine Cohen-Solal et de Gilbert Badia), Éditions sociales, Paris, 1976, p. 114.
[80] William van Caenegem, “A Philosophy of Intellectual Property” by Peter Drahos, Bond Law Review: Vol. 8: Iss. 2, Article 7, 1996 (je traduis) : Le droit sur la propriété intellectuelle est-il en premier lieu concerné par des informations en tant que telles ? Et une distribution juste d'informations est-elle un projet sensé ? On pourrait contester que la propriété intellectuelle est plutôt étroitement concernée par les utilisations des informations ; et que c'est un instrument pour la sélection d'informations. Sa principale fonction peut être vue comme l'organisation des flux d'information et la sélection des informations pertinentes. Une information qui a de la valeur pour certains, n'en a aucune pour d'autres. Pour que l'information ait et génère de la valeur, un échange efficient est ainsi primordial.
[81] André Gorz, L'immatériel, op. cit., p. 76, 77 : La connaissance, inséparable de la capacité de connaître, est produite en même temps que le sujet connaissant. Elle est une valeur vérité avant d'être un moyen de production. Plus précisément, toutes les connaissances ne se prêtent pas à servir de moyens de production et celles qui s'y prêtent d'emblée et par destination se distinguent par leur efficacité instrumentale, non par la valeur vérité de leurs contenus. C'est dire que toutes les connaissances ne se valent pas et que le capitalisme ne retient que celles dont la potentialité instrumentale est manifeste ou prévisible. […] Dans la mesure où toute connaissance, même instrumentale, c'est-à-dire pratico-technique, contient nécessairement une relation implicite à la connaissance-vérité et à la capacité de connaître et d'apprendre, toute connaissance, même technique, est non seulement source potentielle de richesse et de sens, mais aussi richesse en soi. En tant que source de richesse, elle est “force productive” ; en tant que richesse, elle est source de sens et fin en elle-même. En tant que force productive, elle est force de travail : mais d'être mise au travail n'est ni la destination exclusive ni la destination première de la connaissance.
[82] Sébastien Charbonnier, op. cit. : le primat des solutions sur les problèmes induit une conceptualisation de la pensée arrêtée : ce geste intellectuel réduit l'idée au statut ontologique d'objet de la pensée et rend ainsi possible la marchandisation de la pensée. Dans un tel cadre conceptuel réifiant, la liberté d'expression devient le corrélat subjectif d'une aliénation objective d'autant plus inaperçue, donc redoutable, qu'elle flatte un sentiment de liberté chez les individus en suivant ses tendances narcissiques : “tu es ton propre royaume, tu es/as un moi génial dont les productions sont ta propriété et peuvent te rapporter gros”.
[83] Sébastien Charbonnier, op. cit. : Le cri de Rousseau synthétise parfaitement l'entourloupe magistrale qui s'est opérée dans le régime de la pensée : le premier qui, ayant signé une pensée, s'avisa de dire “Celle-ci est mienne”, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la chrématistique de la pensée. Deux siècles plus tard, le faux problème de l'“opinion éclairée” suit encore ce schéma : j'ai mes clichés, je les confronte (éventuellement) avec d'autres dans un débat, j'ai mon opinion sur tel point. Si “A” signifie : “attribution d'une pensée”, et “M” : “mode de l'explication rationnelle”, alors le règne des solutions conduit à la chrématistique de la pensée (A – M – A’) qui permet une imputation de l'idée (avec A’>A en termes de capital symbolique). L'opinion personnelle devient une fin en soi dont le travail de la pensée n'est qu'un moyen. À l'inverse, penser est émancipateur précisément dans la mesure où il nous sort de la chrématistique et ne voit dans les idées réifiées qu'un moyen pour la pensée critique donc libératrice. Le schéma devient : j'ai mon hypothèse première plus ou moins spontanée, j'explore des croyances (des)autres, j'ai un nouveau problème plus précis (M – A – M’).
[84] Peter Drahos, op. cit. (je traduis) : Le droit sur la propriété intellectuelle, parce qu'il change des objets abstraits en choses de possession, s'ajoute à ce que Marx appelait le “fétichisme des marchandises”. […] Pour Marx, la propriété intellectuelle représenterait la marchandisation de la vie mentale des hommes et des femmes. Dans la propriété intellectuelle, le fétichisme de la marchandise atteint son sommet. La vie mentale des individus, la chose même dont on peut dire qu'elle appartient à une personne, devient externalisée (ou aliénée) et entre dans les relations entre les choses, devient une part des mécanismes de production et d'échange du capitalisme.
[85] Il nous faut insister sur la nécessité pour la critique d'adresser radicalement ces catégories de bases du capitalisme, qui en déterminent le fonctionnement intrinsèque, et de ne pas s'arrêter à contester ses principes formels, tels que les rapports d'appropriation ou la redistribution des richesses, comme s'y limite malheureusement Grégoire Chamayou, en dénonçant – ceci dit, avec justesse – que les critiques de la propriété intellectuelle ne s'articulent presque jamais à une critique de la propriété privée “traditionnelle”. […] une critique libertaire de la propriété intellectuelle ne vaut que si elle intègre la question sociale de la distribution des richesses. […] L'argument de l'innovation, s'il reste déconnecté à la fois de la critique de la propriété privée des moyens matériels de production et d'une critique plus générale des rapports d'appropriation, est insuffisant pour formuler une critique sociale de la propriété intellectuelle.
Cf. Grégoire Chamayou, Le débat américain sur liberté, innovation, domaine public, Contretemps n° 5, Paris, Textuel, 2002.
[86] Michel Henry, op. cit., p. 258 : Historiquement l'échange est d'abord un phénomène marginal, il est apparu à la frontière des différents groupes humains, lorsque ceux-ci ont été capables de produire un peu plus que les subsistances immédiatement nécessaires à leur survie. Ces groupes ont alors échangé les produits disponibles. Leur production n'en a guère été affectée. Elle restait essentiellement orientée vers les valeurs d'usage, c'est-à-dire vers la consommation et vers la vie. Seuls les produits excédentaires devenaient marchandises, valeurs d'échange. Peu à peu, cependant, avec le développement d'ailleurs très lent de la production, l'échange s'est lui-même développé jusqu'au jour où, brusquement, il est devenu lui-même le but de la production. On n'a plus produit pour satisfaire des besoins, d'ailleurs toujours les mêmes, des besoins limités, en sorte que la production restait elle aussi limitée. On a produit pour vendre, c'est-à-dire qu'on a produit pour produire et la production est devenue illimitée. Les sociétés parvenues à ce point de leur évolution ont été bouleversées. Alors s'est produit une révolution, la seule, à vrai dire, dans l'histoire de l'humanité. Et cette révolution consiste en ceci que la production n'a plus été orientée ni définie par la valeur d'usage mais par la valeur d'échange, elle a cessé d'obéir à la vie pour devenir, à la lettre, économique. L'activité, mode essentiel de la vie, n'a plus trouvé son principe et sa fin dans la vie elle-même, dans le besoin, elle a cessé d'être le prolongement naturel de celui-ci et le mode de sa réalisation, pour se soumettre à une téléologie étrangère, proprement économique, à savoir la nécessité de produire toujours davantage de valeur, c'est-à-dire d'argent, elle s'est soumise à la grande loi de la valorisation. La substitution de la valeur d'échange à la valeur d'usage comme fin de la production, c'est-à-dire aussi bien l'avènement de l'économique et son règne, signifie la perversion de la vie immédiate et le renversement de toutes ses valeurs. Pour Marx, l'économique n'est pas le lieu de la réalité, mais plutôt celui où elle s'est perdue, le lieu de son aliénation. Pour Marx l'économique, c'est d'abord le mal.
